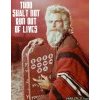Spec Ops : The Line, Saïgon des sables
Le jeu vidéo est un média de plus en plus mature, auquel il va falloir reconnaître sa capacité à porter un message, un sens. Tentative critique avec un jeu unique dans sa construction et son ambition : Spec Ops : The Line
La galaxie de ce qu’on regroupe sous l’appellation vague de « jeux de guerre » traverse les genres et les publics, et on y trouve de tout, d’ArmA à Command & Conquer, et des inévitables Battlefield et affiliés à Company of Heroes. Ce domaine est si vaste et disparate que vouloir parler d’un de ces jeux revient souvent à s’enfoncer dans un marais d’explications, de justifications et de comparaisons douteuses (« En fait, c’est Medal of Honor, mais vu de dessus, mais mélangé à Battlefield… ») qui engloutira sans pitié les propos du malheureux qui s’y enfonce. Pour contourner ce terrain mouvant, je mettrai Spec Ops : The Line en contexte avec une simple analogie : il est à Call of Duty ce qu’Apocalypse Now est aux Expendables. Voilà pour vous donner une petite idée.

« Tu la sens mon apocalypse, now ? »
La guerre est un sujet rebattu comme aucun autre. Elle a été représentée dans toutes les formes d’arts, de la musique à la peinture, et le cinéma en a fait le meilleur comme le pire. Mais l’intérêt n’est pas tant dans le thème abordé que dans la manière dont un médium va s’en emparer pour dire quelque chose qui excède ce qu’il se contente de montrer. La guerre au cinéma n’est pas la guerre en peinture, ni la guerre en littérature. Le jeu se devait lui aussi de se trouver un porte-parole capable de s’emparer de ce sujet et d’en faire quelque chose de fondamentalement vidéoludique, qui ne serait ni un empilement absurde de niveaux vaguement liés par un scénario contorsionniste, ni le plagiat interactif d’un film d’action quelconque. On va montrer ici que non seulement Spec Ops : The Line s’empare intelligemment de son sujet, mais encore qu’il le fait en utilisant des mécaniques propres au jeu vidéo.
The Line est donc un jeu de tir à la troisième personne édité en 2012 par 2K et développé par le studio Yager basé à Berlin (et, en ce qui concerne la partie multijoueur, par Darkside Game Studios). Il met en scène le capitaine Walker et son escouade de la Delta Force dans une mission de reconnaissance dans un Dubaï dévasté. En effet, après des tempêtes de sable d’une force et d’une persistance extraordinaires, la ville, partiellement engloutie, a cessé tout contact avec le monde extérieur dont elle est à présent isolée par un mur de sable quasi-permanent empêchant tout lien radio. Peu avant la perte de contact, le 33ème bataillon de l’US Army (surnommé « Les Damnés »), de retour d’Afghanistan, a décidé de se détourner de sa route pour tenter d’aider la population et d’organiser l’évacuation, transgressant à la fois les ordres de sa hiérarchie et l’interdiction des Émirats de voir une force étrangère intervenir sur son sol. À la tête de ce bataillon, un héros décoré, le colonel Konrad. Bien sûr, tout ne s’est pas passé comme prévu, et la seule chose qui est ressortie de Dubaï est un message de Konrad établissant l’échec de l’évacuation et des pertes trop nombreuses. En somme, une ville multiculturelle, débordant d’inégalités sociales, densément peuplée, privée de ressources et à moitié engloutie sous le sable, à laquelle s’ajoute un bataillon de déserteurs en mission humanitaire autoproclamée et un commando d’élite armé jusqu’aux dents.
Qu’est-ce qui pourrait aller de travers ?

La skyline reconnaissable : check. Le personnage principal charismatique : check. Les embouteillages figés dans le temps : check. Le sable : double-check.
Errare humanum est
L’une des qualités les plus remarquées et les mieux exploitées de Spec Ops : The Line est la présence de choix à certaines charnières de l’histoire. Pour comprendre la portée de ces choix et leur intérêt vidéoludique, il est inutile de s’intéresser à leurs conséquences, très négligeables, sur le scénario lui-même, mais au contraire il peut être crucial de s’arrêter sur un concept des sciences cognitives introduit au joueur par un texte d’écran de chargement : ce qu’on appelle la dissonnance cognitive. Ce phénomène psychologique est le résultat de la présence simultanée de deux cognitions (ou actions, si vous préférez) dans la conscience. Un exemple bête : « Je dois maigrir » et « Je veux manger ce donut ». Ces dissonnances sont très fréquentes dans la vie de tous les jours et ne portent pas à conséquence (« Bon, je mange le donut, mais je prends un coca light et une salade »), le plus souvent, cependant, elles peuvent affecter de façon beaucoup plus importante des individus faisant des choix en désaccord complet avec, par exemple, leurs principes moraux fondamentaux, et qui se retrouvent obligés de trouver une justification à leurs actes, justification de moins en moins rationnelle à mesure que la dissonance augmente. C’est précisément ce mécanisme que Spec Ops cherche à la fois à illustrer et à mettre en œuvre chez le joueur, et rien que pour ça ce jeu mérite d’être joué. En effet, dans les premiers chapitres, tout est fait pour installer confortablement le joueur habitué : les codes implicites du TPS sont parfaitement retranscrits et touchent sciemment au cliché, jusqu’aux personnages de notre équipe reproduisant à l’envi les gimmicks du « petit rigolo qui ne la ferme jamais », du « gros costaud pas causant » et du « chef avec juste assez de charisme et suffisamment peu de répliques pour qu’on se mette dans sa peau ». Les ennemis sont, dans cette première partie, inévitablement étrangers, ont le visage masqué, parlent exclusivement en farsi et placent immédiatement les « héros » dans une situation de légitime défense qui permet d’en tronçonner quelques wagons dans un confort presque mêlé d’ennui, tandis qu’on doit, comme dans tout bon jeu de guerre, aider des soldats américains encerclés (qui finiront tout de même par mourir pour ne pas encombrer le scénario) et secourir de pauvres réfugiés. Puis les ennemis deviennent les soldats « rebelles » du 33ème, convaincus que le commando de Walker est employé par la CIA, qui manipule les insurgés depuis le début.
On a reproché à Spec Ops : The Line la monotonie de ces combats, qui se réduisent à passer à la moulinette un nombre d’ennemis qui, à mon avis, excède largement les effectifs d’un bataillon en mission humanitaire. Or, où d’autre ont vu un point faible, il faut voir un procédé, un moyen pour une fin. On commence le jeu en abattant quelques insurgés parfaitement identifiables comme étrangers, non-américains, non-occidentaux, non-soldats-en-uniforme, et quelques heures plus tard on se retrouve à tuer par douzaine des ennemis qui nous ressemblent trait pour trait, uniforme oblige, et dont le seul crime avéré, à part essayer de tuer le joueur, est d’avoir tenté de sauver Dubaï malgré les ordres. Première dissonance. Alors que l’ennemi, dans tout jeu de guerre, se définit d’abord par sa non-occidentalité (dans le même sac, Arabes, Iraniens ou Chinois), sa non-adhésion à certains principes (les Nazis), ou par le fait qu’il représente une antithèse historique des Etats-Unis (les Russes/Soviétiques), ici on doit combattre des soldats américains qui nous renvoient un miroir de nos actions, puisqu’ils partagent les mêmes principes et les mêmes motifs que nous. Et la quantité et le caractère punitif des combats en fait rapidement des moments réflexes, qu’on essaie de gérer le plus rapidement et le plus efficacement possible pour ne pas être submergé. Qu’est-ce qui disparaît dans ce processus ? L’émotion. Là où l’on peut ressentir au début un certain dégoût à mitrailler, exploser, brûler vifs et ensevelir ses compatriotes et ses anciens camarades, on se surprend très vite à se convaincre et à se laisser convaincre que ces hommes qui nous ressemblent sont les nouveaux « méchants » du jeu, jusqu’à ce que celui-ci, arrivant par gradation dans l’horreur au bout de ce procédé, nous renvoie en pleine face les conséquences de nos actions. Toute la stratégie de Spec Ops : The Line est d’engourdir le joueur par des combats au rythme confortable, puis de le transformer momentanément en monstre et de lui tendre un miroir. Et il ne se gêne pas pour nous mettre aux prises avec ce qu’on a fait en se laissant bercer par son rythme et ses mécaniques : vers la fin du premier tiers du jeu, après avoir été témoin de l’utilisation de phosphore blanc contre les insurgés, on doit utiliser la même arme contre des soldats américains qui bloquent un passage que l’on doit ensuite traverser, observant de près non seulement les dégâts causés aux soldats, mais aussi aux victimes civiles qu’on a bombardé sans le savoir. Nouvelle dissonance. Même en se convainquant qu’on n’avait pas le choix, qu’on ne savait pas, que même en le sachant le jeu ne nous laisse pas traverser la zone à moins de tout incendier, il faut continuer à jouer avec en tête des images très nettes de ce qu’on vient de provoquer.
…sed perseverare diabolicum
Se retrouver nez-à-nez avec les victimes des dégâts collatéraux qu’on vient de causer, puis avec ce que nous ont fait faire des hallucinations de plus en plus envahissantes, et voir les évidences et justifications s’effriter puis s’écrouler, voilà ce que propose Spec Ops : The Line. Ces dissonances de plus en plus importantes entre ce qu’on doit faire et ce qu’on veut faire sont amplifiées par le jeu lui-même, qui, par la bouche des personnages, fait écho à nos propres justifications, et qui se permet en plus de nous rappeler dans certains écrans de chargements à partir du dernier tiers du jeu : « Souvenez-vous, rien de tout cela n’est réel » ou encore « Vous êtes quelqu’un de bien ». Mais en réalité, ces tentatives de justification restent vaines, puisque leur seul effet est de laisser apparaître avec encore plus de force l’acte lui-même, ce qu’on a commis, comme détaché de tout ce qu’on peut essayer d’en dire pour le justifier. Et le phénomène est encore approfondi quand, approchant de la fin du jeu, Konrad lui-même nous rappelle qu’on aurait pu s’arrêter à tout moment, qu’on a fait ce qu’on a fait, non parce qu’on y était obligé, mais parce qu’on a voulu le faire. Argument imparable, quand on le place dans la dernière scène de dialogue du jeu (ou peu s’en faut).
On s’aperçoit très vite que, loin des articles à sensation des médias de masse ou d’analyses boiteuses qui fourmillent sur la toile et à la télévision, les jeux de guerre, pour rendre la guerre jouable et donc « fun », sont à l’origine de leur propre système moral. C’est un code implicite du jeu vidéo, mais aussi de la guerre elle-même, que l’action du joueur d’un côté, et du soldat de l’autre, doit être justifiée alors même qu’elle serait criminelle dans la réalité de la société civile. Lors d’une vraie guerre, cette justification du meurtre de son prochain provient de son étrangeté géographique, morale, politique ou raciale, du fait que c’est cet étranger l’agresseur, et qu’on ne fait que se défendre, du fait que l’on participe à une « guerre juste » pour tel ou tel principe. Dans le monde du jeu vidéo où, bien sûr, ces meurtres ne sont que virtuels et ne portent pas, dans l’ensemble, à conséquence, l’action de tuer est justifiée, outre par l’étrangeté des ennemis, par des facteurs purement vidéoludique : la nécessité de faire avancer le scénario, de coller à l’image qu’on se fait de son personnage, notamment. Mais surtout, et c’est valable dans littéralement tout jeu où la moindre question morale est soulevée, les actions du joueur sont rendues légitimes par le fait qu’IL est le joueur. Quoi qu’il arrive, le joueur est le personnage principal, le Héros, le « Bon » par lequel se définissent, par opposition, les Brutes et les Truands, il est la mesure du bien et du mal dans le jeu, et ultimement il aura toujours raison, puisqu’il aura toujours ses raisons. De fait, c’est l’un des codes les plus profondément implantés que brise Spec Ops, et qu’il nous martèle jusque dans les écrans de chargement par des « Vous n’êtes pas un héros », auxquels fait écho le dernier dialogue avec Konrad, l’antagoniste de Walker, le Marlon Brando de notre Martin Sheen, qui nous accuse, entre autres, d’avoir « voulu être un héros » en dépit des circonstances, s’adressant non seulement au protagoniste, mais aussi au joueur lui-même.
Pour tirer une parallèle, là où Metro 2033 et sa suite, Metro Last Light, remettaient en question la pratique du meurtre virtuel et son intérêt ludique en récompensant (par un cheminement parfois plus facile et une fin alternative) le fait de traverser un niveau sans tuer quiconque, ou tout simplement de réfléchir avant d’abattre un animal qui n’est pas explicitement agressif, Spec Ops : The Line prend le parti inverse, et questionne le sens d’un jeu qui se réduirait à une suite de meurtres. Que fait de nous un tel jeu, même pendant quelques minutes, même virtuellement, même dans cette fiction qui n’est qu’une fiction ?
Mais choquer pour choquer ne serait pas suffisant, aussi Spec Ops : The Line ne se contente pas d’un va-et-vient entre les actions du joueur et ce miroir qu’il lui tend. Ponctuellement, dans quelques occasions, le jeu nous offre un choix, et nous autorise à remonter la pente ou à nous enfoncer. Après des heures de fusillades ininterrompues, on a soudain la possibilité de voir que, malgré la brutalité de ce qu’il passe son temps à nous montrer et à nous faire faire, il reste toujours un choix, une « Ligne » que l’on franchira ou pas entre l’humanité et la folie, entre la détresse et l’horreur. Celle-ci peut paraître vaporeuse dans un premier temps, mais ne cesse de se préciser. Le jeu se refuse à aller plus loin que nous montrer cette ligne, et montrer combien il est facile de la franchir. Tout le génie est là : il n’y a qu’un jeu vidéo et sa dimension interactive qui peut si bien ouvrir au seuil d’un choix plusieurs mondes possibles, offrant différentes lectures, et dont un seul va devenir effectif jusqu’à la fin de la partie, quand bien même le scénario lui-même reste inchangé jusqu’à la toute fin, où l’on pourra, en vertu des décisions que l’on a prises et de ce qu’on a vu et fait, choisir sa fin entre (au moins) trois possibilités.
Ce qui n’est pas remis en question, en revanche, ce qui apparaît comme une évidence et une affirmation fondamentale de Spec Ops, c’est que la Ligne existe. Elle est partout. Et chaque instant n’est qu’un choix dont l’une des conséquences sera peut-être de se voir la franchir sans espoir de retour.
***
Finalement, contrairement à ce qu’une certaine bien-pensance rabâche à longueur de JT, la plupart des jeux de guerre, même les plus populaires et les plus brutaux, sont dans leur grande majorité très convenus, et largement inoffensifs (à ceci près qu’ils prétendent parfois donner une image du monde assez bichromique), de la même manière que les films d’action à base de TNT et de grosses bagnoles. C’est précisément là leur défaut. Au contraire, Spec Ops : The Line, tout comme Apocalypse Now auquel il ne se prive pas de faire référence dans sa construction, dans certaines musiques et certains personnages, n’est pas inoffensif, et ne vous laissera pas intact. N’est-ce pas exactement ce qu’on doit attendre de l’art ?
6 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON