Transition écologique : nucléaire énergie verte
Certains, parmi les observateurs pro-nucléaires des débats de la COP21, ont pu s'irriter de voir "clean energies" traduit systématiquement en français par "énergies vertes". Certes la France n'est pas réputée pour sa maîtrise de la langue de Shakespeare, mais si l'énergie nucléaire est une énergie "propre" pour les anglo-saxons, l'erreur de traduction est excusable si le nucléaire est bien une énergie "verte". L'article ci-dessous témoigne que ses nuances de « vert » sont nombreuses ... et que l'écologie n'a pas à en « rougir ».
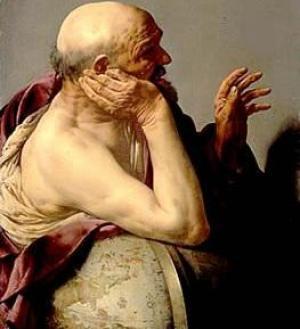
Déjà au matin de la philosophie, dans la Grèce antique, deux visions du monde s’affrontaient : pour Héraclite on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve et le monde est en perpétuelle évolution ; pour Parménide, auteur du poème « De la Nature », une seule vérité existe, immuable, celle de l’Être et de la Nature.
L’écologie moderne n'échappe pas à cette opposition Héraclite-Parménide. L’opinion écologique s’est opposée longtemps à l’énergie nucléaire, lui préférant le soleil et le vent, « verts » parce que naturels. S'il est proposé ci-dessous de donner raison à Héraclite, c'est sans fuir le dialogue avec la part de Parménide qui est en chacun de nous et en chaque lecteur.
Dès la fin de la dernière guerre mondiale, face à la dérive anthropocentrique du libéralisme et à l'insatisfaction consumériste, l’écologie propose un autre idéal . Après le "retour à la nature" des "bobos" en mai 68 puis avec les combats du Larzac pour une agriculture durable, l’écologie est associée à la couleur verte de la végétation de notre planète. Plongeant ses racines dans la recherche du paradis perdu, cette vision rassure le Parménide qui est en nous. Elle contient aussi une certaine méfiance face au progrès technique : vis-à-vis du nucléaire, cette méfiance a été alimentée par la complexité et le manque de transparence (réel ou ressenti) de cette industrie, et parfois aussi par le soupçon que l’importance de ses enjeux stratégiques et nationaux ait pu la placer hier au-dessus des lois et des contrôles réglementaires et démocratiques qui lui imposent enfin son excellence environnementale aujourd'hui.
C’est sur ces bases que fut votée en France en 2015 la loi « de transition énergétique pour une croissance verte ». Quelles énergies cache le mot « vert » ? Les premières citées sont souvent le solaire et l’éolien, même si biomasse et hydraulique produisent bien plus d’énergie primaire verte, en France comme dans le monde.
S'il suffisait d'être naturelle, l'énergie nucléaire serait « verte » sans conteste. C'est l'énergie naturelle la plus répandue dans l’univers, celle qui fait briller les étoiles et notre soleil et permet la synthèse des éléments chimiques qui nous constituent et à qui nous devons la vie. Mais si l’énergie nucléaire est bien « verte » au sens de naturelle, nos très sophistiqués réacteurs nucléaires ne sont, certes, pas plus naturels que les capteurs photovoltaïques et les éoliennes qui « fleurissent » dans nos paysages.
Mais, de la même façon qu’on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, l’écologie évolue. La vaguelette « verte » déclenchée par les lanceurs d’alerte d’hier s’est considérablement élargie, pour embarquer désormais sur sa gauche comme sur sa droite une majorité de citoyens qui ont choisi d’agir « vert » un peu plus chaque jour. Au point que beaucoup ne se reconnaissent plus dans les partis « verts », dépassés, et ne faisant plus recette auprès des électeurs. Heureusement cette désaffection des citoyens vis-à-vis des partis « verts » du passé n’est pas un signe de désaffection de l’écologie, mais au contraire un signe que l’écologie prend aujourd'hui une toute autre place. Non plus désormais ni politicienne, ni de droite, ni de gauche, elle est bel et bien un nouvel enjeu de l’humanité, à la fois culturel, politique, économique et sociétal.
Il convient donc de redéfinir l'écologie, ne serait-ce que parce que le monde doit faire face aujourd'hui à de nouveaux risques, ceux que rappellent l'encyclique Laudato Si' tout comme les experts de la COP21 : changement climatique, épuisement des ressources naturelles, expansion démographique, injustices sociales et tensions géopolitiques.
Désormais, nous proposons d'appeler « vertes » les actions permettant de créer le meilleur compromis écologique et énergétique en vue de prolonger la vie de l'humanité sur Terre dans les meilleures conditions.
Certes, ces compromis et conditions les « meilleurs » pour l'humanité ne doivent pas exclure la biodiversité, la beauté, la nature. En tout cas ils « subjectivent » cette définition de l'écologie. Ils invitent non seulement à remettre en cause nos convictions écologiques d'hier mais aussi à accepter que le « meilleur compromis » et les « meilleures conditions » d’aujourd’hui puissent être perçus différemment par les générations qui se baigneront dans le fleuve après nous.
De nombreux citoyens, certes discrets, partagent déjà l’idée que cette écologie moderne rime aussi avec nucléaire et que la peur du nucléaire est non seulement au-dessus de nos moyens mais aussi mauvaise conseillère pour créer le futur paysage énergétique durable, propre et équitable que nous laisserons à nos petits-enfants.
Et les raisons ne manquent pas pour que le nucléaire mérite l'appellation « verte ». Voici quelques unes de ses « nuances de vert » remarquables.
Le nucléaire est de loin l'énergie la plus compacte, celle qui « pollue » le moins nos paysages. Des éoliennes, des cellules photovoltaïques ou des installations hydroélectriques occuperaient 50 à 100 fois plus de kilomètres carrés pour produire annuellement la même énergie que nos 19 centrales nucléaires.
Le nucléaire est sobre en ressources naturelles. Son « combustible », l’uranium naturel, est abondant partout dans la croûte terrestre , avec une répartition géopolitique équitable garante des indépendances énergétiques des pays riches ou pauvres. En France plusieurs dizaines de mines d’uranium ont été exploitées, avant qu'on ne préfère s’approvisionner sur le marché mondial, moins cher, ouvert, abondant et sûr. Les océans contiennent suffisamment d’uranium dissous pour des milliers d’années de besoin de nos réacteurs présents et futurs.
Le nucléaire génère une quantité de déchets plus faible que la plupart des autres technologies électrogènes, éolienne et photovoltaïque incluses. Un exemple : le nouveau réacteur EPR nécessite 10 fois moins de béton que les socles des 3000 éoliennes de 2MW qui produiraient annuellement la même énergie, et même 30 fois moins si on ramène ce béton à l’électricité produite sur la durée de vie (25 ans pour les éoliennes, 80 ans pour l’EPR).
Quant aux déchets radioactifs, l'excellence et la rigueur de leur gestion et de leurs contrôles démocratiques et réglementaires, leur absence d'impact sanitaire sur les populations depuis des décennies, tout cela fait que les déchets, cités un temps comme le « gros défaut », sont devenus de fait une qualité du nucléaire, comparé aux autres sources d’énergie. Ce sujet des déchets nucléaires a été certes très déformé par le prisme médiatique qui agite des « problèmes » sans montrer les solutions. Les déchets nucléaires de haute activité ne font pas exception, ceux qui concentrent 95% de la radioactivité dans 0,2% des volumes : pour eux non plus on n'a déploré aucun accident de transport ni de traitement avec le moindre impact sur le public de ce pays. Ils sont vitrifiés et encapsulés, et, afin que les générations futures n’aient pas la contrainte injuste (ce sont nos déchets, pas les leurs !) et inutile de continuer à les surveiller en surface à notre place, ils est prévu de laisser décroître naturellement leur radioactivité dans GIGEO, un des meilleurs projets de protection géologique au monde. Dans 300 ans la radioactivité des déchets les plus dangereux, les fameux produits de fission, aura décru au niveau de celle d’un simple minerai d’uranium naturel ; pour quelques autres destinés aussi à CIGEO ça prendra certes quelques 10000 ans, pour ainsi dire une infime fraction de temps pour ce coffre-fort d'argile du Callovo-Orfordien étanche et stable depuis … 160 millions d'années. Cette réussite exemplaire de la gestion des déchets nucléaires devra servir de modèle quand il s'agira demain de traiter les déchets et poisons chimiques issus du photovoltaïque, de l’éolien et de leurs millions de batteries de stockage d’électricité.
Nucléaire, hydraulique et éolien sont les meilleures énergies vertes dites « bas carbone », rejetant sur leur cycle de vie 30 à 50 fois moins de CO2 par kWh que le lignite ou le charbon, et 10 fois moins que le solaire photovoltaïque. L’importante quantité d’énergie nécessaire à la fabrication des cellules solaires PV explique en effet ce triste paradoxe qu'il faudra entre 20 et 30 ans de fonctionnement à une cellule fabriquée en Allemagne ou en Chine installée en France pour faire simplement économiser le CO2 qui a servi à sa fabrication. Pour notre empreinte CO2 le nucléaire est bien plus vertueux que le solaire photovoltaïque, sans même compter la compensation de l’intermittence de ce dernier par du gaz. Certes le nucléaire civil, compte tenu de ses nombreuses qualités intrinsèques, n’a pas eu besoin de cet avantage carbone ni du réchauffement climatique pour s’imposer et se développer au siècle dernier, mais cet atout CO2 très « vert » du nucléaire, reconnu internationalement, est affiché comme une des principales motivations par tous les pays qui ont, depuis et malgré Fukushima, porté à 66 le nombre de réacteurs en cours de construction sur la planète fin 2015, un record depuis 25 ans selon l’AIE.
L'inconvénient de la radioactivité compense-t-il l'avantage CO2 du nucléaire ? Non. A la différence des effets climatiques planétaires causés par le CO2, la radioactivité du nucléaire et de ses déchets nucléaires ne perturbe pas les équilibres géologiques planétaires naturels, la Terre étant par nature des millions de fois plus radioactive que toute la radioactivité artificielle que l’homme pourrait créer ; la radioactivité artificielle n’est d’ailleurs pas différente, par sa nature et ses effets, de la radioactivité naturelle (à laquelle nous sommes tous 58 fois plus exposés, selon l'IRSN) ou de la radioactivité médicale (à laquelle nous sommes en France 41 fois plus exposés).
L’énergie nucléaire est quasiment la seule à avoir fait la preuve industrielle de la recyclabilité de 25% (dès aujourd’hui) et de 96% (demain) de ses combustibles « brûlées », pour en refaire du combustible neuf, ne laissant que 4% de produits de fissions comme déchets ultimes non-recyclables ! 40% de la flotte de réacteurs EDF recycle déjà la quasi-totalité du plutonium issu du retraitement des combustibles usés du parc français, sous forme de combustible MOX (Mixed Oxide). Cette qualité du nucléaire en fait aujourd’hui un champion de la très « verte » économie circulaire moderne.
En revanche, le vent, l’énergie solaire, hydraulique, géothermique, la biomasse sont renouvelables (même si les éoliennes, les capteurs, les barrages et les centrales ne le sont pas). Mais qu'attend-on pour généraliser le nucléaire renouvelable, celui des réacteurs nucléaires de génération IV ? Appelés surgénérateurs, ils produisent autant voire plus de combustible fissile qu’ils n’en consomment (n’est-ce pas la définition de renouvelable ?). Ces réacteurs ne sont pas un rêve. Leurs prototypes industriels ont déjà produit, en France et dans le monde, plusieurs milliards de kilowattheures injectés sur les réseaux électriques. Le nucléaire de 2040 sera donc « vert » aussi parce qu’il sera quasi-renouvelable, en tout cas durable pour des millénaires. C’est bien plus qu’il n’en faut pour attendre, vers la fin du siècle, le nucléaire de fusion et ses ressources quasi infinies.
En conclusion, notre loi de « transition énergétique » de 2015 qui prévoit de réduire la part du nucléaire dans notre électricité, de plafonner sa puissance, ou encore de gaspiller une électricité parmi les moins chères, les plus sures et les moins carbonées du monde, par l’arrêt prématuré de Fessenheim, cette loi est considérée par un nombre croissant d'écologistes citoyens comme un épisode « Parménidien » de notre transition énergétique et un retour inutile vers le passé. Mais, si on en croit Héraclite, rien n’est immuable, pas même une loi, et l’accord historique de la COP 21 pourrait bien modifier le cours du « fleuve » de notre transition écologique.
JLS, 30/01/2016
46 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON
















