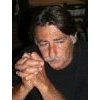Un bolchevick nommé De Gaulle
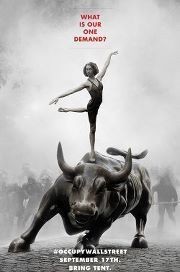
C’est vrai qu’aujourd’hui la télévision vous permet de dire n’importe quoi et que cela souligne, à travers une parole débridée, la médiocrité des élites qui la profèrent. C’est amusant, on peut broder sur cette exhibition d’incompétences, mais c’est surtout dramatique : il semblerait que pour certains - Copé est un bon exemple -, il s’agit de tout formuler de manière obsessionnelle et panique sur l’unique gamme qui, croient-ils, influe sur l’entendement : celle de la peur. Copé voudrait donc communiquer de la panique du fait que Montebourg préconise le contrôle du secteur bancaire et la séparation entre banques d’affaires et banques de crédit. D’après le secrétaire général de l’UMP, cette proposition nous ramène au temps préhistorique des bolchevicks sanguinaires russes. Il ne faut pas aller si loin : nous avons ici, en France, un bolchévique de taille qui, comme Montebourg, déclarait en 1945 : « Au point où nous en sommes, il n'est plus possible d'admettre ces concentrations d'intérêts qu'on appelle dans l'univers les trusts (...). Il faut que la collectivité, c'est-à-dire l'État prenne la direction des grandes sources de richesse commune et qu'il contrôle certaines des autres activités sans bien entendu exclure les grands leviers que sont dans l'activité des hommes l'initiative et le juste profit ». De Gaulle (c’est bien lui l’auteur de ces déclarations) ne s’arrêtait pas là : Oui, désormais, c'est le rôle de l'État d'assurer lui-même la mise en valeur des grandes sources de l'énergie : charbon, électricité, pétrole, ainsi que des principaux moyens de transport : ferrés, maritimes, aériens, et des moyens de transmissions, dont tout le reste dépend. C'est son rôle d'amener lui-même la principale production métallurgique au niveau indispensable. C'est son rôle de disposer du crédit, afin de diriger l'épargne nationale vers les vastes investissements qu'exigent de pareils développements et d'empêcher que des groupements d'intérêts particuliers puissent contrarier l'intérêt général ».
Il déclarait aussi à la même occasion (Assemblée Consultative du 2 Mars 1945) : « Rien ne serait plus fâcheux pour les réformes elles-mêmes et plus ruineux pour la nation que de prétendre proclamer des changements par les textes sans être en mesure de les appliquer ». Quand on pense au nombre de textes disparates, répétitifs voir contradictoires, votés ces quatre dernières années qui concernent la fiscalité, la sécurité, la justice, la santé ou l’éducation on ne peut que sourire à la manière toute bolchévique dont De Gaulle légiféra sur les banques : elles furent nationalisées un vendredi et lundi matin, pour éviter les réactions du « marché », le journal officiel publiait la loi. Par ailleurs, cette même loi établissait une étanchéité totale entre les banques de dépôt et les banques d’affaires.
On pourra toujours rétorquer que cela était du à l’environnement politique de l’après guerre ; Mais le général disait-il pas delà, en 1942 (discours à Albert Hall de Londres) : « Pour la France où le désastre, la trahison, l'attentisme ont disqualifié beaucoup de dirigeants et de privilégiés, et où les masses profondes sont, au contraire, restées les plus vaillantes et les plus fidèles, il ne serait pas acceptable que la terrible épreuve laissât debout un régime social et moral qui a joué contre la nation. La France qui combat entend que la victoire soit le bénéfice de tous ses enfants. A l'abri de l'indépendance, de la sécurité, de la grandeur recouvrée, elle veut que soient assurées et garanties à chaque Français la liberté, la sécurité, la dignité sociale. (…) De la sorte, « les nationalisations constitueront un élément de la mise en place d'un processus de production au bénéfice de tous les Français ».
Il ne s’agit pas ici de participer à un débat « pour ou contre les nationalisations ». Ni même, en passant, de souligner que pendant vingt ans, à travers les « noyaux durs » balladuriens on privatisa en France au profit d’un « pôle de copains » aux intérêts croisés, ce qui engendra une opacité qui n’avait d’égal que l’éloignement du concept d’intérêt général, mais aussi la fragilité du système bancaire actuel. Il s’agit tout simplement de dire qu’à d’autres moments historiques, les élites françaises n’ont pas accumulé les excuses pour ne pas répondre à la crise, n’ont pas considéré comme un tabou imbu de religiosité, une fatalité imparable, un quelconque système économique, mais qu’ils cherchèrent, tout simplement, l’intérêt général. Entre « faire » et « faire peur » se niche la trahison des clercs.
9 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON