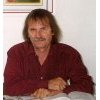Un Thomas Piketty têtu jusqu’à plus soif
Accessoirement, nous allons pouvoir constater que Thomas Piketty est tout à fait capable d'utiliser le mot de "production". Mais ce n'est presque que par erreur... Un peu comme un enfant qui s'inquiéterait : "Maman, as-tu fait le gâteau ?"
 D'où que vienne la production, et quoi qu'il en soit des conditions qui assurent sa présence, il préfère n'en retenir que ce qui suit :
D'où que vienne la production, et quoi qu'il en soit des conditions qui assurent sa présence, il préfère n'en retenir que ce qui suit :
« […] toute la production doit être distribuée sous forme de revenus - d'une façon ou d'une autre : soit sous forme de salaires, traitements, honoraires, primes, etc., versés aux salariés et aux personnes qui ont apporté le travail utilisé dans la production (revenus du travail) ; soit sous forme de profits, dividendes, intérêts, loyers, royalties, etc., revenant aux propriétaires du capital utilisé dans la production (revenus du capital). » (Thomas Piketty, op. cit., page 83.)
Vision très fraternelle de l'économie nationale...
Poser, après ce joli paragraphe, la redoutable question "Qu'est-ce que le capital ?" présente évidemment quelques risques. En effet, chez Thomas Piketty tout "revient" à tire-larigot. Et pour bien arranger les choses, voilà qu'il y a même des gens qui, tandis que les propriétaires apportent leurs capitaux, "ont apporté" leur travail... Ce qui fait que, pendant le temps de production, les uns et les autres peuvent aller boire un verre à la taverne la plus proche en attendant que ça se tasse tout seul...
Et pourtant, Thomas Piketty se refuse à tout mélanger, et sans doute n'a-t-il pas tort. Ça ne "revient" pas en effet tout à fait comme certains aimeraient à le croire, mais surtout à le faire croire, par conséquent :
« Tout d'abord, tout au long de ce livre, quand nous parlons de "capital", sans autre précision, nous excluons toujours ce que les économistes appellent souvent - et à notre sens assez improprement - le "capital humain", c'est-à-dire la force de travail, les qualifications, la formation, les capacités individuelles. Dans le cadre de ce livre, le capital est défini comme l'ensemble des actifs non humains qui peuvent être possédés et échangés sur un marché. » (Karl Marx, op. cit., page 749.)
Un paquet d'actions, par exemple, voilà du capital qui se respecte. Acheter un ouvrier, c'est plus difficile... Peut-on croire... Et ça peut même se démontrer tout de suite en utilisant ce très joli repoussoir que constitue l'esclavage. Thomas Piketty s'y engouffre comme tant d'autres, alors qu'il sait très bien qu'il existe un marché du travail dans toute démocratie méritocratique :
« […] le capital humain ne peut pas être possédé par une autre personne, ni échangé sur un marché, ou tout du moins pas sur une base permanente. » (Thomas Piketty, op. cit., page 83.)
On sent bien qu'il n'est pas très sûr de lui : "tout du moins". Mais la bouée de sauvetage était déjà là, quelques lignes plus haut, et il y remonte aussitôt pour s'y agripper :
« Sauf évidemment dans les sociétés esclavagistes, où il est permis de posséder de façon pleine et entière le capital humain d'une autre personne, et même ses éventuels descendants. Dans de telles sociétés, il est possible de vendre les esclaves sur un marché et de les transmettre par succession, et il est monnaie courante d'additionner la valeur des esclaves aux autres éléments de patrimoine." » ( Idem, pages 83-84.)
"Mais quel embarras !", faudrait-il ne pas manquer de dire ici...
Alors qu'il est bien plus simple de limiter la vente à ce qui fait le cœur de l'humain dans un contexte d'exploitation : le temps de mise en œuvre de sa force de travail. En dehors de quoi, il n'est plus question de prendre le moindre souci du reste de ses faits et gestes qui ne concernent plus du tout son patron. Sauf à ce qu'il le retrouve le lendemain apte à remplir ce qui est déterminé par le contrat de travail, dont on voit qu'il est là aussi pour "organiser" la permanence.
Permanence que briseront la mise en chômage, l'accident grave, le vieillissement... Toutes choses qui influeraient sur la valeur de revente de l'esclave, et qui, ici, n'atteindront ni le patrimoine du patron, ni celui de l'ensemble de la bourgeoisie que, pourtant, le salarié de base retrouve en permanence devant lui, ainsi que Karl Marx en fait la remarque dans "Travail salarié et capital" :
« Or le travailleur n’a qu’un revenu : il vend son travail ; il ne peut pas planter là la classe tout entière des acheteurs, c'est-à-dire la classe des capitalistes, sans renoncer à vivre. Il n'appartient pas à tel bourgeois ; il appartient à la bourgeoisie, à la classe des bourgeois. À lui de trouver son homme. À lui de mettre, parmi les membres de la classe bourgeoise, la main sur un acheteur. » (Idem, page 84.)
D'où, grâce au statut de salariat, une très sérieuse diminution de l'ensemble des frais d'entretien pour chaque employeur comme pour la collectivité des employeurs... On n'arrête pas le progrès.
En faisant intervenir le travail salarié et l'esclavage dans sa réponse à la question "Qu'est-ce que le capital ?", Thomas Piketty a effleuré le problème de la création de richesses. C'est-à-dire, en mode capitaliste de production, la question de l'extorsion de plus-value. Mais il se garde bien d'en venir à la production, y compris jusque dans cet endroit où il est censé définir le capital.
En conséquence, voici à quoi il aboutit, après avoir, à juste titre, refusé de sacrifier à la notion plus que bâtarde de "capital humain" :
« Le capital non humain, que nous appellerons plus simplement le "capital" dans le cadre de ce livre, regroupe donc toutes les formes de richesses qui peuvent a priori être possédées par des individus (ou des groupes d'individus) et transmises ou échangées sur un marché sur une base permanente. » (Idem, pages 81-82.)
C'est donc la propriété mobilisable sur un marché quel qu'il soit qui définit le "capital"... Autrement dit, dès qu'il y a possibilité de vente, il y a capital... D'aucuns penseraient qu'il ne s'agit là que de commerce... C'est-à-dire du parcours ordinaire de toute marchandise. Est-ce déjà du capital, selon Thomas Piketty ? Si oui, renvoyons-le sans plus de façons aux remarques que Karl Marx appliquait à quelqu'un d'autre dans l'Introduction dont nous ne cessons de parler :
« La marchandise dont Adam Smith s'occupe est, dès le départ, du capital-marchandise (qui, outre la valeur-capital consommée dans la production de la marchandise, renferme la plus-value), donc une marchandise produite sur le mode capitaliste, le résultat du processus de production capitaliste. C'est celui-ci qu'il aurait donc fallu analyser d'abord, ainsi que le processus de valorisation et de création de valeur qu'il implique. » (Idem, page 82.)
Mais nous savons que Thomas Piketty a décidé, lui, une fois pour toutes, de faire l'économie de la production. Il ne nous en parlera pas. D'ailleurs, le voici qui quitte déjà les considérations théoriques pour nous faire entrer très concrètement dans le vif de son sujet :
« En pratique, le capital peut être possédé soit par des individus privés (on parle alors de capital privé), soit par l'État ou les administrations publiques (on parle de capital public). » (Idem, page 83.)
Voilà donc un capital bien débonnaire... Il peut même s'alimenter auprès de tout ce qui ne marche qu'à coup d'impôts...
Mieux encore :
« Il existe également des formes intermédiaires de propriété collective par des personnes morales poursuivant des objectifs spécifiques (fondations, Églises, etc.), sur lesquelles nous reviendrons. Il va de soi que la frontière entre ce qui peut être possédé par des individus privés et ce qui ne peut pas l'être évolue fortement dans le temps et dans l'espace, comme l'illustre de façon extrême le cas de l'esclavage. » (Idem, page 83.)
Comme on le voit, Thomas Piketty ne peut pas s'empêcher de flirter de temps en temps avec l'exploitation du travail productif... mais ça ne dure jamais bien longtemps.
Et voici jusqu'à quelle aberration finit par conduire cette façon de définir un capital qui peut vraiment être tout et n'importe quoi, puisque arrivé, comme l'âne de Buridan, à la croisée des chemins, voici que Thomas Piketty aberre devant les vastes étendues qui pourraient sans doute devenir un jour, du fait de sa définition sans fin, du "capital" tout pur :
« Il en va de même pour l'air, la mer, les montagnes, les monuments historiques, les connaissances. » (Karl Marx, Œuvres, Économie I, Pléiade Gallimard 1965, pages 205-206. C'est K. M. qui souligne.)
Vous vous trompez, monsieur Piketty : de ce côté, il n'y aura éventuellement que de la rente issue de l'appropriation de ces éléments par les uns au détriment des autres. Or, pour que cette rente puisse exister, vous savez très bien qu'il faut qu'ailleurs l'exploitation par le capital fonctionne à merveille. Que n'avez-vous vraiment lu David Ricardo !...
Michel J. Cuny
7 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON