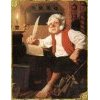Fédérations d’éducation populaire et Jeunes mineurs en associations. Quel impact sur leurs parcours ?
Entre éducation et participation, les différentes formes de sociabilités juvéniles ont du mal à exister dans les associations qu’elles soient de fait ou de droit, et même au sein de l’éducation populaire.
 Entre éducation et participation, les différentes formes de sociabilités juvéniles ont du mal à exister dans les associations qu’elles soient de fait ou de droit, et même au sein de l’éducation populaire.
Entre éducation et participation, les différentes formes de sociabilités juvéniles ont du mal à exister dans les associations qu’elles soient de fait ou de droit, et même au sein de l’éducation populaire.
Force est de constater que les instances de décision des associations sont aussi des lieux de pouvoir entre autres générationnels et que la rotation des fonctions - en dépit d’une rhétorique bien pensante- ,et le passage de relais en particulier en direction des plus jeunes,n’y sont guère pratique courante.
Les pédagogies nouvelles nous ont enseigné que la participation, en matière d’engagement des jeunes, n’a de sens que si elle est également représentative, donc garante d’une pluralité d’expressions favorables à l’émancipation de chaque individualité.
Les jeunes sont aujourd’hui moins politisés et plus protestataires, ce potentiel étant plus développé chez les jeunes scolarisés que les jeunes actifs.
Ils plébiscitent les associations. L’axe d’incitation des dispositifs publics demeure la participation au travers de l’initiative et de l’innovation, ainsi que le parcours individuel, cette tendance se renforçant dans le temps. Défi jeunes, créé en 1987 en est la parfaite illustration, jusqu’à sa fusion avec Envie d’agir créé en 2002, ces deux dispositifs touchant aujourd’hui des jeunes de 11 à 30 ans.
Les conseils de jeunes, plus anciens (années 1960), eux ne s’inscrivent pas dans un modèle unique de fonctionnement. On les retrouve à toutes les échelles de territoire, et on sait que leur principal défaut est qu’ils ne dépassent que très rarement le seuil de l’information et de la consultation des jeunes. L’instrumentalisation de ces instances à des fins politiques est malheureusement plus une généralité qu’une exception.
Le mode de désignation des jeunes dans ces instances, basés soit sur des élections, soit le volontariat, la qualité de l’animation et de l’accompagnement, sont à ce titre déterminant dans leur réussite.
C’est aussi pourquoi l’accompagnateur local dans le dispositif Junior Asso est la clé de la réussite des projets.
Son relais départemental, est un représentant d’une des fédérations d’éducation populaire membre du réseau national, qui habilite les projets (35 junior assos en 2002, 2332 en 2009).
Les jeunes concernés ont une moyenne d’âge de 15 ans, également répartis entre l’urbain et le rural, et 40 % sont des filles.
Thomas Rogé, un des fondateurs, s’interroge aujourd’hui sur une dérive gestionnaire du système, favorisant le quantitatif au détriment du qualitatif, et sur le fait que certaines "communes préfèrent créer un conseil de jeunes plutôt que de travailler sur le développement du vote chez les plus de 18 ans ou sur le rajeunissement du personnel politique." Il considère que les dispositifs, par ces écueils, finissent par écarter ces jeunes de l’opportunité "de la dynamique des grands mouvements" de la société.
Vincenzo Cicchelli souligne dans un article "combien ces dispositifs, associés à des représentations, des modalités de fonctionnement, des systèmes d’évaluation, sont susceptibles d’orienter les contenus de l’engagement, et de les mettre en forme".
L’amitié, le partage, la convivialité, sont les principales valeurs que les jeunes mettent en avant pour définir leur Junior Association.
En milieu rural la junior se créée souvent sur le constat de l’absence d’activité pour les jeunes, et se heurte dès sa création, à l’hostilité d’autres associations (comité des fêtes, association culture et loisirs) qui y voient une mise en cause de leur compétence.
L’enjeu de l’autonomie est évoqué par les anciens des junior assos comme un puissant levier d’apprentissage, car ils évoquent la "pression" mise par les adultes, ou les associations et institutions de leur environnement de l’époque. Ce qu’ils retiennent c’est que cette"pression", rarement accompagnée d’aide concrète, provoquait chez eux tension et confusion, et que c’est d’abord l’« entre-jeunes » qui a permis de surmonter ces freins et ces épreuves.
Composée d’entre 7 et 15 membres, la junior asso voit son lieu de réunion devenir aussi bien celui d’une institution locale (50%) que celui du domicile des membres (50 %), ses logiques sont diverses : le projet, le territoire, le groupe. Et on y trouve toujours, plus ou moins, chacune de ces trois préoccupations.
La logique de projet vise toujours à faire des jeunes des entrepreneurs. Cette forme « n’exclut pas une forme de leadership » et donc de concurrence, passe obligatoirement auprès du monde des adultes par la contractualisation, et se contente plus rarement de « coups de pouce » pour ce qui est des apports gratuits. La culture projet indique clairement aux jeunes, qu’en la matière, il faut être « professionnel ». Et paradoxalement ce que les anciens des juniors retiennent c’est que l’expérience associative acquise, dans un cadre « amateur » et par le tâtonnement expérimental cher à Célestin Freinet, leur a servi ensuite professionnellement, notamment en matière de prise de parole.
Celle de territoire enseigne très rapidement aux jeunes à faire la différence entre ce qui relève des taches ingrates et ce qui relève des « taches gratifiantes », ce qu’il faut concéder pour que les choses se fassent et qui constitue la vitrine publique de leur action, tout comme évaluer les enjeux de pouvoirs locaux qui en découlent. Car c’est ici la limite entre leur désir collectif et ce qui est négociable avec les adultes, les partenaires et acteurs du territoire.
Celle de groupe semble la plus équitable en terme de libre expression car comme le souligne Dominique Pasquier, « les barrières sociales sont moins importantes », les jeunes s’y reconnaissant dans un fonds commun, parce que solidaires et égaux dans leurs passions de jeunesse, que ce soit les jeux, le sport, la musique, etc. Le fait qu’ils soient tous cibles, et consommateurs d’une industrie culturelle qui ne fait pas de différence entre eux, les rapproche. Par ailleurs de nouveaux clivages sont en train de se reconstituer autour de l’impasse qui est faite à la mixité par les jeunes eux-même.
Le plus souvent les groupes éclatent après la fin des études et donc l’association aussi.
Éclairé par Corinne le Fustec, relais du RNJA et directrice de la FDMJC Côte d’Armor, les rôles de l’accompagnateur peuvent se définir ainsi :
- clarifier la demande et identifier les besoins,
- soutenir le démarrage et la dynamique de groupe,
- faciliter les contacts avec les partenaires, les personnes ressources, et les passerelles vers d’autres engagements.
Bien que la plupart du temps issus d’un cadre familial propice à l’implication associative les anciens juniors ne reste pas pour autant engagés associativement ou politiquement par la suite. Ils sont même une majorité à exprimer une certaine défiance vis à vis de la politique, tout en gardant plutôt un bon souvenir de l’expérience Junior Asso, et ne boudent pas pour autant les urnes, contrairement à la majorité de leurs pairs.
Le monde associatif veut bien des jeunes comme public mais pas dans ses instances, bien que la plupart des dirigeants soutiennent le contraire, c’est pourquoi ces deux mondes se tiennent traditionnellement loin de l’autre.
Projet, autonomie, responsabilité, sont un vocabulaire commun au dispositif Junior Asso et au monde de l’entreprise, cependant il convient aux adultes de savoir-faire la différence entre la sémantique de la citoyenneté et de l’émancipation et celle du management ou du marketing.
De plus, la propension à la « scolarisation » des engagements associatifs des jeunes ne doit pas s’écarter de l’objectif de faire avancer leur cause. L’accompagnement ne poursuivant pas les même objectifs que l’encadrement.
Dans une perspective réseau l’accent ne devrait-il pas être mis sur les processus de détection des groupes de jeunes en demande ? Par une approche neutre et transversale, donc en mobilisant des ressources dédiées uniquement à des taches de coordination. L’essentiel du travail à accomplir n’est pas tant en direction des jeunes concernés, mais plutôt des ressources réseau et partenaires qu’il faudra sensibiliser, mobiliser et préparer à la démarche Junior Asso.
Pour en savoir plus :
"Jeunes mineurs en associations. Quel impact sur leurs parcours ?", Injep, cahiers de l’action N°28, Stéphanie Rizet, 67 pages
9 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON