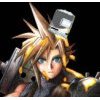Les recettes du père Bayrou
Cet article, qui a pour sujet une partie du programme économique du candidat François Bayrou, va traiter d’économie, en effleurant très légèrement les sciences économiques, mais sans rentrer dans le détail, et sans utiliser de jargon technique (du moins, pas sans l’expliciter) de manière à être compréhensible par tous. Évidemment, par la simplification on perd un peu de vérité. Et même en simplifiant autant que possible, la réalité est complexe, et tout discours simpliste est totalement déconnecté de la réalité, je vous prie donc de m’excuser si cet article est un peu lourd à suivre.
Il paraît - en tout cas c’est ce qu’on entend un peu partout à la télévision depuis le Ghandicon 3 atteint - que l’UDF n’a pas de programme. Bon, en même temps quand M. Strass-Khan nous raconte que ’’S. Royal fait campagne avec cent propositions, alors que F. Bayrou fait campagne sans proposition’’ *, j’ai bien envie de lui répondre que le PS ne propose que cent petites propositions d’une ligne chacune, et d’un ’’programme du PS’’ que la candidate a annoncé ne pas vouloir suivre, tandis que le candidat Bayrou met à disposition sur bayrou.fr ses positions et celles de son parti sur une bonne centaine de thèmes, chacun développé sur plusieurs pages.
En matière économique, puisque c’est à la fois mon sujet fétiche et celui que je considère comme le sujet principal, et de loin, qu’un gouvernement moderne est amené à traiter, il y a deux propositions, qui reviennent souvent dans les meetings et discours de F. Bayrou, que je trouve particulièrement ingénieuses. Deux propositions assez nouvelles en France, qui mériteraient vraiment d’être essayées, quitte à constater qu’elles sont inefficaces ou nuisibles et revenir en arrière en cas d’échec.
Il s’agit d’une part de lier les aides sociales et subventions aux revenus, et non à la nature des revenus jusqu’ici (c’est-à-dire qu’aujourd’hui les aides sociales vont systématiquement en direction des ménages vivant d’allocations et jamais vers les ménages vivant sur un petit salaire, quel que soit le montant des revenus. La proposition de l’UDF serait que les aides sociales soient accordées à ceux qui ont les revenus les plus faibles, que ces revenus proviennent d’allocations ou de la rémunération d’un travail.
D’autre part, l’UDF propose que chaque entreprise puisse créer ses deux premiers emplois sans charges salariales. On pourra rétorquer que ’’les allégements de charge pour les entreprises, on a déjà essayé, ça ne marche pas’’. Mais c’est passer à côté de l’originalité de la proposition de l’UDF, qui ne concerne pas les grandes entreprises, ni même les PME (abaisser leur pression fiscale est assez vain, il est inutile d’espérer atteindre des niveaux attractifs pour eux face à la concurrence des pays émergents. Il est beaucoup plus utile, pour attirer les grandes entreprises sur notre territoire, de proposer de l’emploi qualifié, donc de faire un effort sur l’éducation (tiens, c’est curieux, ça se retrouve aussi dans le programme de l’UDF). Cette mesure sur les micro-entreprises n’a donc pas pour but de maintenir en France des emplois existants (les grandes entreprises ne créent plus, ou presque plus, de nouveaux emplois en Europe. En économie, on apprend aussi qu’à partir d’une certaine taille une entreprise ne crée plus ou presque plus d’emploi du tout, nulle part, ce qu’une entreprise gagne en taille elle le perd en dynamisme), mais de créer des emplois qui n’auraient pas pu être créés autrement. Elle s’adresse principalement aux petits commerçants qui ne peuvent pas se permettre de prendre d’employés dans le système actuel, un bassin d’emplois potentiel qui a toujours été oublié dans les politiques économiques jusqu’ici, et, à mon humble avis, sous-estimé.
Ces deux mesures ne sont pas gratuites. Toute chose égale par ailleurs, la première proposition coûtera plus qu’elle ne permettra d’économiser, et la seconde générera un manque à gagner non négligeable. Mais le coût de ces deux mesures est relativisable : la première mesure a pour but d’inciter les actifs à rechercher un emploi, même peu payé, plutôt que de vivre sur des allocations. Ce qui signifie une double recette, puisque d’une part, bien qu’on augmente les dépenses en aide sociale, on diminue les dépenses d’allocation, et d’autre part on augmente la recette sur les impôts divers que l’on pourra prélever sur la personne ayant retrouvé un emploi, de manière directe (impôt sur le revenu, TVA...) ou indirecte (plus de consommation = plus de production, et la production est taxée). La deuxième mesure permettrait de créer des emplois qui n’existeraient pas sinon, là encore, cet argent sera investi dans la consommation (qui est taxée à environ 50% en cas de production nationale, et 19.6% de TVA + taxes de douanes + taxes induites en cas d’importation). Évidemment, ça ne suffira pas à annuler le coût de ces mesures (pour que la seconde soit gratuite, il faudrait qu’il soit créé deux fois plus d’emplois suite à cette mesure qu’il n’existe d’entreprises employant au moins deux personnes. L’impact de la première proposition sur le budget de l’Etat, en revanche, pourrait être neutre), mais les coûts de ces mesures restent faibles par rapport aux effets attendus.
Ce que je propose maintenant, c’est de s’intéresser aux effets de ces deux mesures sur l’économie, en utilisant des modèles économiques, c’est-à-dire des représentations de la réalité économique sous forme de petits schémas. Le but étant qu’ils soient compréhensibles par tous, ils sont très simplifiés et de nombreux paramètres ne sont pas pris en compte. Vous allez juste devoir me faire confiance lorsque je vous dis qu’ils n’ont probablement pas une influence assez forte pour remettre en cause les conclusions du modèle.
D’abord, il est nécessaire de préciser les différentes composantes du chômage. En économie on en distingue généralement trois catégories :
- Le chômage subi*, qui correspond à la situation d’un actif qui ne parvient pas à trouver d’emploi malgré une volonté de travailler.
- Le chômage choisi, qui correspond à la situation d’un actif qui ne souhaite pas travailler alors qu’il en a la capacité. C’est par exemple le cas d’un étudiant choisissant de se concentrer sur ses études, d’un investisseur qui préfère ne vivre que de ses rentes... Normalement le chômage choisi n’entre pas en compte dans les statistiques mesurant le chômage, et aucune allocation n’est versée. (contrairement au chômage subi).
- Le chômage frictionnel. Les modèles que je vais développer sont trop simplifiés pour pouvoir le prendre en compte. Je pense qu’il est tout de même important d’en dire deux mots : ce chômage-là, qui est comptabilisé dans les statistiques du chômage, est inévitable, et même souhaitable pour une question de bonne allocation des ressources. Il s’agit tout simplement du temps que met un actif à trouver un travail, lorsque du travail est disponible. Ce n’est donc pas vraiment du chômage, contrairement au chômage de longue durée, et dans une économie moderne il est évalué à 4%, voir 5%. Ainsi le taux réel de chômage en France n’est pas de 10% mais de 6% (Si on prend un actif au hasard, il n’y a en fait que 6% de chance que le travail correspondant à ses compétences n’existe pas, et non 10%). Le chômage frictionnel augmente donc naturellement avec la flexibilité du marché du travail, c’est pour cette raison que lorsque la flexibilité du marché du travail augmente, le chômage total baisse peu, ce qui fait glapir notre gauche française. Si l’on mesurait le taux de chômeurs de plus de trois mois, les conclusions seraient assez différentes.
Commençons d’abord, juste histoire de comprendre, par un cas d’école qui ne correspond plus à aucune réalité en France (mais est malgré tout assez proche du cas américain, où les protections salariales sont assez faibles).

Lorsque les salaires augmentent, les entreprises sont de moins en moins demandeuses de travailleurs (exemple : si le travail d’un employé rapportait 1200 euros à un employeur, il accepterait d’embaucher quelqu’un à un salaire de 1100 euros, il gagnerait 100 euros, mais n’accepterait pas d’embaucher à 1300 euros, puisqu’il perdrait 100 euros). A contrario, lorsque les salaires augmentent, les actifs sont de plus en plus incités à travailler (exemple : quelqu’un qui gagne 800 euros en aides sociales et allocations pourrait ne pas avoir envie de travailler pour 1100 euros, puisque ça ne correspondrait qu’à 300 euros de plus. Par contre, la personne y réfléchirait à deux fois si on lui proposait 1300 euros, 500 euros de plus). Le croisement des deux courbes indique donc le niveau de salaire pour lequel il y a autant de demandes d’emploi que d’offres d’emploi. Il s’agit donc du niveau de salaire qui sera appliqué en réalité.
Nous sommes ici en situation de plein emploi (c’est-à
- dire, dans le cas français, taux de chômage autour de 4% pour la raison
expliquée plus haut), il n’y a pas de salaire minimum, et donc beaucoup
de travailleurs pauvres. Ce n’est évidemment pas un cas souhaitable,
puisque ça signifierait qu’un grand nombre de travailleurs ne
gagneraient pas plus de 600 euros, et peut-être encore moins. Donc
beaucoup de travailleurs SDF.
Ajoutons une variable, le SMIC. En dessous du SMIC, il est interdit d’embaucher ou de se faire embaucher. Il s’agit donc d’une situation où le gouvernement crée un chômage volontaire, celui des gens qui seraient prêts à travailler pour moins que le SMIC plutôt que de ne pas travailler du tout. Il s’agit donc d’un chômage subi par le citoyen. En reprenant le dernier schéma, ça donne ceci :

Là, on arrive à une représentation à peu près cohérente de la situation française. On a représenté les deux facteurs indispensable à une bonne modélisation du chômage : le niveau des salaires et le SMIC. On pourrait ajouter d’autres facteurs, mais aucun ne modifierait vraiment la donne ou les conclusions, il vaut mieux rester là-dessus pour des raisons de clarté.
On peut faire une constatation intéressante : en faisant varier le SMIC (ce qui est dans le pouvoir du gouvernement), on fait varier le niveau de chômage. Essayez de faire monter ou descendre la barre grise (c’est à dire le montant du SMIC) pour en être convaincu. Mais définir le niveau du SMIC est un casse-tête sans solution. Si on l’augmente, on augmente le nombre de chômeurs. On augmente la quantité de gens qui souffrent, sont en situation de détresse, ont des conditions de vie physique inacceptable, un fort taux de mortalité qui n’est pas uniquement dû à un fort taux de suicide. Bref, la société ne peut pas tolérer ça, surtout pas la France qui se veut humaniste. Alors que faire ? On baisse le SMIC ? Il y a déjà beaucoup trop de smicards en France, et vivre avec un SMIC, c’est déjà pas facile. Il n’est pas non plus acceptable de baisser encore le niveau de vie de ceux qui sont déjà dans la misère malgré un travail, par ailleurs souvent pénible. (ce sont souvent les emplois les plus pénibles qui sont payés au SMIC). Alors, si les deux solutions sont inacceptables, comment définir ce SMIC ? Il n’y a pas d’autre choix que de trouver l’équilibre des inacceptables. Faire en sorte que les smicards vivent suffisamment mal et soient suffisamment pauvres pour qu’il n’y ait pas trop de chômeurs, et faire en sorte qu’il y ait un nombre suffisamment important de chômeurs pour que les smicards vivent assez bien.
Évidemment la gauche comme la droite ont leur point de vue sur le sujet. D’après N. Sarkozy, il faut faire baisser le chômage, d’après S. Royal, il faut augmenter le SMIC à 1500 euros. Évidemment, M. Sarkozy se garde bien de dire qu’il va faire baisser le SMIC, et Mme Royal n’as jamais eu non plus l’honnêteté de dire qu’elle allait faire augmenter le chômage. Et si N. Sarkozy se garde bien de parler du SMIC, S. Royal va encore plus loin en annonçant son intention de... baisser le chômage ! Et tant pis pour la réalité, on fera sans. De toute façon chacun sait que la réalité à un fort parti-pris anti-gouvernemental, et qu’il vaut mieux ne pas s’en préoccuper quand on fait de la politique.
Entendons-nous bien, souhaiter une augmentation du chômage et du SMIC, ou souhaiter une diminution du chômage et du SMIC sont deux positions qui se défendent. Et sauf à considérer que la situation actuelle est parfaite, l’une des deux solutions est forcément la moins pire. (laquelle est laissée à l’appréciation personnelle de chacun, il n’y a probablement pas de vérité unique sur ce sujet, tant les arguments ne manquent pas d’un côté comme de l’autre). Mais cette manière de nier ainsi la réalité, de faire croire à l’électeur qu’il existe une solution idéale alors que toutes les solutions auront leurs points négatifs, est détestable. Et je suis persuadé qu’il ne faut pas chercher plus loin la défiance des Français pour la politique, ou la montée des extrêmes. Les Français ont très légitimement le droit d’être déçus une fois l’élection passée, lorsque la réalité reprend son droit, si les politiciens ne font pas leur travail d’explication, de pédagogie, par rapport aux solutions qu’ils comptent mettre en oeuvre. Et ça vaut aussi pour mon candidat. Mettre en avant les points positifs des programmes qu’ils comptent adopter c’est une chose, passer totalement sous silence les conséquences moins positives en est une autre, et mentir explicitement sur les conséquences en promettant une amélioration là où la mise en oeuvre de la politique annoncée engendrera une dégradation en est une troisième.
Maintenant, je reviens aux deux propositions phares de F. Bayrou sur le plan économique. D’abord la proposition d’indexer les aides sociales sur le montant, et non plus la nature, des revenus. Il n’y a donc plus de manque à gagner que l’employeur doit débourser pour attirer un travailleur qui autrement ne jugerait pas l’augmentation de son revenu suffisant pour justifier la recherche d’un emploi. L’employeur dépensant moins par emploi, il sera incité, pour maximiser sa rentabilité, à embaucher pour un salaire un peu plus élevé, ce qui correspond à un déplacement vers le haut de la courbe d’offre, soit le schéma suivant :

Mécaniquement, il se produit un déplacement du point d’équilibre, ce qui se matérialise par une baisse du chômage. Histoire de distinguer les effets des deux mesures proposées, j’appelle cet effet là ’’L’effet Bayrou 1’’. On constate donc que sa proposition a bien pour effet, au final, de faire baisser le chômage sans avoir touché au SMIC.
Ensuite, il y a la proposition visant à exonérer de charges les deux premiers emplois. Ce qui signifie que pour une micro-entreprise, le coût réel d’embauche d’un travailleur baisse fortement, ce qui entraîne, toujours dans un but de maximisation du profit, une augmentation de la demande de travailleur/de l’offre d’emploi. Sur le schéma, cela se traduit donc par un déplacement, cette fois-ci vers la droite, de la courbe d’offre d’emploi.

A nouveau le point d’équilibre est modifié, et à nouveau cela se traduit sur l’axe des abcisses par une baisse du chômage, toujours sans aucune remise en cause du SMIC.
Ce sont donc deux mesures que je juge intéressantes et qui, j’en suis convaincu, valent la peine d’être essayées. Même si l’une comme l’autre sont un peu baroques et pas vraiment conventionnelles. Et elles sont loin d’être des ’’mesurettes’’ anecdotiques comme ce qu’une certaine personne qui se reconnaîtra prétend.
* : Je devrais lui proposer un poste de rédacteur sur mon blog, il a le niveau d’humour requis... Blague à part, c’est bien dommage qu’il ait si peu d’estime pour lui-même qu’il s’abaisse à hurler - barrir ? - avec la meute socialiste, j’espère qu’il aura tout de même sa place dans un gouvernement Bayrou une fois l’élection passée
** : Pour ceux qui ont quelques notions d’économie, il s’agit du chômage volontaire. Je l’ai ici renommé à cause de son nom trompeur, puisque le travailleur n’a pas volontairement choisi d’être chômeur.
PS : Excusez la pauvre qualité des images. J’ai pas photogimp, et ça se voit.
19 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON