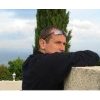Universités et prépas-grandes écoles : deux systèmes qui coexistent, mais qui ne se côtoient pas... encore.
Au traditionnel affrontement de ces deux mondes, et parfois à l’élargissement du champ de bataille entre le public et le privé, il semble qu’il soit grand temps de remettre à plat l’un des maux essentiel de notre société : la dualité malsaine de l’enseignement, en plus particulièrement de l’enseignement supérieur.
Avis de turbulences autour des grandes écoles et des classes préparatoires, leurs filières de recrutement ! Qu’on se le dise, les programmes présidentiels des candidats UMP et PS souhaitent que les meilleurs élèves de chaque lycée puissent accéder aux classes préparatoires... A priori louables et démagogues, ils jettent alors les premières pistes de réforme d’un système organisé en deux filières : l’une sélective, celle des grandes écoles et des classes préparatoires ; l’autre ouverte, celle des universités.
Pas besoin d’aller plus loin, l’erreur est déjà commise : au lieu de faire du système éducatif un système qui sélectionne des élites de filières, on conserve sous couvert de réforme de bonne conscience le système des filières d’élites.
La nuance peut sembler faible, mais elle change tout.
En effet, le système actuel prédéfinit ce que sont les filières d’excellence, assoit l’hégémonie des réseaux de grandes écoles et le triomphe des écuries de majors que constituent le quatuor Polytechnique, Ena, HEC et Ecole normale supérieure. Le système vous dit a priori ce que sont les élites, à savoir les écoles d’ingénieurs, les cadres de la fonction publique, les écoles de commerce, les médecins, les juristes, et marginalement, les chercheurs.
Pour les autres, soit environ 80% de la population française, talentueux ou pas, génies ou non, ce sera toujours la médiocrité, au mieux la bonne rémunération, au pire la galère.
Dans un système qui ne laisse pas de place à tous les talents, puisque la donne est déjà prédéfinie, et hormis quelques niches (écrivains, artistes, sportifs...), il n’est pas étonnant de constater l’absolue domination des élèves issus des grandes écoles aux postes de direction et autres postes stratégiques. Vous me direz que c’est l’élite, je vous dirai qu’a priori vous avez raison, mais que vous donnez une trop grande importance au titre « élève de » sans juger sur le terrain de la compétence réelle et de l’ouverture d’esprit, et par conséquent, qu’a postériori vous avez tort, gravement tort.
L’élitisme nécessaire après-guerre ne correspond plus à une société qui change, se diversifie et nécessite de plus en plus d’ouverture sur le monde, et principalement d’ouverture d’esprit. Ceci est d’autant plus vrai que cet élitisme coûte cher (on parle de ratios de 1 à 4 entre élèves de prépas et élèves d’universités (7500 euros par tête) , il suffit de comparer les heures de cours et le nombre d’élèves qui les suivent pour se faire une idée), et qu’il formate les profils à outrance. Cette machine à reproduire du « pareil » (9 % des élèves viennent de CSP modestes), nos candidats à la présidentielle souhaitent le saupoudrer d’une dose de bonne conscience en permettant à des élèves de lycées a priori plus faibles ou en ZEP d’accéder aux sacro-saintes classes préparatoires (hypokhâgne-khâgne, prépa HEC et Math sup-spé). Ils omettent d’ajouter que faire rentrer des profils plus « divers » n’occasionne pas forcément plus de sorties favorables de ces profils, et encore moins qu’ils ne soient pas eux-mêmes incorporés au moule, donc partie intégrante.
En voulant se donner bonne conscience, on ne change rien au système, on ne fait que colmater des brèches de plus en plus flagrantes.
La première brèche, c’est évidemment la déliquescence d’une université non autonome qui a pour obligation d’accueillir chaque année plus d’élèves (effet >80% de réussite au Bac) sans sélection aucune, et surtout avec des financements constants, voire à la baisse. Le tout avec des corps enseignants dont le métier est la recherche et accessoirement l’enseignement pour compléter leur rémunération au vu d’un service immédiat rendu à la collectivité.
Cette brèche, béante, arrive à un point de non-retour, d’autant plus que les mécanismes de sélection, lorsqu’ils existent (IUT-IUP, BTS), sont à la fois particulièrement probants et particulièrement efficaces pour rejeter dans des Deug sans contenus ni application l’ensemble des élèves qui n’ont pas été retenus et/ou qui n’ont pas tenté leur chance.
A l’époque, avec mes collègues d’université, on disait déjà : « La Fac, c’est l’école de la médiocrité sauf si... sauf si voilà ! »
La seconde brèche, flagrante, c’est la défaillance de l’enseignement au lycée, qu’il s’agisse du fond immuable et éternellement vieillot (l’histoire après 1960, ça n’existe pas, Mai 68, personne n’en parle, l’Algérie c’est inexistant, la chute du Mur de Berlin et du bloc soviétique, un vaste flou, car trop récent, il paraît). Cette défaillance est d’autant plus forte que l’essentiel des efforts financiers va aux lycées (un élève de lycée, et même de collège coûte plus qu’un élève de fac, c’est pour dire...) et qu’en plus, l’orientation est inexistante.
Le « généralisme ambiant » complété par l’élitiste filière scientifique ont tendance à occulter les choix d’orientation spontanés.
En tassant les élèves, en refusant les redoublements, en leur occultant l’orientation, on suggère à des générations complètes le fait qu’elles pourront toutes accéder à l’université ainsi que par la suite à des postes de cadres. Et si ce n’est pas l’université, ce seront les grandes écoles, et si ce ne sont pas les grandes écoles, alors ce sera autre chose, tant que cela est côté et qu’a priori il y a des débouchés et de bonnes rémunérations.
A priori bien sûr, le temps que l’illusion s’estompe et que la réalité ramène sur terre une inadéquation évidente des formations avec le monde du travail, et plus encore une paupérisation rampante des jeunes, de plus en plus utilisés comme variables d’ajustements, marges et prétextes pour les « bons à tout faire qui espèrent mieux pour après » .
Quid alors de l’information, de l’aiguillage, de l’orientation ?
Rien, si ce n’est de beaux tableaux de statistiques tous plus lustrés les uns que les autres en complément de CIO et autres CDI où on lâche les futurs apprenants face à l’océan informe de choix improbables et peu lisibles.
La faille de l’orientation s’est d’autant plus creusée que deux courants a priori opposés ont agi dans le même sens, à savoir les enseignants en distillant « vous irez tous à l’université », et les cadres en forçant leur progéniture à réussir au moins aussi bien qu’eux.
Mécaniquement, 80% de réussite au Bac, 40% d’une génération à Bac+5, c’est évidemment trop pour des marchés sur lesquels il n’existe fondamentalement que 10% de postes cadres. La conséquence immédiate qui en découle est évidente : par absence de sélection et d’orientation, ceux qui arrivent au bout se sentent déclassés ( parce qu’à quatre personnes pour une place, ce n’est pas celui qui sera le plus doué qui l’aura, mais celui qui aura le meilleur réseau).
Les trois restants goûteront pleinement à l’injustice d’un système (nivellement par le bas) qui ne leur a volontairement pas dit la réalité et qui les a laissé pourrir par le temps dans des filières sans lendemain voire carrément sans débouchés, et encore moins à l’international (champ de focale restreint au franco-franchouillard peu exportable ailleurs).
Pas étonnant de constater dans ce contexte que les filières publiques aient le vent en poupe : ce sont les seules qui valorisent « au réel » les années d’enseignement post-Bac lors des concours ! Le tout sans trop poser de questions et en dispensant des formations.
La troisième faille, et c’est la faille de l’espoir, c’est le contenu des formations.
Sur ce point, les universités ont fait énormément avec très peu : les IUT, IAE et autres IUP ont acquis leur lettres de noblesses par la sélection et le taux d’embauche en sorties. Les licences professionnelles suivent le pas, du reste.
En face, les classes prépas (75 000 étudiants), immuables, ont continué inlassablement à dispenser des cours scolaires où seul le bachotage intensif a été et demeure valorisé. Les contenus, eux, restent toujours articulés autour des langues (leur force), des maths théoriques, de la culture générale et de l’histoire économique.
Le bachotage intensif n’ayant pour but que d’amener des chiens savants à déverser leur « savoir » le jour des concours d’entrées aux grandes écoles et à ensuite à bénéficier toute leur vie du titre acquis lors de cette journée de recrachage. Certains diront que c’est la rémunération du sacrifice : en France on aime les sacrifiés.
Néanmoins, de plus en plus, les effectifs des prépas stagnent, car les étudiants n’ont plus envie de donner une part de leur vie, alors que d’autres voies plus professionnalisantes existent : en effet des passerelles ont été jetées de l’université vers les grandes écoles. De plus, le sacrifice n’a de sens qui si l’école obtenue est de haut rang, sinon, c’est la soupe populaire, comme les autres.
La quatrième faille se trouve plus haut en études, là où on ne l’attendait pas : les grandes écoles souffrent de leur non-lisibilité à l’étranger, de la profusion de diplômes sans équivalence et de leur non-contrôle des diplômes de recherche.
La recherche et l’adaptation des filières (DESS, Master, IAE...) sont les deux clés qui peuvent redorer l’image d’une université noyée sous la masse des défis qu’elle a à relever. Parallèlement, les grandes écoles sont des établissements qui ont fait leurs preuves et génèrent du fait des moyens concentrés et investis, des profils de grande qualité mais qui ne peuvent rester éternellement à part.
Protégées jusqu’alors par la création d’un système parallèle fondé sur l’effet du « trustage » des postes clés, par les réseaux d’anciens, l’image de marque des écoles et plus encore les financements croisés entre grandes écoles et entreprises (via taxe d’apprentissage entre autres), les grandes écoles ne peuvent plus se mouvoir dans des murs de plus en plus étroits et une demande de plus en plus forte pour répartir équitablement des financements sans commune mesure avec l’université (cela est d’autant plus vrai en année finale d’études).
L’ensemble de ces failles (on pourrait en trouver d’autres) tend à un vital rapprochement entre deux mondes qui se sont trop longtemps opposés, et par conséquent par l’intégration des grandes écoles aux universités.
Il devient ainsi nécessaire de composer des universités de région ou d’agglomération, dotées de l’autonomie de gestion et à diplômes nationaux reconnus à l’échelle de l’UE, se spécialisant dans des filières de compétences et gagnant en savoir-faire afin d’être compétitives au niveau international. Pour ce faire, universités et écoles doivent partager des diplômes communs, avec des enseignements communs, ce qui revient à dire partager les enseignants ainsi que les ressources financières pour ne plus considérer deux mondes qui ne se côtoient pas, mais deux mondes qui collaborent et investissent pareillement sur les élèves, suivant leur niveau d’études et leur spécialité.
La compétition entre universités et écoles n’a plus lieu d’être à l’échelle française : c’est leur coopération qui les rendra compétitives au niveau international. A défaut, elles n’occuperont toujours que les queues de classement et seront toujours médiocres au-delà des frontières.
Il convient alors de réformer les modalités de versement et d’attribution de la taxe d’apprentissage auprès des universités de région ou d’agglomération qui seront les seules à même de disposer des enseignants et de composer avec les forces des deux systèmes, qu’il s’agisse de l’enseignement de Bac à Bac+2/3, des spécialisations de Master ou de la recherche. Pour cela il faudra une volonté présidentielle et nationale claire, contraignant les écoles à « lâcher du lest » et les universités à booster leurs volumes horaires, contenus, réseaux de partenaires et sélections.
La réforme LMD européenne ouvre la voie pour incorporer progressivement les classes préparatoires en université, en renforçant les horaires et contenus de cours, en renforçant la répartition des financements et en sélectionnant par filières de compétences, ceux qui peuvent prétendre aller à l’université et ceux qui doivent suivre d’autres études (BTS) ou rentrer sur le marché du travail avec d’autres atouts (d’où la nécessité d’orientation au préalable et de revalorisation des métiers manuels et artisanaux entre autres).
L’imbrication (et les partenariats) des laboratoires de recherche et filières professionnalisantes avec les tissus d’entreprises / collectivités locales doit permettre à terme de tisser des réseaux d’anciens élèves pour mieux répondre à l’adéquation « formation supérieure - monde du travail » aujourd’hui défaillante. De plus, le financement privé doit être autorisé, principalement pour la constitution des savoirs enseignés ainsi que pour l’encadrement professionnel (conditions de stage, conditions d’enseignement), mais contrôlé étroitement (plafond de 30%) pour ne pas créer des filières assujetties à des lobbies en place.
Face à ces enjeux cruciaux, les deux poids lourds que sont le PS et l’UMP ne cherchent pas à résoudre le problème, mais plutôt à en contourner les épines, épines qui sont évidemment le cœur de l’enjeu (voir l’article du Monde du 17/11/06 http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-834658@51-834864,0.html)
- L’UMP souhaite « privatiser » les universités, créant une encore plus grande distorsion sociale tout en préservant les prés carrés des prépas-grandes écoles dont ils sont issus mais incitent à la sélection (dont on sait qu’elle sera biaisée).
- Le PS souhaite quant à lui esquiver les questions qui fâchent, en donnant l’université en pâture aux grandes écoles sans échange réciproque ou bien en créant du doublon pour répondre finalement à la question posée. Il s’agit (idée de Laurent Fabius) "sur le modèle des écoles normales supérieures, de faire en sorte que tout élève de grande école suive une partie de ses cursus à l’université, de créer au sein même de l’université des classes préparatoires" et de "multiplier les voies d’accès aux grandes écoles après un premier cursus universitaire". Ségolène Royal parle aussi de grandes généralités saupoudrées de compensations financières (comme le RMI qui dédouane de la conscience le fait de laisser des gens dans la misère ou bien de leur laisser le droit d’en abuser), mettant en avant un " objectif de synergie entre les établissements d’enseignement supérieur", avec, à la clef, pour ceux qui acceptent de jouer le jeu, des "incitations financières".
Dans les deux cas les propositions ne résolvent pas les questions de fond et finalement tendent à produire les mêmes résultats de défaillance que l’on constate depuis trop longtemps. Faudra-t-il encore attendre pour voir un jour un esprit rationnel clarifier un système dual unique au monde et dont on sait tous les effets pervers ?
Jusqu’à présent les grandes écoles et leurs réseaux, tétanisées à l’idée d’hériter des maux de l’université républicaine - l’école du peuple, l’école les grandes écoles et leurs réseaux, tétanisées à l’idée d’hériter des maux de l’université républicaine - l’école du peuple, l’école de ceux qui réfléchissent par eux-mêmes et l’école de ceux qui croupissent en amphis le temps qu’ils puissent enfin s’exprimer- , avaient toujours réussi à tenir à une certaine distance les universités.
Le temps et la future présidence seront-ils en mesure de les faire changer d’attitudes ?
C’est l’un des trois paris cruciaux à relever en 2007, avec celui de l’environnement et celui des institutions.
34 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON