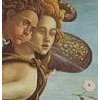Erreurs médicales et aléas thérapeutiques
Les erreurs médicales font la une des médias plusieurs fois par an. Mais derrière ces quelques cas médiatisés toujours choquants pour l’opinion publique, il existe des milliers de cas moins spectaculaires mais tout aussi traumatisants pour les patients et le corps médical. L’immense majorité des dommages causés aux patients par les pratiques médicales ne relèvent pas de l’erreur, mais de l’aléa thérapeutique. Je m’explique.
L’erreur médicale est causée par un acte réalisé lors d’une procédure diagnostique ou thérapeutique. A la différence de l’aléa, elle aurait pu être évitée par le praticien en l’état des connaissances actuelles de la médecine et en fonction du dossier médical personnel. L’absence d’un acte médical peut aussi occasionner un dommage. Il faut encore distinguer l’erreur volontaire qui relève du droit commun et de la psychiatrie, voire, dans de rares cas, du combat idéologique (la pratique de l’euthanasie dans un pays qui l’interdit). Il y a le plus souvent une erreur involontaire par insuffisance de connaissance médicale ou par méconnaissance du dossier. Par exemple, le praticien prescrit de la pénicilline alors que le dossier médical mentionne une allergie à cette molécule.
A côté de ces cas, peu fréquents et toujours condamnables, il existe les cas de dommages corporels ou psychologiques dus à la technique elle-même, sans que les règles de l’art médical n’aient été enfreintes. Reprenons l’exemple de l’allergie à la pénicilline : comment rendre responsable le praticien d’une réaction allergique, alors que le patient n’y avait jamais été exposé ? Il est impossible de tester toutes les molécules prescrites à un patient pour démontrer leur innocuité dans le cas particulier de ce patient. La réaction à un médicament qui a passé les filtres des agences internationales est individuelle. (Je n’aborderai pas ici la responsabilité lors de la mise sur le marché de nouveaux médicaments qui prennent en compte l’intérêt du plus grand nombre). Il en va de même pour les procédures diagnostiques ou thérapeutiques autres que médicamenteuses. Ces dernières procédures sont principalement des actes chirurgicaux de plus en plus souvent sujettes à réclamation. Même lorsque toutes les précautions ont été prises, il y a des complications inévitables. C’est le risque incompressible, mais qui est estimé moindre que le risque de laisser évoluer la maladie sans intervention. C’est l’aléa thérapeutique.
Et pourtant, même dans ce cas, le patient subit un dommage. Le lien est vite fait avec la procédure diagnostique ou le traitement prescrit. La société de victimisation et de responsabilisation qui est la nôtre aura vite fait de transformer le médecin en bourreau. Pour peu que celui-ci adopte une position défensive maladroite, dictée par le manque de formation à ces situations conflictuelles ou imposée par son assureur, le sentiment d’injustice nait immanquablement dans l’esprit de la victime ou dans celui de sa famille. Cette réaction est légitime, comme l’est l’incompréhension du médecin qui, à la suite d’un acte posé pour sauver la vie d’un patient, se retrouve soumis aux pires accusations.
La grande majorité des affaires portées en Justice par des patients pour dédommagement est consécutive à un aléa thérapeutique. Quel que soit le résultat d’une telle démarche, elle entraîne un traumatisme dans les deux camps, un sentiment d’injustice dans le camp du perdant mais aussi une débauche de moyens financiers pour démontrer la faute, pour démontrer l’absence de faute, pour estimer le dommage et enfin pour indemniser le dommage. Les lenteurs de la Justice, la complexité des procédures judiciaires et l’implication émotionnelle ajoutent au gâchis généralisé.
L’autre victime de la course à l’indemnisation est la caisse d’assurance invalidité. Si les primes d’assurance augmentent dans les proportions américaines, les praticiens n’auront d’autre solution que de répercuter la hausse sur le prix des prestations. Suivra un déséquilibre du budget des soins de santé, déjà précarisé par la hausse inéluctable du prix des nouveaux médicaments et des nouvelles procédures diagnostiques et thérapeutiques sophistiquées. La conséquence déjà palpable est la médecine dite défensive. La multiplication des examens préopératoires inutiles, juste demandés pour mettre leurs résultats dans le dossier au cas où, la pratique de la césarienne au détriment de l’accouchement par voie basse, l’hospitalisation de confort pour observation sont des pratiques coûteuses qui pourraient s’imposer. Ces dérives existent aux USA, ce qui participe à faire de la médecine de ce pays l’une des plus coûteuses au monde, sans améliorer la qualité de la prise en charge des patients.
Il existe pourtant des solutions. L’une d’entre elles est la responsabilité sans faute. Un projet de loi est étudié en Belgique par le gouvernement fédéral afin de légiférer dans ce domaine. Le patient est reconnu comme victime, mais le praticien est blanchi de la faute, tout en gardant la responsabilité de l’acte presté. Cette procédure ne suspend pas la responsabilité pénale du praticien dans les cas d’erreur volontaire. Il ne s’agit pas de donner un blanc-seing aux médecins psychopathes, mais bien de combiner le respect du patient et la reconnaissance de la qualité du praticien, même dans les cas où il y a dommage imprévisible. Le patient est alors indemnisé rapidement par une caisse alimentée par les assureurs à partir des primes versées par les médecins, par les hôpitaux, et par de l’argent public sans devoir passer devant les tribunaux. Les frais et les délais d’indemnisation sont diminués. Un comité composé de représentants des patients, des assureurs, des médecins et des pouvoirs publics statuerait sur chaque situation individuelle. Bien sûr, les avocats et les experts en dommages corporels sont perdants, mais l’équité est respectée.
En conclusion, je voudrais insister sur le point important de toutes ces considérations : le patient doit rester le centre de nos attentions avant, pendant mais aussi après toute procédure médicale. Il est donc normal qu’il puisse bénéficier d’un dédommagement dans les cas où il subit un désagrément significatif d’une telle procédure. Mais le médecin ne peut pas être rendu coupable d’une complication imprévisible. Il faut donc éviter, autant que faire se peut, les retards d’indemnisation et les mesures, ressenties comme vexatoires, d’une procédure judiciaire. Dans tous ces cas, nous assistons à de véritables naufrages psychologiques et à de véritables faillites humaines, tant dans le chef du patient que dans celui du personnel soignant. L’empathie nous guide dans notre quotidien et nous ne pouvons que souffrir de telles situations.
31 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON