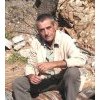Logement : ce que nous n’avons pas fini de payer
Au début des années 1980, résident à Paris, j’ai fait la connaissance d’un Tunisien sans papiers qui faisait la plonge dans un restaurant des Grands Boulevards et qui vivait dans une chambre de bonne, près de la Madeleine, donc pas très loin de chez Fauchon... On ne peut pas dire que le logement était de grand standing,. Chambre mansardée, lucarne donnant sur un coin de ciel pas terrible, peinture douteuse, WC dans l’escalier, avec un coin cuisine à l’avenant. Pourtant, cet ami était plutôt content de vivre là. Pas de contraintes spéciales pour rentrer chez lui le soir, pas d’insécurité (eh, oui... les immigrés peuvent en être aussi les victimes), pas de voisins bruyants ou importuns, pas de temps sacrifié dans les transports en commun, sans parler d’un environnement qu’il était le premier à qualifier de plaisant, et même d’exceptionnel, et qu’il faisait découvrir avec fierté à tous ses amis.
Depuis, les différentes lois (Méhaignerie, Besson, entre autres...) qui ont réglementé le logement en France, lois votées tant par la droite que par la gauche, ont fait que cet habitat « précaire » mais particulièrement adapté à une population non encore enracinée dans sa société d’accueil, a lentement mais sûrement disparu, dans sa totalité, emporté par un souffle de spéculation immobilière sans précédent dans l’histoire de l’urbanisme en France, exception faite du Second Empire. Mais ne jetons pas trop rapidement la pierre à ce cher baron Haussmann, pour nous donner bonne conscience à peu de frais. Le Paris que nous aimons tous aujourd’hui, et dont certains moralisateurs profitent sans pudeur, dans les grandes lignes, c’est quand même le sien.
Il n’est pas nécessaire de refaire ici ni l’histoire ni le bilan de ces années fric-à-dégueuler qui ont caractérisé le marché de l’immobilier dans l’hexagone, durant la seconde moitié de la décennie 1980 et au-delà. Quelques mètres carrés achetés le matin moins de 2000 F l’unité pouvaient se négocier trois ou quatre fois plus, avant le soir, sur une simple promesse de vente. Il paraît que ça s’appelle la loi du marché...
La seule question qui vaille la peine d’être posée aujourd’hui, maintenant que le mal a été fait, c’est pourquoi, quand ces diverses lois de libéralisation du secteur locatif ont été votées - tant par la droite que par la gauche, répétons-le - personne n’a élevé la voix pour alerter l’opinion publique sur ce qui n’allait pas manquer d’arriver si l’on éradiquait cet habitat dit « de transition » ? Un habitat qui, durant des décennies, avait assuré une mixité certaine dans la plupart des grandes villes. Alors, pourquoi cet assourdissant silence ? Les « décideurs » de l’époque devaient quand même bien savoir qu’une fois entamée, la disparition de ce type de logement serait définitive et que personne ne pourrait jamais revenir en arrière pour réparer la mise à sac opérée par les spéculateurs venus de toute la France, mais aussi de l’Europe entière et d’outre-Atlantique. Les services d’urbanisme de la ville de Paris et de la proche banlieue feront-ils un jour le bilan des surfaces d’habitat populaire (plusieurs milliers) qui ont été vidées de leurs occupants « précaires » et transformées du jour au lendemain en appartements de standing ou en duplex, sous les toits de Paris ? Serait-ce parce qu’une bonne partie de ces « décideurs » aux dents longues, sortis pour la plupart d’un même moule, a fait quelques opérations bien juteuses à l’occasion et que, grâce à leur plus-values, ils ont pu lorgner un peu plus tard plus aisément du côté du pays de Caux ou du Luberon, avec l’oreille complaisante de leur banquier ?
Ils se sont gavés ? On s’en fout ! Le crime, c’est le silence. Car ce silence, nous le payons très cher aujourd’hui encore dans les quartiers dits « en difficulté » et dans ces bidonvilles normalisés que sont les grands ensembles construits à la va-vite, à la fin des années 1960. Grigny... Grigny... Quelle blessure... Un véritable crime contre l’humanité... Et ce silence, nous n’avons pas fini de le payer.
Le fait d’avoir ainsi vidé nos villes d’une frange d’une population par définition instable (mais l’instabilité est-elle réellement une tare, à part du point de vue des « assis » ?), une population qui trouvait le minimum décent dans ce type d’habitat, a eu pour conséquence de jeter à la rue des dizaines de milliers de personnes qui n’avaient pas les moyens d’intégrer les nouvelles normes du circuit locatif, mis en place par les banques et les autorités politiques de ce pays pour le plus grand profit des rentiers. Résultat : des sans-abri un peu partout, les Resto du cœur (financés parfois par ceux-là mêmes qui avaient imaginé et voté ces lois scélérates) et le cycle de la misère qui en a découlé.
Est-il besoin de souligner qu’une frange importante de la population immigrée a été touchée de plein fouet par cette politique de « rentabilisation » forcenée ? Et sans qu’il lui soit possible de pouvoir envisager un quelconque recours. Les premières vraies manifestations du déficit d’intégration que connaît la France aujourd’hui n’ont-elles pas commencé à ce moment-là ? Quand on met quelqu’un à la rue, il est quand même surprenant de lui demander dans la foulée de s’intégrer...
La crise du logement, en fait crise de l’habitat moderne, ne peut trouver un début de solution qu’en définissant de nouvelles normes de mixité au cœur de nos villes. Est-ce encore possible ? Oui, si nous acceptons de ne pas plier devant les seules lois du marché et de la rentabilité, et si nous étudions de nouveaux concepts architecturaux permettant d’intégrer, à l’intérieur d’un même bâtiment, des logements aptes à offrir un niveau de prestations différent. Non, si nous nous contentons d’un replâtrage de façades (on a fait ça depuis plus de vingt ans). Car dans ce cas, nous n’en aurons jamais fini de refouler loin de notre regard ceux qui, par nature, sont les plus fragiles. Mais une telle politique (propre à hérisser le poil d’élus locaux adeptes de la « pureté sociale ») implique que cette mixité soit aussi synonyme de fluidité culturelle et non de ghettoïsation. La chambre de bonne, c’était la plupart du temps au 7e étage ; il fallait souffler un peu pour l’atteindre, mais en tous cas, ça obligeait des gens de toutes conditions et toutes origines à se dire bonjour dans l’escalier, et parfois même à s’aider à monter le sac des commissions. Patrick Adam
10 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON