La prochaine révolution en génétique a commencé
Un fort remarqué billet scientifique écrit par Carl Zimmer vient d’être publié dans le NY Times. Voilà bien deux décennies que les médias parlent des gènes en s’adressant au grand public, annonçant que le gène responsable d’une maladie a été identifié. Du coup, la notion de maladie génique est devenue courante, comme du reste son corollaire en matière médicale, la thérapie génique. Du point de vue conceptuel, la maladie génique est triviale, comme du reste la thérapie génique si aisée à expliquer dans les médias moyennant quelques croquis animés. Mais dans le concret du laboratoire, les choses ne se déroulent pas aussi simplement et le gène n’est pas l’élément aussi évident qu’on a pu croire pendant quelques décennies. C’est justement la remise à plat du rôle et de la définition du gène dont il est question dans ce très intéressant et détaillé article du NYT. Que je vais commenter en le recadrant dans une perspective élargie.
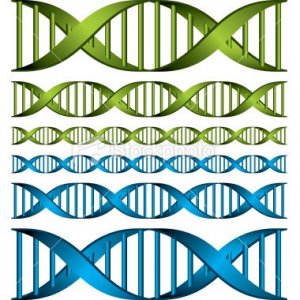
Une brève histoire du gène, tel pourrait être le sous-titre de cet article faisant le point sur l’état actuel de cette question. Une histoire introduite par une boutade. La bioinformaticienne Sonja Prohaska organise un prochain symposium portant sur le devenir incertain de la notion de gène. Elle a tenté une expérience, passer une journée sans prononcer ce mot de « gène ». Un véritable défi pour une scientifique passant son temps à rassembler toutes les données exploitables issues des recherches génétiques. Un défi, mais aussi une intéressante introduction à cette réflexion sur ce que les biologistes entendent par gène. Selon S. Prohaska, la plupart de ses confrères reviennent sur une définition devenue un peu trop classique et qui par paresse intellectuelle, a été conservée. Celle du gène défini comme une unité de séquence d’ADN censé coder pour une protéine et qui, dans une cellule, permet de produire cette protéine dans le cas où ce gène s’exprime.
Revenons sur cette aventure de la notion de gène qui, chez nous, a fait l’objet d’un livre fort intéressant du philosophe des sciences André Pichot (Histoire de la notion de gène, Champs Flammarion). On y apprend, comme du reste dans le billet du NYT, que la notion de gène fut élaborée il y a 100 ans, en 1909, par le biologiste danois Johannsen. Pichot explique bien le contexte de crise ayant poussé les généticiens à abandonner l’impasse de la pangénèse darwinienne et ses « particules de l’hérédité » au profit d’une notion plus abstraite et formelle, celle du gène (dont le nom vient d’une contraction de « pangène »). Cette innovation théorique était nécessaire, la biologie étant comme la physique, en crise à cette époque où fut forgée l’opposition entre génotype et phénotype (Pichot évoque cette période comme étant trouble). Dans ce contexte, Johannsen désigne par gène une sorte d’unité de compte ayant cours dans l’hérédité, une unité qui se transmet des géniteurs aux progénitures, sans préjuger de la nature du dispositif. En 1926, Johannsen précise son idée en concevant le gène comme une sorte d’unité de calcul, mais qui ne peut être assimilé à une unité morphologique ou à tout autre support particulaire. Voilà une situation bien cocasse. Le gène est un élément génotypique formel qui se transmet, mais sans support matériel identifié. Mais grâce aux travaux de Morgan, le gène parvient à trouver son support matériel. C’est en effet le locus, du latin lieu, qui rend compte de la transmission de caractères par voie héréditaire. Le locus est une zone déterminée d’un chromosome. Morgan et son équipe ont utilisé la mouche drosophile qui, grâce à ses chromosomes géants, a permis ce qui était pour l’époque une prouesse technologique. La découverte des loci sur les chromosomes signe l’acte de naissance de cette discipline qui ne cessera de s’émanciper au cours du XXe siècle. La cartographie des unités héréditaires sur les chromosomes représente le très lointain ancêtre du séquençage de l’ADN qui se pratique actuellement. Notons que le locus ne représentait qu’un espace, un emplacement de quelque chose causant la transmission héréditaire, mais sans connaître sa nature ni son fonctionnement. Mais ce ne fut que partie remise. On connaît la suite. Mais un recadrage semble intéressant.
Ces questions des gènes, des caractères hérités, des unités de transmission, elles s’inscrivent dans le cadre du paradigme atomiste moderne hérité du XIXe siècle. La recherche des substrats, des composants élémentaires. Il aura fallu beaucoup d’investigations en sciences physiques pour mettre en évidence l’atome, l’élément de base censé former les matériaux et rendre compte des réactions chimiques inorganiques et organiques. Ensuite, les composants de l’atome ont été élucidés, protons, neutrons, électrons, puis les particules élémentaires des champs quantiques. Revenons au XIXe siècle, l’hypothèse cellulaire en biologie est devenue une réalité grâce aux progrès de la microscopie. La science du XIXe siècle fut en quête d’ontologie, de substance, transgressant dieu merci les recommandations d’Auguste Comte. Chaque réalité doit se décomposer en éléments censés expliquer des phénomènes collectifs dont ils sont les causes. L’atome comme composant de la matière, cela semble trivial, comme la cellule élément des organes. Mais pour l’hérédité c’est moins évident. Autant les fonctions physiologiques apparaissent sous un jour limpide grâce aux investigations analytiques, autant la « fonction héréditaire », guillemets oblige, apparaît sous un angle flou eu égard à cette double tâche d’identifier ce qui s’hérite et ce qui en constitue le support. Avec en plus le schisme entre phénotype et génotype, un schisme qui date de 1910 et qui n’a pas été solutionné. Une unité causale, une unité résultante, ce schéma a pris du plomb dans l’aile. Mais, pourtant, la science fut près d’approcher ce Graal de la génétique.
Années 1950. Fini les chromosomes, place à l’ADN et au langage des séquences codées avec quatre lettre, GATC, le Graal de la génétique. L’hérédité enfin dévoilée comme codée à l’instar des codex et autres manuscrits dont se servit l’humanité pour transmettre ses cultures. L’idée était belle, sans doute trop crédible pour être vraie. Mais que de découvertes. L’unité de compte héréditaire est devenue une unité de compte cellulaire. Un gène, une protéine. Tel fut le dogme central en vigueur de 1960 à 1990. Quoi de plus séduisant que le paradigme hérité de l’opéron lactose et des modèles rétroactifs ayant propulsé Monod vers un Nobel plus que mérité, mais qui a mal vieilli, à l’instar des mélodies des Beach Boys. Le rêve mécaniste génétiste s’est évanoui parce qu’il n’a pas tenu ses promesses et que de plus des découvertes ont imposé de revoir la notion de gène, la place du gène tel qu’on l’a compris comme codant une protéine et en bout de course, toute la conception du vivant que les biologistes ont tenue pour définitive dans ses principes.
Rappel historique. Après l’aventure des loci sur les chromosomes, la découverte de l’ADN a complètement changé la stratégie de la biologie moléculaire. Mais aussi la compréhension du vivant à travers cette « super molécule quasi-magique » en forme de double hélice dont les propriétés se sont dévoilées peu à peu. La conception mutationnelle du gène, héritée du temps des chromosomes et des loci, est abandonnée (Pichot, p. 146) ; cédant la place au gène défini comme segment d’ADN, autrement dit comme une suite de « lettres géniques » de 10, 100 ou 1 000 éléments, formant un gène à l’instar des phrases du langage formées de lettres regroupés en mots. Une extraordinaire aventure scientifique a commencé. Un gène répond à deux fonctions, l’une globale, la transmission d’un patrimoine, l’autre élémentaire, servir de support informationnel contenant par le biais des codons, la séquence des acides aminés devant former les protéines de la cellule. Pendant trois ou quatre décennies, la biologie offrira de belles découvertes. Alors que les maladies géniques entreront de plain-pied dans ce paradigme avec la formule un gène altéré, une protéine modifiée, une maladie génique engendrée. L’apogée de la génétique se situe vers la fin des années 1990. Le séquençage des génomes est de plus en plus performant. Et le principe de base de la génétique de papa a été appliqué pour obtenir des structures de protéine par le biais de la séquence du gène qui les code. L’ADN s’est prêté à un ensemble d’usage pratique, mais les gènes, quel est leur rôle exact, que sont-ils devenus et quelle est leur place dans le fonctionnement de la cellule et l’organisme ?
C’est ce genre de question que pose l’article du NYT en interrogeant les découvertes récentes ayant poussé le gène hors du cadre dans lequel la génétique l’avait inscrit dans un marbre théorique qui s’est progressivement effrité. Plusieurs découvertes ont enrichi le schéma du gène s’exprimant, mais, aussi, soumis à diverses régulations. Des éléments imprévus ont jeté le trouble. Pendant les 1980s et 1990s, la biologie moléculaire a découvert un mécanisme essentiel, celui de l’épissage des ARN. La plupart des gènes sont formés d’une juxtaposition de séquences codantes, les exons, et de séquence non codantes, les introns (60 % des gènes humains subissent l’épissage alternatif). Un pré-ARN est transcrit, puis dans le noyau, les séquences d’intron sont « coupées » et l’ARN prêt à être traduit en protéine est disponible. Cela ressemble à un assemblage de mots choisis parmi les exons disponibles. Le dogme « un gène une protéine » a été quelque peu écorné, même si on peut penser que, sur le principe, rien n’a changé. A titre d’exemple extrême, le gène Dscam chez la drosophile peut coder 38 000 ARN messagers différents, soit plus que le nombre de gènes répertoriés dans le génome de cette espèce.
Mais, en vérité, ces histoires d’épissage ne contredisent pas le dogme fondamental de la génétique. C’est disons un puissant amendement à la constitution réglant la circulation de l’information depuis le génome vers les protéines. D’autres constats sont plus troublants. Le papier du NYT évoque l’exemple du linaire, variété de fleur dont une espèce transmet un morphotype non pas sur la base d’un élément génique, mais d’une modification épigénétique, précisément une série de méthylations. Le lien direct entre ADN et hérédité doit lui aussi être amendé. Comme d’ailleurs le lien entre ADN et codage de séquence protéiques. En effet, un à deux pour cents de l’ADN est traduit en protéine. A quoi sert donc la plus grande partie de l’ADN ? Pour l’instant, les travaux de l’Encode team permettent de penser que pratiquement l’essentiel de cet ADN non génique (au sens d’un gène une protéine) est effectivement transcrit en ARN non codant. Le rôle de ces ARN n’est pas connu, mais quelques effets régulateurs dans le noyau ont été identifiés par Mello et Fire ; Nobel à la clé.
Cette question de l’ARN non codant est au centre des futures réflexions théoriques sur ce vaste problème de l’information génique et du mystère de l’ADN. Le papier du NYT évoque deux options opposées. Le Dr Haussler pense que tout cet ARN transcrit est, en fait, inutile et, en quelque sorte, mis à la poubelle, comme les pages web visitées mises à la corbeille de notre ordinateur. Le raisonnement de Haussler est contraint par la doctrine de la sélection naturelle. 4 % de l’ADN non codant aurait été soumis à la pression sélective. Mais ce que ne dit pas le billet du NYT, c’est qu’aussi une faible proportion de l’ADN codant a été soumise à cette pression, selon les conclusions de Mooto Kimura. Pour parachever cette étude, le rôle des virus comme vecteurs d’information est lui aussi évoqué. Un peu comme si l’ADN était un disque dur échangeant avec d’autres individus d’une même espèce ou d’une autre des quantum d’information génique.
La chute du billet de Zimmer est d’une incroyable subtilité heuristique. Il faut croire que ce journal est capable de publier des articles savants d’un niveau qu’on ne trouve pas ici, même dans La Recherche. C’est dire si les Américains sont au top. Nous voilà revenu à la case départ dit Zimmer, au moment où Johannsen concevait le gène comme une unité de calcul, sans fonction ni support connu, intervenant dans la transmission des phénotypes. Certes, nous en savons bien plus qu’en 1909, mais le gène a perdu les certitudes théoriques qu’il avait acquises avec cette incroyable somme de recherches en génétique. Précisément, le gène n’est qu’un petit morceau d’ADN dont les fonctions ne sont plus clairement établies ; une entité plus formelle que fonctionnelle. La biologie est à nouveau en crise, comme dans les années 1910-1930. C’est fascinant.
Mais si le gène n’est plus tel que la biologie l’a conçu entre 1960 et 2010, quel est-il ? Ce n’était plus une unité de calcul morphologique, ce n’est plus strictement une unité d’encodage de protéine. Qu’est-ce donc ? Je vous livre en exclusivité ma propre idée. C’est une unité de logiciel cellulaire que, pour l’instant, nous ne savons pas lire. Car voilà bien le stade final de cette belle aventure scientifique. Les biologistes ont essayé de comprendre le gène à travers un système d’interprétation associant les idées formelles mécanistes aux résultats de la génétique de laboratoire. Les hommes ont essayé de traduire le langage des gènes dans leur propre langage, ordinaire, macroscopique (à comparer avec la tension épistémologique entre le monde quantique et classique du temps de Bohr). Cela a donné quelques zones d’intelligibilité. Mais la vérité, elle, repose sur un saut gigantesque par lequel on déplace le lieu des subjectivités et l’on tente de comprendre la lecture des gènes non pas de notre point de vue, qui incorpore à notre insu, sans que nous le sachions, des éléments anthropologiques, mais du point de vue de la nature du vivant telle qu’elle peut émerger pour peu qu’on puisse entamer une sorte de dialogue avec un système que nous n’avons pas conçu et qui, en plus, nous a conçus. Autrement dit, si nous pouvons écrire des lignes de programmes de logiciel informatique, nous ne savons pas comment la nature écrit et modifie et lit ses propres lignes de programmes orchestrées dans un réseaux d’éléments de calculs associant le disque dur de l’ADN et les modules de logiciel que semblent être les ARN. Etonnant et vertigineux. Cela dit, on reprochera à cette vision d’autres éléments anthropologiques et notamment les éléments métaphoriques liés à l’informatique. Mais nous n’avons pas le choix.
27 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










