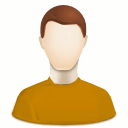
Jean-Michel B.
Docteur en géographie, Jean-Michel B. est fonctionnaire. Il a été en poste durant de nombreuses années en Afrique de l’Ouest appuyant la mise en œuvre de la décentralisation, tant sur le plan institutionnel que dans la direction de projets.Il est aujourd’hui un observateur attentif de son temps et plus spécialement des questions économiques, de développement et d’énergie.
Tableau de bord
- Premier article le 02/10/2007
- Modérateur depuis le 24/10/2007
| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 7 | 14 | 123 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 2 | 2 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
Ses articles classés par : ordre chronologique
La défense des droits de l’homme en Tunisie ?
4676 visites 9 mai. 2008 | 34 réactions |
Et si on reparlait de nationalisations ?
3537 visites 21 mar. 2008 | 24 réactions |
Les propositions de réforme de la commission Balladur : l’officialisation de l’hyperprésident !
5968 visites 2 nov. 2007 | 11 réactions |
Les négociations sur les retraites, et si c’était un véritable marché de dupes ?
11434 visites 24 oct. 2007 | 20 réactions |
Les élections municipales, troisième tour des présidentielles ?
6103 visites 9 oct. 2007 | 10 réactions |
Vous avez dit un point de croissance supplémentaire ?
5611 visites 3 oct. 2007 | 11 réactions |
Aide au développement ! Comment changer ?
4873 visites 2 oct. 2007 | 13 réactions |









