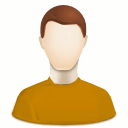Tableau de bord
- Premier article le 29/01/2008
| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 1 | 50 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
Ses articles classés par : ordre chronologique
Jack Lang à Caracas lors du congrès de l’ALBA
1680 visites 29 jan. 2008 | 0 réaction | mi2nmi + Partager
Derniers commentaires
-
Je remets le texte que j’ai posté précédemment car illisible :
Des victimes de crimes des paramilitaires convoquent à la mobilisation contre les AUC
06/02/08
Le 6 mars a été choisi comme journée de mobilisation nationale.
Le 6 mars a été choisi par le Mouvement Victimes de Crimes d’État (Movice) comme journée de mobilisation nationale et internationale pour protester contre les crimes commis par les paramilitaires Auto-défenses Unies de la Colombie (AUC), et en protestion contre les agents de l’état mêlés à des violations de droits humains. La convocation de la mobilisation, dénommé "un million de voix contre les AUC", a été initié par le mouvement colombien Movice.
Iván Cepeda, l’instigateur du projet a spécifié que la date choisie est celle où le mouvement commencera une rencontre nationale sur le sujet dans la ville de Bogota, la capital colombienne. Cepeda a indiqué que la manifestation "sera ouverte, si les gens veulent se concentrer sur les places, aller, placer un drapeau blanc dans sa maison (...) ils Pourront faire ce qu’ils veulent le mot d’ordre étant le rejet des AUC". Iván Cepeda a par ailleurs précisé que la convocation faite par l’organisation sera une réponse à l’unidimensionalité dont on présente les crimes en Colombie, en mettant en évidence les actions commises par les paramilitaires. Il a insisté sur le fait que "l’objectif de la mobilisation est d’exiger que cessent les crimes paramilitaires...et les exécutions extrajudiciaires commises par des membres de la Force Publique".
Les AUC sont accusées d’être les responsables de la disparition de plus de 15 000 colombiens enterrer dans 3 000 fosses communes, ainsi que d’être les principaux coupables du déplacement d’environ quatre millions de personnes, auxquels ils ont volées quelque six millions d’hectares de terres. Ce groupement paramilitaire d’extrême droite s’est hypothétiquement dissous vers le milieu de l’année 2006, selon le gouvernement colombien, suite à un processus de paix de trois an et demi qui a impliquées leur désarmement. Toutefois, diverses organisations non gouvernementales, y compris d’ex chefs paramilitaires, ont dénoncé le fait que des membres des AUC sont réarmés et reforment de nouveaux groupes irréguliers.
texte intégral ici :
http://www.telesurtv.net/especiales/acuerdo-humanitario/notas.php?ckl=24095
-
[b]Le jugement de Jorge Noguera pour ses liens avec les paramilitaires secoue à nouveau l’entourage d’Uribe
05/02/08 - [/b]Des preuves de connivences entre paramilitaires et gouvernement colombien continuent à voir le jour, tandis que le ministre de la Défense, Juan Manuel Santos, concrétise l’achat de matériel de guerre.
Cette semaine commence le procès de Jorge Noguera, ex directeur de la police politique du Gouvernement colombien et main droite du président Álvaro Uribe. Le ministère public fait des recherches sur les liens entre les groupes paramilitaires et les narco-trafiquants. Cette information est passée inaperçue chez les principaux moyens de communication, après la mobilisation de lundi contre le FARC.Dans une entrevue exclusive avec TeleSUR, Álvaro López Doré, ex avocat devant la Coupe Suprême de Justice, a expliqué pourquoi un sujet d’une telle importance n’a que peu d’impact sur les médias et la société civile en comparaison à d’autre faits.[b]López Doré a rappelé que l’ex directeur de la DAS a été protégé jusqu’à présent par le président colombien. "Mais il apparait de plus en plus que Noguera s’est immiscé au sein la délinquance paramilitaire et le narco-trafique, alors Monsieur le President défend avec véhémence le chef de la DAS".[/b]Il a spécifié que cette défense a été "tellement véhémente qu’elle a prêché de toute évidence et déjà son innocence accusé, déjà traité et déjà découvert, il a été nommé dans le corps diplomatique de la Colombie, dont il a dû sortir quand les essais ont été tellement évidents, tellement abondants et tangibles pour tout le pays que cette personne a dû être éloignée du corps diplomatique pour devenir emprisonné dans les prisons".Noguera accusé d’avoir livré de l’information aux AUC
Le scandale a explosé l’année passée quand Noguera a été fait prisonnier, après le témoignage de Rafaël García, un ex-fonctionnaire de la police politique Colombienne (aujourd’hui témoin principal dans cette affaire) qui dénonce des liens avec les paramilitaires. La même personne l’a aussi dénoncé d’avoir coordonné la fraude électronique, qui a apparemment profité au président Álvaro Uribe, aux élections présidentielles de 2002.En 2002 au début dumandat d’Uribe, Noguera a été affecté comme directeur du Département Administratif de Sécurité (DAS), institution chargée de l’ information et des politiques à mener en rapport avec la sécurité de l’État.Les accusations contre Noguera ont été un coup dur contre l’administration uribe, et spécialement contre la crédibilité de la supposée lutte qu’a entreprise l’état contre le paramilitarisme. Après ce scandale, le Gouvernement d’Álvaro Uribe l’a envoyé comme consul en Italie.suite ici :-----------[b]Des victimes de crimes des paramilitaires convoquent à la mobilisation contre les AUC
06/02/08
Le 6 mars a été choisi comme journée de mobilisation nationale. [/b]Le 6 mars a été choisi par le Mouvement Victimes de Crimes d’État (Movice) comme journée de mobilisation nationale et internationale pour protester contre les crimes commis par les paramilitaires Auto-défenses Unies de la Colombie (AUC), et en protestion contre les agents de l’état mêlés à des violations de droits humains.La convocation de la mobilisation, dénommé "un million de voix contre les AUC", a été initié par le mouvement colombien Movice. Iván Cepeda, l’instigateur du projet a spécifié que la date choisie est celle où le mouvement commencera une rencontre nationale sur le sujet dans la ville de Bogota, la capital colombienne.Cepeda a indiqué que la manifestation "sera ouverte, si les gens veulent se concentrer sur les places, aller, placer un drapeau blanc dans sa maison (...) ils Pourront faire ce qu’ils veulent le mot d’ordre étant le rejet des AUC".Iván Cepeda a par ailleurs précisé que la convocation faite par l’organisation sera une réponse à l’unidimensionalité dont on présente les crimes en Colombie, en mettant en évidence les actions commises par les paramilitaires.Il a insisté sur le fait que "l’objectif de la mobilisation est d’exiger que cessent les crimes paramilitaires...et les exécutions extrajudiciaires commises par des membres de la Force Publique".[b]Les AUC sont accusées d’être les responsables de la disparition de plus de 15 000 colombiens enterrer dans 3 000 fosses communes, ainsi que d’être les principaux coupables du déplacement d’environ quatre millions de personnes, auxquels ils ont volées quelque six millions d’hectares de terres.[/b]Ce groupement paramilitaire d’extrême droite s’est hypothétiquement dissous vers le milieu de l’année 2006, selon le gouvernement colombien, suite à un processus de paix de trois an et demi qui a impliquées leur désarmement.Toutefois, [b]diverses organisations non gouvernementales, y compris d’ex chefs paramilitaires, ont dénoncé le fait que des membres des AUC sont réarmés et reforment de nouveaux groupes irréguliers.[/b]texte intégral ici : -
Forum sur la colombie et les FARC ici :
http://www.novaplanet.com/forums/viewtopic.php?id=27564&p=21
-
Article intéressant surtout quand il est mis en perspective avec les deux suivants :
Les FARC plient, mais ne rompent pas
10/12/2007 - Associated Press
Pour réprimer les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), le président colombien Alvaro Uribe a déployé d’importants moyens militaires et policiers. Mais si la guérilla a perdu le contrôle de certains territoires depuis quelques années, elle n’entend pas pour autant baisser les bras.
En octobre, le ministre de la Défense Juan Manuel Santos s’était rendu en hélicoptère à La Julia, bastion des FARC à 193km au sud de Bogota. Accompagné de quelques responsables de l’ambassade des Etats-Unis et de soldats américains lourdement armés, il avait alors affirmé que « la guérilla ne contrôlera plus jamais ce territoire ».
Quelques semaines plus tard, une équipe de l’Associated Press a pourtant dû franchir des barrages de rebelles pour atteindre cette ville, d’où plusieurs centaines de personnes ont fui depuis l’arrivée des soldats et policiers. « C’est idiot de dire que le gouvernement a achevé la guérilla », souligne Gustavo Valencia, un maraîcher de 52 ans.
Malgré une aide de l’armée américaine de plus de quatre milliards de dollars (2,7 milliards d’euros), les troupes colombiennes ont du mal à réprimer les FARC. A La Julia, la déclaration de victoire du ministre de la Défense semble prématurée. La population fait ainsi preuve d’une méfiance, voire d’une hostilité, à l’égard des forces de l’ordre.
A partir des années 1960, la guérilla a contrôlé de nombreuses régions de Colombie négligées par le pouvoir central. Il y a moins de dix ans, elle lançait des attaques importantes contre des bases militaires et avaient même brièvement occupé une capitale provinciale, enlevant des policiers et des militaires.
Depuis l’arrivée au pouvoir d’Alvaro Uribe en 2002, le gouvernement a repris le contrôle de nombreux axes routiers, où la guérilla installait des barrages pour enlever des otages. Et les rebelles ont disparu de la région de Bogota. Parallèlement, le nombre de soldats professionnels a doublé en sept ans, atteignant les 80.000 hommes.
Après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, le « Plan Colombie » lancé à l’origine par le président américain Bill Clinton est passé de la lutte contre les stupéfiants au combat contre la guérilla. Les forces spéciales américaines ont formé des troupes d’élite et des conseillers américains ont été détachés auprès de divisions colombiennes.
Les Etats-Unis apportent également une source d’informations importante grâce aux images par satellite et à l’interception de communications, précise le commandant en chef de l’armée colombienne, le général Freddy Padilla. « Les forces armées colombiennes sont aujourd’hui prêtes à se rendre n’importe où dans le pays par surprise » et « avec précision », explique-t-il dans un entretien accordé à l’AP.
Ainsi, les FARC ne peuvent plus déplacer plusieurs centaines de combattants sans être repérés, selon Alfredo Rangel, principal expert militaire du pays. Et le moral des troupes a été renforcé après la mort de deux chefs rebelles, dont le patron d’une faction qui retenait en otage le ministre des Affaires étrangères Fernando Araujo. Enlevé il y a six ans, il s’est échappé le 1er janvier dernier.
Mais pour l’heure, les 14.000 guérilleros des FARC, dont la lutte est officiellement fondée sur des revendications paysannes, résistent. Contrairement à la plupart de ses voisins, la Colombie n’a jamais approuvé de réformes pour distribuer les terres de manière plus équitable. Et les FARC pourraient facilement résister à des attaques frontales, à moins qu’Uribe ne parvienne à capturer certains de ses dirigeants.
La Julia, qui fut pendant longtemps une plaque tournante de la cocaïne, est un important bastion des FARC, principalement en raison de son inaccessibilité. « Nous sommes les patrons ici », a lancé un guérillero armé d’une kalachnikov lors de la visite des reporters de l’Associated Press. « Nous ne voulons pas que les médias se rendent à La Julia et soient au service de la propagande de l’Etat », a-t-il ajouté à toutes fins utiles.
http://www.betancourt.info/indexFr.htm
Colombie
La réalité désobéissante
Depuis 2002, date de son entrée en fonction, le gouvernement du président Alvaro Uribe mène un soi-disant « processus de paix » avec les groupes paramilitaires d’extrême droite qui ont ensanglanté la Colombie depuis de nombreuses années. Au cours de cette pseudo démobilisation, 31 000 d’entre eux auraient théoriquement abandonné les armes. Le cadre légal qui organise ce processus accorde aux anciens chefs paramilitaires une quasi impunité, la légalisation de leurs fortunes et une retraite dorée. Toutefois, ce processus est marqué par des contradictions et des tensions et a donné lieu à de nombreuses révélations démontrant l’infiltration de l’Etat par les milices d’extrême droite - ladite ‘parapolitique’ [1]. Pour défendre sa politique et continuer à bénéficier de l’appui des Etats-Unis (EUA) et de l’Union européenne, le président colombien mène bataille sur le front sémantique. Il a affirmé début 2005 qu’« il n’y a pas de conflit armé en Colombie mais une menace terroriste » [2]. Il affirme maintenant que le paramilitarisme n’existe plus, mais la réalité diffère de ses propos. En effet, un rapport de la Mission d’appui au processus de paix de l’Organisation des Etats américains (OEA) vient de révéler qu’au moins 22 groupes paramilitaires - environ 3 000 hommes - se seraient réarmés. Nous publions ci-dessous une tribune de Daniel Coronell, un journaliste colombien vivant en exil aux EUA, paru dans l’hebdomadaire Semana.
par Daniel Coronell 27 février 2007
La reclassification sémantique est impeccable en théorie, mais la réalité désobéissante montre que les crimes continuent à être perpétrés. Ou peut-être que ce ne sont pas des paramilitaires ceux qui ont tué le chef du « bureau des recouvrements » [bureau d’extorsion des paramilitaires, ndlr] de Envigado, un de leurs anciens hommes. Il est clair aussi que ‘Alias 39’ [3], un dur sergent [paramilitaire] du Cesar, n’est pas tombé terrassé par une grippe et que plusieurs tombes rendent compte des différences entre « anciens » de Mancuso et « anciens » de Don Berna [4] [tous deux, leaders paramilitaires, ndlr] pour le contrôle de la coca dans la région de Córdoba, pour ne citer seulement que quelques exemples.
Dans plusieurs régions de la Colombie, des paramilitaires qui ont fait la file pour remettre leur fusil aux Haut Commissariat pour la paix [organe du gouvernement, ndlr] sont réapparus armés et en uniforme. Leur nom, lui, a bien changé. Ils s’appellent maintenant ‘Aigles noires’ (Aguilas negras) ou ‘Les poulpes’ (Los Pulpos) ou ‘Autodéfenses paysannes du Nord de El Valle’ (’Autodefensas Campesinas del norte del Valle). La manière d’opérer est toujours la même. Les objectifs sont identiques : trafiquer, s’emparer des meilleures terres, extorquer, expulser ou assassiner celui qui s’oppose et aussi affronter la guérilla elle est présente.
suite ici :
http://risal.collectifs.net/spip.php?article2161
COLOMBIE
Paramilitaires : des « Aigles noirs » prêts à fondre sur la presse
suite ici :
-
Les paramilitaires au coeur du terrorisme d’Etat colombien Explicitement soutenu par Washington, le gouvernement colombien a annoncé, le 27 novembre 2002, l’ouverture de pourparlers avec les paramilitaires des Autodéfenses unies de Colombie (AUC). Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 1er décembre avec cette organisation liée au narcotrafic, massivement impliquée dans la violation des droits humains, alors que les négociations avec l’opposition armée n’ont jamais progressé. Mais Etat et paramilitaires ont toujours fait bon ménage en Colombie.
par Hernando Calvo Ospina 29 mai 2003
Pour mettre en échec les organisations d’opposition armée qui s’opposent à lui depuis plus de trente-cinq ans, l’Etat colombien a, de tout temps, employé une stratégie : détruire ou neutraliser le tissu social qui les soutient de façon réelle, potentielle ou présumée. Véritable terrorisme d’Etat, la « sale guerre » qu’il mène repose sur deux piliers fondamentaux : « Les opérations cachées ou clandestines des forces militaires et la mise en place de groupes paramilitaires. Ces derniers sont le centre névralgique de la contre-insurrection menée par l’Etat et, en particulier, par ses forces militaires [1]. »
Tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, certains médias et intellectuels notoires ont servi le discours de l’establishment, répétant que le mouvement paramilitaire constitue un « troisième acteur » dans le conflit, un « électron libre » qui ne peut être contrôlé, même par l’Etat, affaibli, impuissant et victime des « violents » au même titre que la population. Le discours officiel affirme également que ce mouvement est le fruit d’une relation entre narcotrafiquants, militaires dévoyés, propriétaires fonciers et paysans organisés contre les abus de la guérilla - les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et l’Armée de libération nationale (ELN) essentiellement.
Très connu pour ses positions de défense des droits humains, le jésuite Javier Giraldo ne partage pas cette vision : « Une perspective historique nous interdit de définir le mouvement paramilitaire comme un « troisième acteur » dans le conflit, déclarait-il lors d’une conférence publique donnée à Chicago le 17 mars 2001. Ce n’est pas un troisième acteur.C’est le bras clandestin et illégal de l’Etat et il existe depuis plusieurs décennies. Cette même perspective historique nous empêche de considérer l’Etat colombien comme un « Etat de droit ». »
Après le triomphe de la révolution cubaine, en 1959, les Etats-Unis ont conçu la doctrine de sécurité nationale et légitimé les forces armées dans le rôle de garant des institutions et leur a donné pour tâche essentielle - sinon unique - de lutter contre l’« ennemi intérieur ». Ainsi, et en dépit des particularismes nationaux, l’axe de la sécurité repose-t-il dès lors sur la contre-insurrection. « La destruction de l’« ennemi interne » devient l’objectif, voire la finalité suprême de l’Etat [2]. » En Colombie, l’un des premiers manuels traitant de la contre-insurrection définit l’« ennemi intérieur » de manière aussi simple que dangereuse : « Tout individu qui, d’une manière ou d’une autre, favorise les intentions de l’ennemi doit être considéré comme traître et traité comme tel [3]. »
En 1965, lorsque apparurent les premiers groupes insurgés, le gouvernement émit un décret visant à « organiser la défense nationale » (décret 3398/1965). Un paragraphe autorisa le ministère de la guerre à « armer des groupes de civils avec un matériel habituellement réservé aux forces armées ». Le mouvement paramilitaire bénéficiait ainsi d’un soutien juridique. En 1968, le décret se transforma en législation permanente (loi 48) jusqu’à 1989, année au cours de laquelle la Cour suprême la déclara inconstitutionnelle.
En 1969, un règlement de l’armée avait ordonné « l’organisation militaire de la population civile dans le but de soutenir les opérations de combat (...) sous contrôle direct des unités militaires [4] ». En 1976, la revue des forces armées (n° 83) affirmait que, « si une guerre circonscrite et non conventionnelle entraîne trop de risques, les techniques paramilitaires sont une force sûre, utile et nécessaire aux objectifs politiques ». Sous des sigles aussi fantomatiques que l’Alliance anticommuniste américaine (triple A), des groupes commencèrent à menacer, à assassiner et à faire disparaître les opposants et autres détracteurs du système. Organisés en haut lieu, ces groupes étaient en fait des structures spéciales du service de renseignement militaire.
Au début des années 1980, les FARC et le gouvernement de M. Belisario Betancur s’accordèrent pour négocier une solution au conflit. Les FARC participèrent à la création d’un parti politique, l’Union patriotique (UP), destiné à prendre sa place dans la vie institutionnelle et démocratique. Immédiatement, la « sale guerre » redoubla contre les dirigeants populaires, syndicaux et paysans. « Les efforts pour chercher une solution non violente ou politique au conflit interne ont été perçus par le haut commandement militaire comme des avancées de la « guérilla communiste » vers le pouvoir [5]. » Comme les enquêtes officielles l’ont amplement démontré, le haut commandement impliqua des caciques du Parti libéral et du Parti conservateur, des propriétaires fonciers et les chefs de mafia dans le développement de structures paramilitaires criminelles. De plus, l’armée produisit un autre « règlement de combat antiguérilla » (EJC 3-10, Réservé, 1987) divisant les forces subversives en deux camps : « la population civile insurgée et le groupe armé ». Par conséquent, « la population civile est l’un des objectifs fondamentaux des unités de l’armée ».
A elle seule, l’Union patriotique a vu assassiner trois mille de ses militants et sympathisants, parmi lesquels deux candidats à la présidence (MM. Jaime Pardo Leal et Bernardo Jaramillo), presque tous ses maires, édiles et parlementaires. Pour ce « génocide politique », une plainte a été déposée devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme de l’Organisation des Etats américains (OEA) contre l’Etat colombien.
Au total, au milieu des années 1990, le terrorisme d’Etat a fait disparaître quelque 25000 personnalités progressistes et membres de la gauche. Ironiquement, tandis que l’opposition légale se faisait massacrer, les mouvements d’opposition armée se sont fortifiés.
Principaux exportateurs de cocaïne
Dans son rapport de 1996, l’organisation américaine Human Rights Watch démontre que la CIA et le Pentagone ont contribué à la réorganisation « des systèmes de renseignement pour aboutir à la création de réseaux de surveillance identifiant et assassinant les civils suspectés d’aider les guérillas [6] ». En 1994, le gouvernement de M.Cesar Gaviria avait mis en place (décret 3567 du 11 février) des associations communautaires de sécurité rurale, les « Convivir », supposées aider la force publique à prévoir les activités des groupes insurgés, grâce à un réseau d’informateurs. La réalité a démontré que les Convivir ont permis de légaliser les réseaux de tueurs à gages au service des narcotrafiquants et des propriétaires fonciers tout en ayant pour objectif principal d’utiliser la population civile comme cache-sexe du mouvement paramilitaire.
suite ici :
http://risal.collectifs.net/spip.php?article463
Colombie : la banane Chiquita s’est payé les paras La firme américaine a versé plus de 1,7 million de dollars aux paramilitaires d’extrême droite.
Par Michel TAILLE
QUOTIDIEN : vendredi 16 mars 2007 Bogotá de notre correspondant
La multinationale américaine de la banane Chiquita a bien financé durant des années des groupes paramilitaires d’extrême droite, à travers une filiale colombienne. Selon l’enquête de la justice américaine, l’entreprise a versé à partir de 1997 plus de 1,7 million de dollars à ces escadrons antiguérilla. Ces versements « avaient toujours été motivés par notre souci pour la sécurité de nos employés », se défend le PDG de l’entreprise, Fernando Aguirre, dans un communiqué publié mercredi. L’accord négocié avec le département de la Justice de Washington, qui prévoit le paiement d’une amende de 25 millions de dollars, doit encore être entériné par un tribunal. Mais il vient confirmer de vieux soupçons contre les producteurs de bananes installés en Colombie.
Plusieurs d’entre eux avaient déjà été accusés à la fin des années 80 de recruter des mercenaires pour former les premières milices antiguérilla. Les groupes marxistes des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) ou de l’Armée de libération nationale (ELN) contrôlaient alors les zones de culture de banane et imposaient leur racket : la filiale de Chiquita elle-même, affirment les juges américains, a dû payer entre 1989 et 1997.
Après une dispute sanglante, qui s’est soldée par la mort de milliers de civils, les paramilitaires ont expulsé la guérilla des bananeraies, avec l’appui des entreprises. Une enquête de l’Organisation des Etats américains a montré qu’une cargaison de 3 000 fusils d’assaut destinés aux milices a été débarquée en novembre 2001 sur les quais privés de Banadex, à l’époque filiale de Chiquita dont elle s’est finalement défaite en 2004.
A sa maigre décharge, Chiquita n’est pas la seule multinationale accusée de collusion avec les milices. Coca-Cola est toujours soupçonnée par des syndicalistes d’avoir favorisé l’assassinat de militants de sa filiale colombienne. L’entreprise minière Drummond devra répondre en mai du meurtre de trois autres syndicalistes, dans le nord-est du pays. Ce n’est qu’un élément de plus dans le scandale des complicités tous azimuts dont ont bénéficié les milices d’extrême droite au sein du pouvoir politique et économique : neuf parlementaires en exercice ont été récemment inculpés pour complicité.
http://www.liberation.fr/actualite/monde/241315.FR.php
De nombreux articles sur la colombie ici :
http://risal.collectifs.net/spip.php?rubrique7#pagination_articles
Une série spéciale de reportages en Colombie
Reportage:Daniel Mermet, Giv Anquetil, Antoine Chao.
Du lundi 3 décembre au vendredi 14 décembre 2007, France inter, 15 heures
diponible à l’écoute ici :
Agoravox utilise les technologies du logiciel libre : SPIP, Apache, Ubuntu, PHP, MySQL, CKEditor.
Site hébergé par la Fondation Agoravox
A propos / Contact / Mentions légales / Cookies et données personnelles / Charte de modération