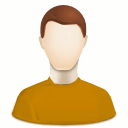
Picospin
Professeur émérite à l’Université de Paris 12. Ancien cardiologue interventionnel, Ancien Chef du Département de cardiologie interventionnelle, du Département d’Enseignement et de recherche en Ethique médicale, Ancien Visiting Research Professor à St Louis University Medical School, chargeé du développement du programme de recherche sur l’utilisation des Lasers en cardiologie, Ancien Président du Comité d’Ethique de la Recherche, Membre actuellement en fonction de ce Comité. Expert en Ethique près de la Commission Européenne de Bruxelles.Tableau de bord
- Premier article le 01/05/2009
| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 2 | 18 | 24 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
Ses articles classés par : ordre chronologique
Y a-t-il de l’or dans le Rhin ?
948 visites 1er mai. 2009 | 0 réaction |









