Histoire de la musique raï
Aucune musique arabe ou maghrébine n’a pu aller au-delà et aussi loin, des confins de son bercail, comme le raï. Pour tant de propagation dans le monde, certains critiques ou observateurs la comparent, sine qua non, au reggae. La mémoire de cette musique, née dans le ghetto de son pays ainsi que son émergence qui ont eu lieu en période d’occupation française, reste à écrire. Celle de sa mue vers le monde entier, qui s’est lancée en époque postcoloniale à partir l’ancienne métropole aussi, est à faire. Une historicité de la musique raï mérite plus que ce court texte.
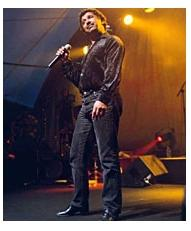
Il faut déceler que ces deux genres, reggae et raï, ont eu des parcours similaires. Après avoir vu le jour dans des pays sous-développés et ont été bâtis à partir de patrimoines locaux, leur succès détala à travers les continents, inondant
Depuis plus de deux décennies déjà, l’audimat, quelques canaux de diffusion et le milieu artistique français lui ont permis, chacun selon une percée revigorante, bien des innovations. La dernière en date s’est réalisée avec la langue de Victor Hugo et s’appelle « Aïcha ».
Chose, sur le plan des textes, que pratiquaient déjà les premiers chanteurs et dramaturges populaires de l’Algérie surtout. Les paroliers, qui ont le plus utilisés des mots de la langue française, sont justement ceux du raï classique et contemporain.
Dans le dictionnaire Larousse de 1998, pour la première fois, s’est instaurée une admission dans le vocabulaire et une signification est fixée au mot raï : « Genre de musique et de littérature moderne de l’Ouest algérien, ouvert sur les autres styles... » A se poser la question, si c’est vraiment une littérature ? Nous dirons surtout à ses détracteurs, oui ! C’est de la poésie. Que non ! Vous diront tous ceux qui ne le tiennent pas en odeur de sainteté. Pourtant la poésie du raï n’a pas d’égale dans la métaphore et la sincérité de ses propos et significations. Tel, le rap c’est un verbe qui sort des tripes des jeunes qu’on considère pour des laissés pour compte et des désœuvrés, pour atteindre bien des cœurs ou rendant sensibles les plus autistes.
1re période : « Les Cheikhs », l’avènement du raï.
La naissance du raï date du début du siècle clôturant le millénaire qui s’est éteint. Après et pendant la Première Guerre mondiale, la misère s’est installée comme un vide austère. La crise dite de 1929 avait longtemps rodé pour ruiner du monde et vider des greniers. Et les stigmates de la Première Guerre étaient encore vivaces.
Le « Melhoun » (1) était le seul bédouin festif qui animait les soirées et les fêtes auparavant. Il avait subi un frein en années de vaches maigres. En l’absence de l’opulence qui permettait les méchouis et les nuits, où le vin coulait à flots avec cette poésie lyrique (Melhoun) ; l’extinction d’une mode et l’apparition de nouveaux contextes et perspectives historiques est arrivée à son terme. Le « Melhoun » multi-séculaire est devenu obsolète.
Les servants, des « rave-parties » qui se tenaient dans les grandes propriétés foncières, ont été les premiers fondateurs du raï. Ces fêtes de nuit regroupaient depuis des décennies les princes des anciennes bourgeoisies berbères, arabes et ottomans, puis rejoints par les colons européens venus depuis 1830 dès la colonisation, avaient un personnel autochtone déshérité. De simples valets aux ventres creux et à l’écoute gavée des rythmes et musique du fabuleux Melhoun. Des noctambules d’origines européennes et autochtones organisaient très souvent de longues soirées, sous forme de beuveries dans les grandes fermes, détenues par des Européens ou des collaborateurs du colonialisme, qui ont été vidées par la crise.
Les employés, de ce faste perdu, sont allés renforcer les ghettos qui se formaient dans les parages des villes, rejoignant les déracinés qui ont perdu leurs terres par la spoliation coloniale suivie de la crise. Certains sont devenus bergers de maigres troupeaux, préservant leur liberté par le nomadisme. De leurs écoutes antérieures des « Cheikhs » du « Melhoun », ils commencèrent à les imiter reprenant quelques vers de la pompeuse poésie du « Melhoun ». Ils adoptèrent dès lors une rythmique plus accélérée, moins mélodieuse que sa source. Grâce à des instruments semblables, mais pas les mêmes, à ceux de leurs maîtres. Aux formes et à la manipulation plus légère, pour créer des sons accélérés : « le Nay » (2) et le « Galal » (3). Certainement créés pour la commodité de leurs transferts et qui sont devenus de prédilection à la suite de leurs raffinements.
Ces servants ont d’abord été invités à animer des soirées dans les bordels ouverts pour assouvir les besoins sexuels de la soldatesque colonialiste, dont les contingents se composaient très souvent de célibataires où le critère est exigé pour les légionnaires. C’est dans ces lieux de perversion que le raï a été baptisé, avec aussi ses premiers chanteurs les « cheikhs », tels qu’étaient désignés leurs prédécesseurs, les poètes du Melhoun.
C’est de cette raison du lieu de l’apparition du raï, que la mauvaise réputation lui reste une ombre fatale. C’est-à-dire depuis, on lui enjoint une vulgarité qui l’a toujours casé dans la précarité et le refoulement.
Cependant du côté instrumental l’accordéon, le violon, la clarinette, la trompette et d’autres encore ont fait leur percée, dans le patrimoine musical du Maghreb, avec l’apport du colonialisme français.
La venue du raï est incontestablement parvenue à partir du Melhoun, cependant une nouvelle forme du texte, outre les rythmes, le différencie nettement. Sa poésie est élaborée d’une autre manière, plus écourtée et déstructurée, glanée en bribes d’un passé en partance. La trame générale de son poème s’est mobilisée à exprimer une subversion par rapport aux tabous qui ne plaisaient pas, de même qu’aujourd’hui, aux catégories sociales conservatrices plus attachées à la musique arabo-andalouse, ou le chaâbi de Dahman ou El-Anka.
Le raï a vécu une longue période en marge, telle une sous-culture, des circuits officiels et des cadres culturels établis dans la société par les rouages qui dirigent.
2e période : Les chikhate, la grande mue.
A partir de ces bordels se sont révélées les premières voix féminines. Les prostituées qui y travaillaient ont été invitées à être d’abord les chœurs. Puis elles ont fait le pas radieux de chanter. L’époque des « Chikhate », la deuxième étape, était venue après environ une ou deux décennies préliminaires. Elle reste une transition des plus enrichissantes puisque avec le Melhoun, la chanteuse n’existait pas.
Les chanteuses du raï ont marqué à jamais le genre en donnant une intonation vocale spéciale, jouissive, mielleuse et suave. Un autre style qualitativement supérieur, par rapport aux genres locaux, et duquel le raï ne peut désormais s’en passer. Il insuffla une flamme de bonheur dans la musique maghrébine que seule la culture berbère avait, par le passé, souvent entretenue.
Il faut préciser que cela n’a pas seulement réhabilité ces femmes, en devenant chanteuses, mais aussi réconforta l’accentuation désavantageuse de la mauvaise renommée. Déjà une farouche intolérance de la société traditionnelle n’arrêtait pas de l’isoler, elle perdure encore sans manquer l’argumentaire de l’origine.
Mais c’est aussi grâce à ses Chikhate que le raï est sorti des maisons de tolérance, à la rue. D’abord commandé par les cabarets où se pratiquait la fameuse danse érotique du ventre, puis les bars et enfin les festins qui s’organisent dans les bas-fonds. L’attirance qu’ont les voix féminines a rendu populaires beaucoup de ces anciennes prostituées et en aménagea les premiers enregistrements sur les supports de vinyle noir. Les Cheikhs demeuraient, nonobstant, à chanter avec la prépondérance qui leur est due.
3e période : Les Chebs contemporains, la modernisation ou l’universalité.
L’étape des Chebs (Jeunes) est due principalement à un trompettiste incontournable actuellement dans le monde du raï. Dès les débuts des années 70, Bellemou jouait de son cuivre luisant dans les gradins des stades de football d’Oran. A partir des tribunes de sport et parmi les supporters des deux clubs, MCO et USMO, résonnaient anonymement, chaque dimanche, des sons plus affiliés à l’Ouest algérien, et dignes de représenter tout le pays sur le plan musical. Vite interceptés et appréciés par les jeunes en particuliers et la population en général comme une valeur sûre et bien populaire, ils attendaient depuis des lustres de la considération.
Un autre homme de haute culture, très respectueux des terroirs et parolier du raï, était directeur de la station régionale d’Oran de l’ex-RTA (Radio et télévision algérienne) n’a pas été indifférent au travail de Bellemou dans la foule. Il l’invita à la télévision et réalisa avec lui deux chansons qui ont eu le succès, certes inattendu, mais déjà décelées ayant de l’emprise sur l’écoute de la jeunesse.
Saïm El Hadj, à qui est due la première prise en charge du raï moderne, était parolier émérite de la chanson populaire algérienne. A l’époque le ministre algérien, Ahmed Taleb El-Ibrahimi, qui par la suite défenda bec et ongles l’intégrisme islamiste, de la culture n’a pas pardonné à Saïm El Hadj d’avoir fait cette première approche du raï et l’a écarté de l’institution pour, reconnaît-on, le motif d’indécence.
Mais depuis, des Chebs se sont mis à un travail d’universalisation, vue l’hostilité locale. Ils étaient au parfum de la mauvaise considération donnée à leur musique, ce qui les a poussés à une rigueur, des améliorations de grande envergure et la bonne facture des sujets, musicaux et de paroles, pour s’imposer. Ils montrèrent la même subversion que leurs aïeuls, en l’enrobant d’une esthétique considérée relevant de la chansonnette. Ce qui leur a fait de l’attrait auprès des jeunes, outre l’expression de la révolte par rapport aux mœurs, est l’esprit ludique ou festif dit de discothèque. Ils confectionnèrent de leurs propres moyens des sons musicaux et une poésie dont le romantisme reflète leurs frustrations sentimentales et leurs plaies à profondeur sociale.
Ensuite, c’est en France, pendant les années 80, que se réfugièrent quelques grands noms du raï pour trouver des conditions de travail très attractives et les moyens techniques adéquats à une modernisation plus poussée. Ils pointèrent dans ce pays où le show-business dispose de vrais militants des cultures diversifiées ou peu réticentes à l’exotisme. Les Chebs comptaient surtout égayer les communautés immigrées, toujours avides et disponibles pour renouer avec la culture de leurs origines où les refrains ont une plus grande place que la littérature ou le théâtre.
A une époque où la chanson française connaît un reflux et devant l’assaut de l’américanisation qui se fait entendre, encore de nos jours, dans tous les domaines et sur tous les fronts, le raï eut une chance en or. Des réactions négatives, propres à l’Hexagone vis-à-vis des étrangers, ont tenté de boycotter le raï. Le dépassement de ces entraves s’est effectué sans facilité. La rampe de lancement vers l’universalité n’a pas écouté les malveillances ou trébuché sur les handicaps. La grande porte s’est ouverte pour Cheb Mami et Khaled.
(1) Melhoun : anciens poésie et chant bédouin du Maghreb.
(2) Nay : flûte sans bec, très utilisé dans les orchestrations orientales. Faite d’une tige de roseau, de la plus fine qu’on puisse tailler.
(3) Galal : genre d’instrument pour percussions, de forme cylindrique de quelque 15 à 25 cm de diamètre avec une longueur entre 30 à 50cm, fait de feuilles de bois léger torsionné ou creusé dans un tronc traité.
http://www.argotheme.com/organecyberpresse/
14 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










