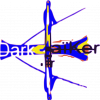Hommage au Blues de Langston Hugues
Le Blues de Langston Hugues, hommage brut de décoffrage.
« La rivière amère ne réfléchit plus d'étoiles,
Elle ne renvoie plus que l'éclat des barreaux d'acier,
Et de noirs et amers visages noirs derrière les barreaux d'acier,
(…)
Le tourbillon de la rivière amère
Emporte ta « patience ».
Le tourbillon de la rivière amère
Balaie et emporte tes mensonges.
Ce n'est pas moi qui ai réclamé cette rivière
Ni le goût de son breuvage amer.
C'est toi qui m'a fait don
De ses eaux.
C'est ta propre puissance
Qui m'a forcé le dos au mur
A boire dans ta coupe amère
Ce mélange de fiel et de sang.
(…)
L'eau de la rivière amère
Dans mon sang s'est changée en acier.
O tragique rivière amère
Où furent pendus les jeunes gars lynchés,
Le fiel de tes flots amers
Pour moi ne réfléchit plus d'étoiles. »
(...)
Brève biographie à partir de la biographie de François Dodat, collection « Poètes d'aujourd'hui », Seghers, 1964.
Né le 1er février 1902 à Joplin, Missouri, Langston Hugues n'était pas noir de peau : il suffisait d'avoir un seizième de sang noir pour être un « negro ». Langston, lui, avait du blanc, du juif et de l'indien en plus...
Dans sa biographie « Les Grandes profondeurs » (The Big Sea, 1947) il parle de sa jeunesse comme d'un « tissu aussi bigarré que sa généalogie ». Sa grand-mère de Lawrence (Kansas) lui fit découvrir le monde mythique des héros du peuple noir. Une femme fière, d'ascendance franco-peau-rouge (On pense à Kerouac) qui lui apprit que « pleurer était toujours inutile ». (On revoit l'image de la mère de Ray Charles, dans le film Ray, dans un registre plus dramatique mais tout aussi précis).
A Central High School de Cleveland, une de ses institutrice lui fait découvrir les poèmes en dialecte nègre de Paul Lauwrence Dunbar et surtout ceux de Carl Sandburg, en vers libres, dont il fait « son étoile pilote ». Enfin Maupassant le décide à devenir écrivain et à composer des histoires sur les Noirs, « des histoires si vraies qu'on les lirait au bout du monde, même après ma mort. » (ce qui fut aussi l'ambition avouée et répétée de Kerouac).
Langston Hugues, inscrit à l'université de Columbia pour se rapprocher de Harlem, fréquente plutôt les théâtres (comme Kerouac les cinémas, une vingtaine d'années plus tard) du début de la « Renaissance noire ». Harlem, qui lui inspire notamment « Le Blues du désespoir ».
Embarqué sur le S.S. Malone pour l'Afrique à 21 ans (à la façon de London ou Kerouac), il finit par jeter ses livres à la mer pour échapper « au sentiment d'être toujours contrôlé par d'autres ».
L'Afrique, « le seul endroit au monde ou j'aie jamais été désigné sous le nom de « Blanc », écrit-il, mais dont il ne peut, néanmoins et par conséquent, éternel étranger, vraiment « pénétrer l'âme ».
Langston découvrit le Paris des années 20 comme un nouveau Harlem, un îlot de liberté, et l'Italie où il occupe aussi de petits boulots pour survivre.
Considéré comme un membre important de cette « Renaissance noire » (finalement assez illusoire), mais à l'avenir incertain, à son retour aux USA il se met « à écrire à la manière des blues et des spirituals nègres » et occupe de petits emplois avant de faire découvrir ses poèmes à Vachel Lindsay qui le fait connaître.. Il passe trois années à l'université de Washington pour parfaire sa culture et pouvoir « vivre de sa plume », ce qui n'est jamais gagné.
Langston se rend à Moscou avec des étudiants et artistes noirs et visite des régions peu connues d'URSS. Rencontre Arthur Koestler. Ses prises de position l'amèneront, plus tard, à comparaître devant la Commission des activités anti-américaines de Mac Carthy, mais il fut « blanchi » : Langston Hugues combattait naturellement pour la libération de ses frères de race, loin des partis politiques. Rencontres en URSS, avec Pasternak, Tretiakov, Aragon et Triolet, parmi d'autres.
La lecture de celles de DH Lauwrence renforce la décision du poète d'écrire des nouvelles. Il regagne les USA en prenant le Transsibérien, traverse la Corée, débarque au Japon et à Changhaï. Rencontre avec la veuve de Sun Yat Sen. Il écrit des nouvelles sur le problème racial qu'il considère comme le problème numéro un de son temps.
Après la mort de son père, Langston Hugues passe un hiver à Mexico avec Henri Cartier- Bresson et fréquente les milieux artistiques mexicains (dont Diego Rivera) avant de revenir à Harlem, alors qu'une de ses pièces est jouée à Broadway. Mais il est exclus, en tant que noir, de la réception qui suit le succès de la représentation !
Langston Hugues accepte un poste de correspondant de guerre en Espagne et débarque du train à Barcelone avec Nicolas Guillen. Découverte des Noirs américains combattants volontaires des Brigades internationales. Épris de Madrid, blessé d'une balle, il rencontre Neruda, Malraux, Erhenbourg, Renn, Last et Hemingway et boucle la partie aventureuse de sa vie par Paris (1937).
Langston Hugues a écrit dans tous les genres littéraires et journalistiques, fait des conférences et lectures publiques. Sans « best-seller », il a fait connaître le Noir américain en créant le type original de Jess B Simple, un des personnage les plus populaires du folklore américain.
***
En quoi le blues de Langston Hugues sont-ils exemplaires en 2013, pour nous – nègres blancs d'Europe dans un monde « mondialisé » ?
Ce combat ne concerne pas un passé récent mais un futur proche de racismes et de fascismes où la couleur « culturelle » sera redevenue, plus que jamais, un critère déterminant de ségrégation et de lynchage.
Cette guerre masquée est à nos portes, au nom de la soit-disant liberté « commerciale » triangulaire et « individuelle ». Il n'y a jamais de racisme que culturel, de violence que celle de certaines « valeurs », toujours sonnantes, trébuchantes et criminelles.
Comme Whitman, Hugues chantait pour l'Homme, comme un homme. Son blues est un « hommage » direct, comme pour bien dire qu'il n'y a de « démocratie » que dans cette « aristocratie » naturelle de l'art authentique d'un peuple d'hommes et de femmes libres. Le blues est une humanité naturelle, non encore domestiquée.
Le témoignage vécu du blues poet est infiniment plus important que tous les humanismes de convenance et de bien-pensance. Si son blues est une école, c'est celle de la vie rugueuse et d'un enracinement dans des valeurs qui transcendent la souffrance des humiliations.
L'humilité ou l'humiliation disait Bernanos. Le Blues de Langston Hugues traduit bien ce faux dilemme et la façon dont la révolte profonde tranche et creuse une question de beaucoup plus que sociale ou simplement raciale, la retournant en exigence universelle absolue de dignité et de liberté.
Tant que cette exigence n'aura pas été relevée et honorée pour chaque être humain, aucune valeur ne vaudra par elle-même : cette exigence vitale fondamentale les transcende toutes, et si elle les fonde matériellement à chaque époque, jamais elle ne peut s'identifier à elles, ni surtout s'en satisfaire. Elle ne s'y éteint pas, les éclaire et s'y prolonge, leur donnant un sens absolument provisoire. Mais nous avons oublié.
C'est bien ce que rappelle et souligne la mélancolie profonde et première du Blues, sans doute l'une des expression la plus authentique, la plus simple et la plus « discrète » des révoltes de l'âme face au mal, à la mécanique matérialiste des obscurcissements et des corruptions.
L'art nègre n'est pas tant une négritude culturelle de combat que le combat spontané d'un art populaire contre la négation de l'expression « moderne » ou américaine d'une humanité symbolique . Cette modernité-là n'étant en fait que la perpétuation d'une tradition chantée très ancienne, où Arabie, Orient extrême, Afrique et Europe celtique mêlent une plainte du coeur insubmersible et irrémédiable contre l'Homme et la condition qu'il se fait lui-même au nom de la sacro-sainte vénalité, de ses crimes grotesques et de leurs trahisons si grossièrement subtiles.
L'individualisme même, tant, mais si vainement vanté, du Blues n'est qu'une ruse de cette joyeuse fraternité, instinctive et têtue du monde (on pense encore au grand Kerouac), exprimant à travers les déterminations du mal comme une sorte d'initiation douloureuse.
Comme l'appel à l'extase rédemptrice des dépassements futurs, plus spirituellement fulgurants hédonistesdyonisiens ou orgiaques pour petits blancs en mal d'existentialisme à bébéret l'envers.
Ces fulgurations n'appartiennent qu'à l'âme humiliée, même si toute âme vendue les réclame un jour, dans l'extase et l'exorcisme d'appels répétés et scandés à un envol désenvoûté, dans ses invocations nues et tremblantes, ses « misérables » offrandes spontanées, ses fureurs et ses tendresses.
Le désespoir humain se débattant pathétiquement au seuil du passage souterrain à l'irrémédiable, lui-même toujours diaboliquement innocenté et piégé à la fois, mélangé, souillé, torturé, mis aux fers de l'enfer psychologique de conditions cathartiques.
Mais ces fulgurations sont un lâcher prise, loin de la chute maîtrisée qui mène le monde au bout de la nuit d'une histoire beaucoup trop humaine.
Ces fulgurations, ces fulminations ne sont ni régressifs ni barbares mais pur retour aux sources, aux racines, à la douleur de l'arrachement, à partir du paradis séparatiste de la matérialité, du paradis artificiel de la séparativité, d'où la sortie, si universellement redoutée, assure le risque d'un salut brut et net, enfantin et animal à la fois, et d'une joie toujours plus sauvagement spirituelle, encore toute retenue dans l'explosion même de sa longue colère rentrée.
Rejoignant, dans la convulsivité même du mouvement pur, l'immobilité moyeutique des sagesses englouties sous l'océan relatif des cultures. Émergeant, comme rescapé d'une noyade idéologique programmée, brutalement à l'air libre, le Souffle, le Jazz, l'âme d'un peuple du monde.
Riant pour ne pas pleurer. Osant le saut existentiel dans le plat du grand inconnu familier, fourmillant des langueurs d'une langue horizontalement, bizarrement orale – magie des nuits blanches aux vérités cachées mais portées, profilées, fuligineuses, pressenties mais interdites de jour, de cerveau, obscurcies à l'ombre crépusculaire des lois de la pesanteur.
Sous la violence intolérable d'une « évidence absurde », daumalienne. La Note Bleue de Langston, non du plaisir facile perdu, mais gagnée de haut mal sur les monstres d'une aube où « tout soleil est atroce », tout soleil lisseur, démolisseur, jouée en « rentrant à la maison » commune.
***
LA RIVIÈRE AMÈRE
« Dédié à la mémoire de Charlie Lang et d'Ernest Green, tous deux âgés de quatorze ans, lorsqu'ils furent lynchés ensemble sous le pont de Shubuta au-dessus de la rivière Chicasawhay dans le Mississipi, le 12 octobre 1942. »
Il est une rivière amère
Qui coule par le Sud,
Trop longtemps ai-je gardé sur les lèvres
Le relent de ses flots.
Il est une rivière amère
Noire de fange et de boue,
Trop longtemps son néfaste venin
A infecté mon sang.
J'ai bu l'eau de la rivière amère,
Et son fiel couvre le rouge de ma langue,
Mêlé au sang des jeunes gars lynchés
Qu'on a pendu à son pont de fer,
Mêlé aux espoirs qu'on a noyés là
Dans le sifflement serpentin de ses flots,
Là où j'ai bu l'eau de la rivière amère
Qui étrangla mes rêves :
Le livre étudié, désormais sans objet,
Les outils maniés, désormais sans usage,
Le savoir accumulé, jeté au vent
L'espoir battu et meurtri,
O flots de l'amère rivière
Avec vos relents de sang et d'argile,
La nuit vous ne réfléchissez plus d'étoiles,
Ni le jour de soleil.
Traduction François Dodat, op. cit, 1964.
6 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON