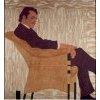Hopper : une caverne à New York
Comment une très vieille allégorie se cache dans la pénombre d'un cinéma new-yorkais...
New york movie
1939, MOMA New York

Pour ce tableau longuement travaillé, Hopper a eu besoin de pas moins de cinquante trois esquisses préparatoires. Il n'a pas représenté un lieu précis, mais la synthèse de plusieurs salles de cinéma de Manhattan.
La salle
La salle est peu remplie : on distingue les silhouettes de deux spectateurs seulement. Le peu que l'on voit du fim est un paysage de montagnes enneigées.
Le palier
Une ouvreuse en uniforme bleu est adossée au mur, attendant que de nouveaux spectateurs descendent par l'escalier. Elle tient dans sa main gauche un objet rond à peine discernable : selon le carnet de Hopper, il s'agit d'une petite lampe-torche.
La zone centrale
Un large mur orné d'une colonne occupe presque le tiers du tableau, séparant par sa masse sombre les deux zones éclairées. Les pampres de la colonne, ainsi que les deux fausses-portes moulurées qui décorent le mur de la salle, introduisent une touche de classicisme dans ce temple de la Modernité.
Les correspondances
Le carnet de Hopper précise qu'il y quatre sources de lumière : l'écran, les lustres de la salle, la lumière de l'escalier et celle des appliques.
Ce qu'il omet de mentionner, c'est que, de part et d'autre de la zone sombre, les zones éclairées se répondent :
- les trois lustres lourds ornés d'un globe rouge font écho à l'applique avec ses trois abats-jours rouge ;
- l'écran avec son rideau rouge (à peine visible dans la pénombre ) fait écho à l'escalier avec son rideau rouge.
La mise en abyme
Ainsi le palier avec son escalier, est analogue, en plus petit, à la salle avec son écran.
Du coup les deux clients, assis dans l'ombre et vus de dos, se trouvent mis en balance avec l'ouvreuse, debout en pleine lumière et vue de profil.
Dans cette composition en abyme, la zone de séjour (la salle avec le public) reproduit, en plus grand, la zone de passage (le palier avec l'ouvreuse).
Un parcours à sens unique
Image d'un lieu de spectacle, le tableau fonctionne lui-même comme un décor de théâtre qui impose aux spectateurs du film - devenus personnages de la pièce mise en scène par Hopper - un parcours réglé et à sens unique : venir de l'extérieur, descendre l'escalier, passer le rideau, se laisser guider par l'ouvreuse pour s'asseoir dans la salle.
La nature dénaturée
Le film est en noir et blanc, la salle est confortable, les montagnes sont en contrebas : en rentrant dans le monde artificiel de la salle de cinéma, comme un bateau dans une bouteille, la nature a perdu ses couleurs, les glaces leur froid, les cimes leur altitude.
C'est au prix d'une insensibilisation - comme on le dit d'une dent morte - que les spectateurs sont admis à contempler un succédané de réel.
L'immobilité de l'ouvreuse
On a dit souvent que le sujet du tableau était le contraste entre l'ennui de l'ouvreuse, figée dans son travail répétitif, et le divertissement du public.
Mais si l'on considère le soin qu'Hopper a apporté à la mise en place de son décor en abyme, il devient clair que le principal sujet d'intérêt est plutôt la manière dont les gens circulent dans cet espace emboîté. De ce point de vue, la lampe de poche joue un rôle fondamental malgré sa taille minuscule : en rappelant que le rôle de l'ouvreuse est de faciliter la descente vers la zone obscure, elle fige la lecture du tableau et la rend irréversible, de l'extérieur vers l'intérieur.
L'ouvreuse est immobile non pas comme une employée qui s'ennuie, mais comme la gardienne de la salle obscure, postée là pour faire oublier jusqu'à la possibilité d'une remontée.
L'ouvreuse et la colonne
On peut aller un peu plus loin, en remarquant que le mur droit de la salle, avec ses deux fausses portes, est analogue au mur droit du palier, avec les deux rectangles de son lambris.
Du coup, la colonne richement pamprée devient analogue à la décorative jeune femme. Véritable statue-colonne, cariatide d'un portail invisible, celle-ci ne doit pas être comptée, comme nous l'avions fait jusqu'ici, parmi les personnages de la pièce, mais parmi les éléments de l'architecture : son uniforme dit bien qu'elle a partie liée avec la salle, en non avec les clients.
De même que la colonne les empêche de voir depuis la salle la lumière du palier, de même l'ouvreuse les dissuade de remonter par l'escalier.
Le caractère frappant du tableau tient au fait que Hopper l'a construit selon une rigoureuse composition en abîme. Non pas pour un simple jeu formel mais, avec tout son talent d'illustrateur, au service d'une idée bien précise.
On a compris où nous mène l'analyse : plutôt que New York Movie, c'est Plato's cave qu'il faut lire. Une fois dissipé le charme trompeur de la belle ouvreuse, l'allégorie de la caverne de Platon devient évidente : les spectateurs sont en prison sous la terre, condamnés à contempler un théâtre d'ombres, alors qu'il leur suffirait de regarder en arrière pour trouver l'issue qui remonte vers le réel.
L'habileté du metteur en scène est d'avoir rajouté un rôle qui ne figure pas dans le mythe. Non pas la fée des salles obscures, mais la gardienne de la grotte, tenu par l'habituelle femme fatale hopérienne : la blonde platinée en vêtement bleu électrique.
Pour ceux qui apprécient le jeu de la sur-interprétation, voir la suite dans http://artifexinopere.com/?cat=131
6 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON