A Mme Danielle Porte, au sujet d’Alésia
Madame, en lisant le Midi libre.com du 9 mars, j’apprends qu’en tant que professeur de latin à la Sorbonne et auteur d’ouvrages sur Alésia, vous allez inaugurer le 20 mars, à Vigan, les 21èmes journées de l’Antiquité. J’en déduis que vous défendez toujours votre hypothèse d’une Alésia en Franche-Comté alors qu’à Alise-Sainte-Reine, les travaux du futur parc archéologique européen ont déjà commencé. Comme vous le savez, l’Etat, l’Europe et les autres collectivités locales participent au financement des 50 millions d’euros qui seront investis principalement par le Département. Compte tenu de l’importance de ce projet et des sommes engagées, vous conviendrez avec moi que le contribuable français mérite d’être informé avec le maximum de clarté. En l’absence regrettable du débat public, je vous invite à venir débattre sur le texte latin de César, et pour ne pas s’égarer dans des questions secondaires et parce que vous êtes latiniste, uniquement sur le texte latin.
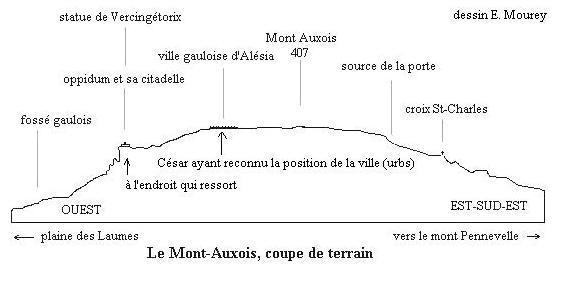
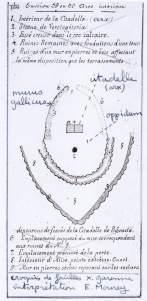 Sub muro, quae pars collis ad orientem solem spectabat, sous la muraille, là où le versant regarde vers le soleil de l’est, hunc omnem locum copiae Gallorum compleverant, les troupes des Gaulois remplissaient tout le lieu, fossamque et maceriam sex in altitudinem pedum praeduxerant, et elles avaient creusé un fossé et élevé un mur grossier de six pieds de haut..
Sub muro, quae pars collis ad orientem solem spectabat, sous la muraille, là où le versant regarde vers le soleil de l’est, hunc omnem locum copiae Gallorum compleverant, les troupes des Gaulois remplissaient tout le lieu, fossamque et maceriam sex in altitudinem pedum praeduxerant, et elles avaient creusé un fossé et élevé un mur grossier de six pieds de haut..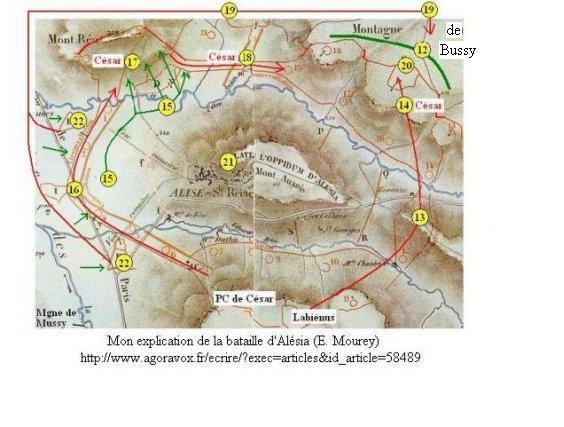
85 réactions à cet article
-
J’espère que votre offre de dialogue sera entendue. Je ne sais qui a raison, mais une analyse systématique des informations disponibles devrait permettre de différencier les deux sites proposés.
-
Remarque et afin d’éviter tout malentendu, je précise que, pour rester dans l’esprit du latin de César, je traduis presque toujours le mot « collis » par versant dans le sens de « mouvement de terrain ». Pour César, une colline, cela ne veut rien dire. Quand j’écris que les troupes gauloises remplissaient tout le lieu sous la muraille, à l’est, cela signifie 1. que la muraille/murus en question est celle de l’oppidum ovale de Garenne, 2. que c’est tout le plateau, à l’est de cette muraille, qui était couvert de troupes gauloises.
-
"Quand j’écris que les troupes gauloises remplissaient tout le lieu sous la muraille, à l’est, cela signifie 1. que la muraille/murus en question est celle de l’oppidum ovale de Garenne"
Quel beau sophisme M Mourey !
Les troupes gauloises remplissent le lieu sous la muraille, donc la muraille est celle de l’oppidum de Garenne !
Appliquons le même raisonnement à votre cheval de bataille habituel : Mont St Vincent a une Eglise, donc Mont St Vincent est Bibracte n’est ce pas ? Juste au milieu de l’Atlantide...
J’en tire un autre raisonnement qui lui est un syllogisme :
Si M Mourey pense qu’Alesia est à Alise Ste Reine, Alesia peut être n’importe où mais pas à cet endroit !
Je doute que M Carcopino eût été content d’avoir un allié pareil. -
Bonjour,
Personnellement, Alésia, connais pas
 Donc pas besoin d’en faire une affaire aussi émotionnelle et d’en arriver à l’invective.
Donc pas besoin d’en faire une affaire aussi émotionnelle et d’en arriver à l’invective.Il serait plus constructif de faire un tableau comparatif des différents points du texte appliqués aux 2 sites en discussion.
Il serait tout de même intéressant qu’il soit enfin procédé à des fouilles sur le site de Chaux-des-Crotenay car les artefacts qui y sont trouvés existent, et il semble y en avoir beaucoup.
Au moins, les différents moyens de datations disponibles pourront nous indiquer des dates claires. Et si ce n’est pas Alésia, ce sera tout de même intéressant de savoir ce qui s’y cache.
Il serait intéressant aussi que les éléments identifiés en Bourgogne soient aussi datés avec des méthodes modernes.
Donc pour résumer, plutôt que de vaines disputes sur des textes imprécis, si vous demandiez tous des fouilles en règle sur les lieux qui n’ont jamais été fouillés ?
-
- Depuis 1983, année où des sondages on été autorisés sur le site présumé du camp nord à « Syam-Chaux des Crotenay » et où des artefacts intéressants ont été trouvés, toutes les demandes de sondages ou de fouilles à Chaux des Crotenay sont systématiquement refusées.
-Le tableau comparatif des différents points du texte appliqués aux 2 sites existe depuis des années sur le site internet de l’association ABB CEDAJ.
-D’autres part la plupart des découvertes d’Alise (comme ces monnaies gauloises achetées à l’Hotel Drouot et retrouvées dans les fouilles d’Alise quelques jours plus tard !) sont soigneusement enfermées dans les stocks du musée des antiquités nationales à Saint Germain en Laye. Alors pour les datations, on repassera....
-Pour finir il n’y a pas que Danielle Porte qui s’intéresse à Chaux des Crotenay. Une requète sur votre moteur de recherche préféré vous fournira de nombreux sites, forum, articles de journaux, films reportages qui vont dans le même sens. -
@ Blurpy
Il est entendu que nous ne débattons que sur la description du site.
Voici ce que dit, à ce sujet, le site internet de l’association ABB CEDAJ :
* Une colline, saillante, portant une très grande ville à son sommet.
Non ! Le caractère « saillant » ne s’applique qu’à un endroit de la colline et c’est la pointe caractéristique du Mont-Auxois, là où se dressait l’oppidum dont Garenne a retrouvé la trace mais qu’il a malencontreusement appelé citadelle alors que la citadelle (une haute tour) correspond à la trace intérieure. César ne parle pas de grande ville mais d’une ville, celle dont les fondations ont été mis au jour mais que les archéologues datent de l’époque gallo-romaine, ce qui est une très grave erreur. C’est Florus qui parle d’une très grande ville, ou plutôt, d’une très grande cité, ce qui manifestement ne peut s’appliquer à la ville des Mandubiens qui n’était qu’une cité vassale des Lingons. Le texte de Florus est litigieux car il applique au siège de Gergovie les travaux du siège d’Alésia. Texte litigieux également quand il évoque des rives abruptes, ce qui peut avoir induit en erreur les premiers tenants de la thèse franc-comtoise ainsi que Mme Porte.Deux rivières « lavant son pied »(subluebant), des deux côtés. Leurs bords sont abrupts. Le texte de César ne permet pas de dire que les bords des deux cours d’eau sont abrupts. Les pentes abruptes citées par César sont celles du mont Rhéa. Là encore, c’est Florus qui vous induit en erreur, comme je viens de l’expliquer.
*Une plaine qui s’allonge sur 3000 pas, soit 4, 5 km en avant de l’oppidum. Elle est encaissée entre des collines.
Là encore, rien, dans le texte de César ne permet de dire que la plaine est encaissée.*De tous les autres côtés, des hauteurs d’une altitude égale à la sienne, et à peu de distance (mediocri interjecto spatio)...
Mme Porte fait ici un faux-sens ou un contre-sens en laissant entendre que ces hauteurs sont à peu de distance de sa colline centrale. La phrase demande une traduction extrêmement précise : Sur tous les autres côtés, des hauteurs (colles) entouraient l’oppidum, (oppidum cingebant) hauteurs au sommet de semblable altitude (pari altitudinis fastigio) et aux faibles espaces entre elles, (mediocri interjecto spatio).
Ces faibles espaces entre les hauteurs qui entourent le mont apparaissent très clairement à Alise mais pas dans le relief du site franc-comtois.*Une montagne, au nord, n’a pu être enclavée dans le périmètre d’encerclement. C’est là que s’installeront 2 légats de César.
Voyez l’explication que je donne dans mon article.*protégés par des murs, une citadelle et des rochers escarpés, défendaient cette très grande ville.
Voyez l’explication que je donne dans mon article. -
M Mourey,
J’avais bien compris que vous vouliez débattre du texte latin, et moi j’en suis bien incapable, mes 5 ans de latin au collège et au lycée sont trop loin !
C’est pourquoi je répondais simplement à la remarque de « ObjectifObjectif » qui ne concernait pas non plus le texte latin.
De toute façon les débats sur Alesia finissent toujours mal sur internet et c’est logique : d’un coté une thèse officielle imposée par Napoléon III en mal de reconnaissance et qui nous poursuit jusqu’au XXI siècle et de l’autre une interdiction de fouilles ailleurs qu’à Alise imposée par le même pouvoir.
Remercions Madame Porte et d’autres qui essayent de faire changer les choses !
A quand la perestroika archéologique française ? -
@ ObjectifObjectif
Soyons objectifs ! Cela fait bien plus de trois ans que j’ai écrit au site internet de madame Porte pour engager le débat http://www.bibracte.com/mon_histoire_de_la_gaule/alesia_plaidoyer_pour_alis e-ste-reine.html. M’a-t-elle répondu ? Non ! Il est exact que ma présente lettre est un peu plus ferme. Mais où voyez-vous une invective de ma part ? Où voyez-vous une charge émotionnelle ?
-
J’espère moi aussi que votre proposition de débat sera entendue par Madame PORTE. Une réponse l’honorera
-
« l’honorerait »
Si cette dame a des arguments solides pourquoi ne voudrait-elle pas en débattre ? Merci Monsieur MOUREY, vos articles sont toujours très intéressants. -
Je suis Danielle Porte. J’ai eu connaissance de cette proposition de débat par hasard, suite à une recherche sur Wikipedia concernant un tout autre sujet. Notre site n’a jamais reçu de message émanant du colonel Mourey (il n’existe avec son Forum que depuis 2 ans) ; s’il m’a contactée à titre personnel, le message est probablement passé aux SPAM, sans quoi je me serais fait un plaisir de lui répondre. Peu familière avec le fonctionnement des Forums informatiques, je serais heureuse de me voir préciser par M. Mourey la forme qu’il souhaite donner à un éventuel débat. Il serait d’ailleurs entendu que j’aurais le droit de poser moi aussi des questions et qu’il s’engagerait à y répondre. En tout état de cause, pas avant la semaine prochaine (conférence au Vigan + cours en Sorbonne jusqu’à mercredi prochain).
Bien cordialement,D.P. -
Bonjour Monsieur Mourey !
Votre article est très intéressant, mais j’ai du mal à croire que Madame Porte, compte tenu de sa formation, ses diplômes et son expérience, puisse faire un contresens en traduisant une phrase du De Bello !
Moi, parmi les nombreuses choses qui me choquent à Alise, (et qui trouvent une explication naturelle à Chaux...) figurent notamment :
- l’impossibilité de situer avec précision la fameuse « bataille des cavaliers » ayant eu lieu la veille de l’arrivée de César devant Alésia...
- L’impossibilité de situer avec précision le fameux Camp Nord (celui des deux légats), pour l’emplacement duquel les alisiens se partagent entre Réa et Bussy...
- l’impossibilité de reconstituer la bataille finale de Vercassivellaune... (le camp nord caché à la vue de l’armée de secours, que des gens du coin doivent leur faire découvrir, la longue marche nocturne de Vercassivellaune dont l’armée se repose, cachée, jusqu’à midi... Les « abrupts » que Vercingétorix envoie ses troupes escalader pour essayer de conforter l’attaque de son cousin... )Sans parler, bien sûr, de la situation même d’Alise (où César n’avait nullement à passer pour aller de Langres à Genève, sauf à vouloir vraiment retourner se « jeter dans la gueule du loup »...)...
Et puis... cette exiguïté d’Alise ! ce manque d’eau !
Alors que tout ça se comprend tellement bien à Chaux des Crotenay ! Vous n’avez qu’à aller voir sur mon site : http://alesia.les-forums.com/forum/1/le-mythe-alise-alesia/
-
Je cite, Monsieur Mourey, un passage de votre article ci-dessus :
Comment, vous-même, pouvez-vous dire que cette plaine s’étalait en largeur alors qu’il est écrit « in longitudinem » ? Comment pouvez-vous inventer qu’elle était à perte de vue alors qu’il est écrit qu’elle s’étalait en longueur sur 3000 pas (évidemment jusqu’à la lisière de la forêt) ?
Si vous relisez bien ce que disent les partisans de Chaux (et madame Porte en fait partie...), ils disent bien, au contraire, que c’est la plaine se Syam, au pied de l’oppidum, qui fait 3.000 pas de long ! Alors que la longueur de celle d’Alise, la plaine des Laumes, est beaucoup plus grande (à tel point qu’on en fixe mal l’extrémité...), tandis que c’est sa largeur qui fait 3.000 pas ! Or César parle bien de « longitudinem » !
Vous qui êtes ancien militaire, vous pouvez le constater facilement sur une carte d’état-major de ces deux secteurs ! Il existe d’ailleurs des cartes en relief de ces ceux régions, Alise et Chaux, qui sont particulièrement parlantes !
-
Pour compléter votre vue concernant Alise, je vous prie de trouver ici, Monsieur Mourey, un autre plan, de Chaux cette fois, tiré du livre « Alesia » de Jacques BERGER... On voi
[URL=http://img193.imageshack.us/i/page44planche06.jpg/][IMG]http://img193.imageshack.us/img193/3062/page44planche06.jpg[/IMG][/URL]
t bien la plaine au nord de l’oppidum !-
@ charles de lorgeril
Bonjour.
Je commencerai par dire que je suis franc-comtois d’origine et que je n’ai aucune hostilité à l’égard de ceux qui demandent aux archéologues officiels de s’expliquer sur leurs contradictions. En revanche, je serai beaucoup plus critique à l’égard de ces derniers dont je me demande s’ils ne font pas en sorte d’embrouiller cette affaire d’Alésia pour cacher des erreurs beaucoup plus graves telles que les localisations de Bibracte et de Gergovie.
Il faut vous dire, en effet, que je n’ai jamais pu ouvrir un vrai débat avec les archéologues du mont Beuvray, ni avec ceux qui les soutiennent, y compris le ministre de la Culture, sur ces deux questions. C’est le débat médiatique sur Alésia qui perdure, ce qui arrange bien les archéologues officiels.
Il faut donc me résoudre à entrer dans la polémique d’Alésia si je veux me faire entendre, ce qui n’était pas mon but, au départ.
Madame Danielle Porte vient de m’adresser un mail. Je vais étudier sa proposition.
Cordialement
-
M Mourey, vous voulez donc débattre d’Alésia, que vous estimez se situer à Alise, pour faire entendre votre opposition à l’emplacement présumé de Bibracte et de Gergovie ?
J’ai du mal à comprendre votre tactique.
-
@ blurpy
Ce n’est ni une tactique ni une stratégie mais seulement une intervention dans un débat nécessaire.
-
Pas une tactique, ni une stratégie ? Vraiment ? Je vous cite : "Il faut donc me résoudre à entrer dans la polémique d’Alésia si je veux me faire entendre, ce qui n’était pas mon but, au départ." Donc une entourloupe rhétorique ?
-
@ Ægidius REX
De tous les commentateurs que j’ai rencontrés sur le site d’Agoravox, vous êtes le seul latiniste de qualité en qui j’ai confiance. J’aimerais avoir votre avis, et éventuellement votre soutien en tant que latiniste, notamment pour ce présent article. Que pensez-vous de ma traduction ?
Comme vous le savez probablement, un grand parc archéologique est en cours de réalisation à Alise-Sainte-Reine. Pour ma part, je ne suis pas opposé à cette réalisation mais au message qu’on veut y mettre. L’enseignement que les responsables du projet tirent de cet évènement et qu’ils veulent transmettre aux enfants des écoles est un message absurde d’anti-nationalisme, de défaitisme et de renoncement identitaire.
Alors qu’il s’agit là d’une des plus grandes batailles de l’antiquité, se démarquer ainsi du sacrifice de ceux qui nous ont précédés sur le sol de la patrie ne sera interprété par les touristes étrangers que comme le signe évident de la décadence de notre nation.
-
"un message absurde d’anti-nationalisme, de défaitisme et de renoncement identitaire.«
Vous avez raison M. Mourey, louons donc nationalisme et cet esprit identitaire !
Votre récupération des Gaulois dans cette quête maintenant avouée de nationalisme est exécrable ! Et, en outre, une erreur historique, car je doute qu’une patrie gauloise ait existé, et essayer de le faire croire aux lecteurs est une malhonnêteté intellectuelle.
Vos symboles nationaux et identitaires n’ont-ils pas été la cause de l’exploitation des amérindiens, des peuples de l’Afrique (ô vibrant esprit civilisateur, »nos ancêtres les gaulois" enseigné Ouadagoudou !), des horreurs de 14-18, de celles bien pires de 40-45, la liste serait longue...
Votre nation n’est pas celle des Gaulois !
Votre nation n’est pas celle de Vercingétorix !
Votre nation est constituée aujourd’hui de biens d’autres peuples que ces pauvres Eduens et Arvernes dont vous nous gavez. Votre France est la terre de Picards, de Lorrains, de Corses, de Catalans, mais aussi d’Italiens, d’Allemands, de Belges, d’Espagnols, bref d’Européens, et d’Africains (du nord et du sud), d’Asiatiques, ... Votre fantasme gaulois est un leurre nationaliste qui est tout aussi dangereux que les pires idéologies... -
@ Spartakus Freemann
Vous êtes toujours à côté de la plaque. Où lisez-vous que je fasse l’éloge du nationalisme ? J’ai toujours dit qu’il fallait étudier la civilisation gauloise comme une civilisation disparue, de même que la civilisation grecque, égyptienne, romaine et autres. Arrêtez de fantasmer dans un sens ou dans l’autre ! Ma dernière phrase concerne la réaction prévisible des visiteurs étrangers en constatant l’esprit de dénigrement systématique typiquement français dont vous êtes un parfait exemple.
-
M. Mourey, VOUS êtes à côté de la plaque car vous ne lisez même pas ce que vous écrivez !!!
Allons, comment dire que vous ne glorifiez pas le nationalisme alors que votre commentaire est un regret face à ce que vous appelez, je vous cite : "un message absurde d’anti-nationalisme, de défaitisme et de renoncement identitaire.«
Oui, les touristes étrangers qui interpréteront le message du site d’Alésia »comme le signe évident de la décadence de notre nation", je vous cite à nouveau.
Ayez, au moins, le courage de vos écrits.
Quant à la France, n’étant pas français, votre soufflet, je vous le retourne à la face !
En outre, à qui avez-vous envoyé cet appel dans votre commentaire ? Et doit-on rappeler ici que vous applaudissez à la récupération de vos textes sur des sites du FN ?
Je ne vous juge pas, je ne fais que relever VOS PAROLES, M. Mourey.
-
Bonjour Madame Porte,
Bonjour Monsieur Mourey !Toutes mes félicitatations pour l’organisation de ce débat contradictoire ! Je pense que, compte tenu de la qualité des intervenants, il ne pourra être que... passionnant !
Et j’espère bien qu’il sera public ! Que toute personne intéressée, comme moi, puisse le suivre !
Encore bravo pour votre courage et votre sincérité à chacun...
Charly-le-Breton...
-
Je souhaite bien du courage à cette pauvre Madame Porte. Un débat avec Monsieur Mourey...elle aura au moins l’occasion de comprendre ce qu’est un délire monomaniaque.
-
En quoi l’expression « délire monomaniaque » peut-elle être considérée comme une injure qui mériterait le repliement de mon message ?
Je ne fais qu’exprimer une opinion sur vos écrits et n’enfreins aucunement la charte de ce site.
Vous abusez de votre droit de rédacteur ce qui confirme votre incapacité à entendre les autres et valide mon message. -
@ M. Spartakus Freeman
copie @ Pie 3,14Vous êtes à côté de la plaque. Ce n’est pas moi qui mélange le passé et le présent mais les inspirateurs du projet du parc archéologique d’Alésia, objet de ma critique.
Et puis, question d’honneur, arrêtez vos commentaires maladifs et agressifs contre l’homme que je peux être, ou alors, agissez à visage découvert. Pouvez-vous m’assurer que vous n’êtes pas M. Claude Jousseaume, auteur de nombreux ouvrages ésotériques à l’usage du monde des sectes qui écrirait tantôt sous son nom tantôt sous le pseudonyme précité en fonction de la catégorie du public naïf à laquelle il s’adresse ? http://www.myspace.com/spartakusfreemann
-
@ M. Mourey, vous tombez dans le minable

Non, je ne suis pas M. Jousseaume qui va apprécier l’accusation que vous portez contre lui. Je lui en fais part et je ne doute pas des suites
Et je note à nouveau que vous m’accusez d’être un agissant au nom des sectes, d’où je vous repose la question : considérez-vous que la Franc-maçonnerie soit une secte ?
-
@ Spartakus Freemann
copie @ Pie 3, 14Voici un exemple, extrait de votre littérature http://blog.morgane.org/?p=31 :
Aujourd’hui, pour notre revue l’Inexistant, nous avons l’honneur, la joie, le privilège, que dis-je la grâce d’avoir obtenu un interview exclusif de Monsieur Spartakus FreeMann, cette célébrité du monde des arts & des lettres &, accessoirement, de l’ésotérisme.
Comment introduire un tel personnage ? Disons simplement qu’il est l’animateur de plusieurs sectes (dont la dernière en date, l’Eglise Gnostique Chaote, a défrayé la chronique par les partouzes organisées en pleine cathédrale d’Ucronie), il a écrit des oeuvres que personne n’a jamais pu lire sans se pisser dessus de rire, il organise souvent des soirées happening alcoolo-trash sur Arlon, le Luxembourg, Bruxelles, Paris, bref, un bourreau de travail, une idole pour beaucoup, surtout pour lui-même, euh Lui-Même, pardon.
Mesan : Bonjour Monsieur Spartakus. Tout d’abord, merci pour cette interview qui fut si difficile à obtenir.
Spartakus : Ouais, d’abord tu Me dis « Votre Sainteté & Grand Hiérophante Spartakus », ensuite, n’oublie pas que tu Me dois encore 10 plaques pour ta putain d’interview. Pour finir, baisse le froc & mets-toi à genoux que Je t’initie...
-
MDR





M. Mourey, vous m’avez déjà, sur un autre article, accusé d’être un sectaire, maintenant vous répliquez des textes satiriques écrits pour une revue, vous mélangez mon travail d’étude ésotérique et une pseudo activité sectaire, et ceci afin de vous dédouaner d’applaudir d’être publié sur des sites du FN ?
-
@ Spartakus Freemann
Alors, qui êtes-vous ?
-
Qui je suis n’a pas de sens dans ce qui nous occupe ici. Mon nom ne vous apporterait rien, car nous serions alors dans une optique ressortant de vos thèses et de mes centres d’intérêt.
Cela dit, je note donc que mes livres sur la Kabbale juive soient, pour vous, des écrits sectaires.
-
A Monsieur Mourey,
Evitez de vous adresser à moi lorsque vous repliez mes messages.
Il y a comme une contradiction, n’est-ce pas ? -
Inutile de replier les commentaires ou d’essayer d’amoindrir tes paroles Mourey, cela circule maintenant, et ta volonté de discuter avec les autorités académiques, et bien seront à la hauteur de tes monomanies...
-
Mon Frère C.J me dit que vous marchez sur de drôles de chardons là...
-
@ Modération
Il serait souhaitable que la modération d’Agoravox n’accepte pas sur ce site des individus connus, en France, pour leurs liens en rapport avec le monde des sectes et autres gourous. Ces gens-là qui sévissent sur le web y développent des sites et une propagande dont les naïfs sont les victimes.
Que les choses soient bien claires ! Je ne cherche à ouvrir des débats que sur des civilisations du passé. La civilisation gauloise en est une. Je laisse à d’autres les petites querelles politiques minables du monde présent. Je ne suis militant d’aucun parti. Ma municipalité socialiste que j’estime sait pour qui je vote puisqu’en cas d’absence, je délègue mon vote à un représentant UMP de l’opposition. Le représentant FN du département qui est venu me voir un jour le sait car je le lui ai dit.
En revanche, je ne suis ni sectaire ni impoli et refuse de céder au terrorisme verbal des fanatiques.
-
@ Mourey, je comprends ce que tu veux dire par un « court passage en Afrique du nord », tu es un lâche n’est-ce pas, juste bon à te dissimuler derrière la hiérarchie militaire, mais en face d’un homme tu couines comme un cochon à l’abattage et en appelles à la modération tout en acceptant l’idée de traiter avec le FRONT NATIONAL. Herem herem herem !
-
Et l’anarchiste, un sur cent comme dirait Ferré, te rigole à la face, lorsque tu accuses comme un une pastille du même nom en attente d’enfournement vélodrômesque ! Militaire et courage sont deux mots sans synonyme donc.
-
@ Mourey,
Je répète ACCUSEZ-VOUS ICI LA FRANC-MACONNERIE D’ETRE UNE SECTE ? -
-
Allez M. Mourey, usez de votre capacité à replier les commentaires qui vous dérangent. Il n’en reste pas moins, et j’y veille, que vos paroles soient répercutées là où elles le doivent. Un nom est parfois plus précieux que cela...
-
@ Mourey, je TE cite : "Il serait souhaitable que la modération d’Agoravox n’accepte pas sur ce site des individus connus, en France, pour leurs liens en rapport avec le monde des sectes et autres gourous."
Et tu ne vois même pas le ridicule dans lequel tu sombres, ô pauvre....
-
S’il ne chaud pas pas de parlementer avec le FN et si cela ne chaud pas ce site,les deux sombreront en HEREM. Et que cela soit dit dit sur Heretetz
-
En revanche, je ne suis ni sectaire ni impoli et refuse de céder au terrorisme verbal des fanatiques.
Yallah, innâ illahî, illa illaLlî wa rajïun
-
Messieurs,
Ni le sujet traité, ni Agoravox ne méritent un traitement pareil ! Pourriez vous avoir la décence d’aller vous insulter en privé et de n’utiliser ce fil de discussion que pour ce quoi il est fait ?
Merci d’avance.
-
@ Blurpy,
Excusez-moi, mais n’inversez pas les rôles. Je suis le premier à être diffâmé par M. Mourey qui m’accuse de choses très graves. C’est lui qui se déconsidère en agissant ainsi, mais où cela devient risible c’est qu’il fait appel à la modération pour être défendu.
Je crois que c’est bien le débat qu’a voulu M. Mourey, puisqu’il a soulevé le rôle dans l’image « nationaliste » de la France que pouvait jouer Alésia. Lui ayant remontré que selon moi il faisait erreur, sa seule répartie n’a été que de googliser mon nom afin d’aller chercher des informations sur mon compte et ensuite m’accuser de dérive sectaire - ce qui demeure de la DIFFAMATION.
Vous comprendrez donc, qu’au risque de polluer cet article, je ne puisse rester silencieux.
Cordialement, -
J’avoue être profondément surpris par le niveau des échanges , il me semblait qu’Agoravox pouvait se permettre un niveau d’exigence plus élevé .Je ne soutiens pas Emile Mourey dont je ne partage pas l’analyse sur l’interprétation à donner aux fonctions du futur muséoparc d’Alise-Ste-Reine , mais chacun doit pouvoir se permettre de donner un avis suivant ses convictions .Il me semble que considérer la défaite d’Alésia comme une défaite nationale alors même que cette notion n’existait pas à cette époque , est caricatural .Cela étant dit , la proposition de débat était intéressante et il serait dommage que des échanges de noms d’oiseaux viennent mettre un terme à un futur dialogue qui s’annonçait intéressant .La localisation d’Alésia qui n’est pas un jeu , mérite mieux que le dédain de l’archéologie officielle ou que les considérations politiques ou nationalistes de l’un ou de l’autre !-
Je pense que Madame Porte va se manifester dès qu’elle en aura le temps.
-
Les portes du comique sont enfoncées, voilà qu’on nous annonce un débat Mourey-Porte ! Mourey l’homme qui ment sans arrêt dans ses articles soi-disant historique, qui cache qu’il ment sur la traduction latine de coagmento - on lui a démontré ici même qu’il avait inventé un sens délirant -, qui ment sur l’architecture de l’église du crest qui ne serait, pour lui, rien moins que le centre de l’Atlantide, de Gergovie et du domaine de Sidoine Apollinaire tout cela à la fois, mais oui... Que le lecteur curieux aille voir mes commentaires antérieurs à partir de mon profil pour retrouver les démonstrations évidentes du délire, des mensonges de Mourey, de son absence non seulement de rigueur et de connaissance, on pourrait lui pardonner, mais tout simplement d’honnêteté intellectuelle, de scrupule, d’écoute. C’est un naufrage intellectuel pathétique, en direct sur le web. Et voilà qu’il se pique de défendre le site d’Alise, et bien c’est l’horloge arrêtée qui indique une fois par jour la bonne heure.
Sauf qu’évidemment Mourey ne défend Alise que pour de mauvaises raisons et ne saurait en aucun cas réellement défendre le site, il est incapable du b-a - ba de la méthodologie historique et est incapable de traduire du latin honnêtement, c’est-à-dire sans chercher à tordre le latin - jusqu’à inventer des sens nouveaux aux mots - pour le faire coller à son délire qui est, rappelons-le, que les églises romanes et pré-gothiques sont en fait des temples gaulois, gaulois qui étaient en fait des phéniciens... (et encore je vous passe la naissance du christiannisme en bourgogne et en Auvergne).
Mourey donc, on ne le présente plus... Passons un peu au reste.
Voilà que surgit à nouveau sur le net le débat sur Alise... AAaahh Alésia, combien de sites proposés sur internet, combien de ces débats en trompe l’oeil quand la communauté scientifique entière ne connaît plus aucun débat pour la simple et bonne raison que le site est connu, identifié au delà de tout doute raisonnable.
Mais Madame Porte alors vous me direz ?
Eh bien Madame Porte n’est ni archéologue ni historienne et se pencher sur ses ouvrages consacrés à Alésia permet de voir que ses compétences en latin ne peuvent suffire à compenser un manque complet de méthode, de connaissance scientifique dans les domaines historiques et archéologiques.
Madame Porte elle même n’est pas l’inventrice du site qu’elle défend, Chaux. Il faut donc un peu faire l’histoire de ce site.
Ce site a été promu par un archiviste paléographe qui s’était reconverti, sur le tas, en Algérie en archéologue, André Berthier, professeur charismatique mais historien sans méthode, sans recul épistémologique. S’étant vu confié des fouilles en Algérie française, Berthier se mis en tête de vouloir retrouver les campagnes militaires romaines en Numidie à partir d’une lecture sans recul critique - c’est-à-dire sans le travail nécessaire à tout historien - des textes.
Monsieur Berthier a donc alors délocalisé toute la Numidie et sa capitale, Cirta qui était identifiée sans doute possible, réduisant le puissant royaume de Numidie antique à un croupion situé en Tunisie, rendant incompréhensible toute l’histoire romaine du maghreb. Evidemment il n’a convaincu personne à part quelques élèves et quelques personnes qui se trouvaient flattée par sa relocalisation. Le comique c’est quand même qu’en fouillant Tiddis (enfin en dégageant les ruines à la pioche) ville de la confédération cirtéenne, Berthier travaillait au coeur même du royaume numide dont il déniait la grandeur, à quelques kilomètres seulement des grands témoins architecturaux de cette puissance qu’il biffait d’un trait de plume, des monuments comme le Medracen.
La plaisanterie a duré quelques articles, quelques livres, elle est aujourd’hui bien oublié à part de gens qui n’ont rien à voir réellement avec l’histoire. le fin mot de l’histoire avait été dit par gabriel camps : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0035-1474_1982_num_33_1_1945
Avec toute la diplomatie du genre, une de ses notices nécrologiques se concluait un peu ainsi « il n’avait jamais renoncé à ses deux cirta », bref perseverare diabolicum.
La même notice ne mentionnait pas bien sûr ses « travaux » sur alésia, au moment de sa mort on préféra mettre l’accent sur la publication assez récente de ses fouilles passées sur Tiddis, un demi siècle pour publier... Ses thuriféraires disent que fuyant les honneurs Berthier ne se souciait pas d’une gloire obtenue en publiant. Plus crument on pourrait dire autres choses...
Passons.
Dans le désoeuvrement sans doute consécutifs à l’arrêt des fouilles dues à la guerre d’Algérie, Berthier se consacra à la localisation d’Alésia qui pensait-il faisait problème.
Las Berthier se penchait sur un débat qui était tranché au moment même où il se mettait à réfléchir dessus. La fin des années 1950 et le début des années 1960 virent en effet la reprise des fouilles à Alise avec plus de méthode et de sérieux que jamais jusqu’alors par Joël Le Gall - entre autres. Mais surtout ce savant pratiqua la recherche en archive, retrouvant les archives des fouilles de Napoléon III si décrié alors.
Or ce que Le Gall découvrit c’est que ces fouilles, malgré les limites scientifiques dues à l’époque, avaient été honnête et scrupuleuses, d’une probité qui apparaissait sans contestation possible : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1960_num_104_1_11144 et http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1961_num_105_1_11269
Il y avait plus encore. Un authentique amateur venu totalement du dehors de l’université et du sérail avait, quelques années auparavant, entraînait une révolution scientifique en obligeant à reconsidérer toute la numismatique celtique, il s’agit du docteur Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu, exemple qui montre que contrairement aux ragots des ennemis d’alise les universitaires savent dire quand ils ont tort lorsqu’un non universitaire le montre. Or les travaux de Colbert de Beaulieu démontrèrent sans aucune réfutation possible que les trouvailles monétaires d’Alésia était authentiques et correspondaient donc bien à ce que l’on pouvait attendre de monnaies perdues par l’armée romaine de césar et par l’armée gauloise de vercingétorix. Dans son ouvrage coécrit avec Wartelle Berthier qui cite Colbert de Beaulieu se garde bien de le dire, de le signaler, ni même de chercher à le réfuter dans des passages d’une mauvaise foi scientifique absolument scandaleuse.
Mais continuons... Colbert de Beaulieu montra que si les fouilles d’Alise avaient été scrupuleuse leur publication avait été biaisé. les fouilleurs avaient trouvé des monnaies de vercingétorix en métal vil, chose unique. pour plaire à l’empereur sans doute on joua la confusion avec des monnaies en or venu d’auvergne, pensant sans doute qu’il était plus digne pour un empereur qu’on présente des monnaies en or. Mais précisément une monnaie en or banale ne prouverait rien, des monnaies en métal vi, frappées avec le même coin monétaire, montraient bien que l’on était dans une situation de siège, d’urgence et de manque de matière première noble : vercingétorix acculé usait de tous les expédients et fut obligé de frapper des monnaies de mauvais métal avec les outils destinés à une frappe en or. Or on ne pouvait comprendre cela avant les travaux de Colbert de Beaulieu, et la volonté même des fouilleurs de Napo III de masquer leur trouvaille - présentant une monnaie en or - montre qu’ils n’avaient pas compris l’importance de leur trouvaille. Ces monnaies dites obsidionales - de siège - sont absolument uniques et pour cause à quel autre endroit que dans son dernier siège désespéré Vercingétorix aurait-il pu faire frapper de tels monstres numismatiques. (Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu, « La Localisation d’Alésia et la numismatique gauloise », dans Ogam, 1956, 2, pp. 111-136 avec planche 4-7 et encore « Les Monnaies de bronze de Vercingétorix : faits et critique », Cahiers numismatiques, 1967, 13-déc., pp. 356-372 ainsi que « Epilogue numismatique de la question d’Alésia », dans Mélanges d’archéologie et d’histoire offerts à André Piganiol, Paris, 1966, pp. 321-342 et encore http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/galia_0016-4119_1970_num_28_1_2542
Voilà ce qui était révélé au moment ou Berthier ignorant l’état réel du champ scientifique se met en quête d’une alésia que tout le monde désormais va savoir à alise.
Et le savoir d’autant plus précisément que R. Goguey commence à pratiquer la photographie aérienne dans la région et mettre en évidence les travaux du siège :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1991_num_135_1_14937
Enfin une reprise des fouilles fit justice de l’histoire abracadabrantesque des nombreux sièges que la ville aurait connu (histoire que nous reserve pourtant en permanence les gens de Chaux).
Dès 1969 la question était donc tranchée : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1969_num_24_2_422069_t1_0441_0000_1
Mais Berthier s’escrimait alors depuis des années sur un portrait-robot orienté, biaisé et non nécessaire.
et comme pour la Numidie il s’entête ensuite sa vie durant dans une hypothèse vide, non nécessaire, totalement dépassée qui ne fonctionne qu’auprès de gens peu au fait de la méthode historique.
Son hypothèse est finalement présentée officiellement dans un colloque à Dijon au début des années 1980 où elle se fait atomiser, Gilbert-Charles Picard lui répondant par un article « Alésia ou comment résoudre un problème qui n’existe pas ». les retombées se trouvent dans divers articles dont l’un paru dans la Revue Archéologique de l’Est en 1984.
Bénéficiant d’appuis, comme Malraux, Berthier avait pourtant pu « fouiller » sur son site, Chaux. Rien n’a jamais été publié selon des procédures scientifiques et les gens sérieux qui l’accompagnaient quittèrent le navire en se rendant compte de ses erreurs. Des tas d’épierrements furent pris pour des monuments, une grange du XIXe pour un batiment antique, le médiéval confondu avec le romain, la fin de l’antiquité avec la république. l’avis des archéologues compétent est sans appel on peut le lire dans la carte archéologique de la Gaule consacré au Jura.
Berthier et ses fidèles s’enfoncèrent alors dans le délire : les murs de pierres séparant les parcelles retenant les terrains deviennent des murs cyclopéens, des murs mycéniens, et quand ils trouvent ce qu’ils croient être du gaulois au dessus d’un niveau médiéval, plutôt que de se dire que la stratigraphie est sans appel, ils invoquent des résurgences culturelles amenées par la peste ... Tout cela est malheureusement authentique.
Ce triste naufrage intellectuel - Berthier avait incontestablement des qualités de prof voir de savant - n’est plus soutenu que par des gens extérieurs - cinéaste, géométres, locaux en quête de gloire, de rêve ou de mane touristique - par un journaliste incapable de se rendre compte que les sites historiques ne sont pas là pour conforter les fantasmes et par Madame Porte qui témoigne de constance dans son soutien à Berthier mais aussi dans son ignorance de la méthode archéologique et historique.
Face à cela à Alise les fouilles faites dans les années 1990 ont confirmé ce que tout le monde savait déjà, on été publiées rapidement, reconnues comme exemplaires par les savants du monde entier et voient leur résultats confortés par toute nouvelle progression dans la connaissance de la fin de la Gaule indépendante.
ici un article scientifique sur le début de ces campagnes de fouilles : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1993_num_137_2_15213
Alise est une aventure intellectuelle et scientifique qui s’étale sur plusieurs siècle et dont le grand public est tenu éloigné à cause de ces stupides pseudo-débat, autant continuer à débattre sur l’héliocentrisme.... Michel Reddé un des principaux fouilleurs d’alise dans les années 1990 et grand connaisseur de l’armée romaine a tenté de faire passer l’état réel des connaissances scientifiques dans un ouvrage intitulé alésia ou l’archéologie face à l’imaginaire, hélas, l’imaginaire, monsieur Mourey et Madame Porte le montrent est un monstre sans raison qui produit les pires entêtement.
Mais alors me direz-vous : le texte de césar est-ce qu’il colle au site d’Alise...
Oui dans ses grands traits, pas toujours dans les détails, pas du tout sur certaines questions.
Donc vous voyez bien qu’Alise ne peut pas être alésia et c’est repartie pour un tour ?
Non car César n’est pas un topographe, par un géomètre, par un reporter, c’est un homme politique à la veille d’une guerre civile, autant demander si l’Irak de Colin Powell correspondait au pays que les américains ont envahi.
Mais plus encore : César est un auteur, un écrivain qui doit se plier aux lois du genre historiques, aux codes attendus par ses lecteurs, autant de choses très fortes dans l’antiquité : alors son récit colle parfois plus au « lieu commun » du récit de siège qu’à la réalité du terrain, mais c’était la règle : les historiens de l’antiquité ne sont pas des collègues de ceux du XXIe siècle ni même du XXe, cela Momigliano et d’autres l’ont montré, chercher Alésia avec uniquement le texte latin de césar c’est courir après un trompe l’oeil.
Aller... d’autres liens pour ceux qui n’ont plus envie de perdre leur temps avec les Mensonges de Mourey et les fantasmes de Porte :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1961_num_105_1_11269
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/numi_0484-8942_2004_num_6_160_2550-
Comme il doit etre confortable de hurler avec les loups.
Samosatensis, désolé mais votre commentaire n’est pas constructif.
En fait si : c’est un bon résumé de la position officielle. Au moins maintenant le lecteur d’Agoravox non averti du problème Alesia en connaîtra grâce à vous toute la mauvaise fois et la trivialité.Merci pour lui.
-
@ Samosatensis
Tout ce que vous savez faire est de proférer des insultes. Parce que vous êtes incapables de raisonner correctement, vous avez toujours refusé le débat avec Mme Danielle Porte à laquelle je reconnais au moins le mérite d’avoir soulevé de légitimes questions sur les points litigieux de vos publications... l’emplacement de la grande bataille de cavalerie qui a précédé le siège d’Alésia et que Vercingétorix perdit... le dispositif des retranchements et des obstacles romains qui, d’après vous, ne correspondraient qu’approximativement au texte césarien... le déroulement de la bataille et l’emplacement des vestiges... les témoignages d’autres auteurs qui pourraient faire penser que la bataille se déroula en Séquanie... etc.
En fait, vous ne faites, dans votre commentaire, que reproduire des archives tout en répétant cette absurdité que, je vous cite, César est un auteur, un écrivain qui doit se plier aux lois du genre historiques, aux codes attendus par ses lecteurs, autant de choses très fortes dans l’antiquité : alors son récit colle parfois plus au "lieu commun" du récit de siège qu’à la réalité du terrain...
Soyez modeste, M. le professeur ! Avec vos insuffisances manifestes dans la connaissance de la langue latine, votre totale nullité en stratégie et en tactique, votre jugement prétentieux sur César est scandaleux. Il prouve, une fois de plus, que vous n’avez rien compris et que vous ne comprendrez jamais rien à l’histoire antique et à l’esprit de ceux qui en étaient les acteurs.
Vous vous affublez de méthode, de rigueur, d’esprit soi disant scientifique. Tout cela ne sont que des mots avec lesquels vous cherchez à faire illusion auprès des lecteurs naïfs. Vous êtes dans la bien pensance et faites chorus avec elle. Vous vous referez aujourd’hui au professeur Le Gall, mais où étiez-vous en 1981 lorsque le site d’Alise était violemment contesté par la bien pensance dont vous êtes un triste représentant ? Et bien moi, j’étais à Alise-Sainte-Reine, et bien seul. J’avais alors pris publiquement position en faveur du site. Le journal Le Monde l’avait mentionné dans son édition du 11.11.1981 en citant mon nom et mon grade de lieutenant-colonel.
Vous n’allez tout de même pas prétendre que le Monde a menti. En fait de menteur, c’est vous qui persistez dans le mensonge en continuant à prétendre que Bibracte se trouvait au mont Beuvray et en esquivant de répondre franchement et clairement à mes arguments http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/arioviste-etait-il-un-germain-ou-71208.
-
@ Samosatensis
« Non car César n’est pas un topographe, par un géomètre, par un reporter, c’est un homme politique à la veille d’une guerre civile, autant demander si l’Irak de Colin Powell correspondait au pays que les américains ont envahi.
César est un auteur, un écrivain qui doit se plier aux lois du genre historiques, aux codes attendus par ses lecteurs, autant de choses très fortes dans l’antiquité : alors son récit colle parfois plus au »lieu commun« du récit de siège qu’à la réalité du terrain... »
Ce qui est surtout surprenant dans cette argumentation , c’est son côté suranné .Reprendre la vieille rhétorique qui assimile l’œuvre de César à de la pure propagande , est typique des années antérieures aux dernières fouilles , aux heures glorieuses où tous les moyens étaient bons pour valider alise-Ste-Reine , y compris le dénigrement du texte .Même Reddé dans son ouvrage « Alésia , l’archéologie face à l’imaginaire » , pose comme principe la crédibilité de l’œuvre , il se contente alors de relever les incohérences entre le texte et le terrain en les minimisant .Je conseille à Samosatentis de se mettre à jour en consultant deux ouvrages essentiels , l’un établit ( ou rétablit ) la crédibilité des auteurs antiques , en confrontant les textes à l’archéologie , l’autre utilise abondamment l’intégralité de la guerre des Gaules , en confrontant chaque passage aux artefacts ou aux techniques de guerre utilisés par les Gaulois .Dans les deux cas , la crédibilité du texte de César en sort renforcée !Les Celtes , histoire et dictionnaire , Wenceslas Kruta , 2000 .Les Gaulois en guerre , stratégies , tactiques et techniques , Alain Deyber , Décembre 2009 .-
@Bellovese,
à quel moment avez-vous vu que je ne posai pas comme principe « la crédibilité de l’oeuvre » ?C’est précisément parce qu’il est crédible que le texte de césar peut-être orienté politiquement, d’où ma comparaison avec Colin Powell : il était crédible, totalement crédible, cela ne l’empêchait pas de mentir parfois ou de cacher la vérité. Affirmer la crédibilité de césar ce n’est pas en faire un article de foi intouchable, au contraire. Vous êtes un peu naïf de supposer que je ne connais pas les deux ouvrages que vous mentionnez - qui au demeurant soutiennent tout deux clairement et logiquement Alise (voir ainsi Kruta p. 400 qui parle de controverses définitivement résolues) et ne disent pas le contraire de ce que je disais, le disant juste de manière plus académique - mais j’essaie précisément de faire passer le message en appuyant un peu sur ce que la plupart des gens ignorent.Je cite Kruta lorsqu’il parle de l’ensemble de la production historiographique romaine « la perspective dans laquelle furent rédigés ces textes consacrés aux relations entre Rome et les Gaulois, le plus souvent à partir d’information de seconde main, leur imprima évidemment une orientation philoromaine qui a fréquemment pour conséquence des déformations et des omissions, ainsi que l’introduction de lieux communs et de notices de caractères anecdotique ou légendaire » (p. 63, c’est moi qui souligne). Vous notez que Kruta utilise la même expression que moi « lieux communs », c’est à dire les topoï de la formation rhétorique.Vous citez Reddé dans son « Alésia, l’archéologie face à l’imaginaire », je ne saurai trop vous conseiller d’aller lire ce qu’il a écrit dans la publication des fouilles d’Alésia en deux volumes. Je vous cite « pose comme principe la crédibilité de l’œuvre , il se contente alors de relever les incohérences entre le texte et le terrain en les minimisant », tout le monde pose comme principe la crédibilité de l’oeuvre, sinon personne n’utiliserait césar, quand vous dite qu’il se contente alors de relever les incohérence en les minimisant, ce n’est absolument pas vrai. D’une part il ne les minimise pas, M. Reddé n’a jamais masqué les écarts textes-terrain mais il les replace à leur juste importance en les expliquant, et les expliquer ce n’est pas se contenter de les relever, pour avoir accés au détail de ces explications il faut aller lire la publication des fouilles en deux volumes en particulier le chapitre fondamental « le siège d’alésia : récit littéraire et réalité du terrain » à partir de la page 489 notez par exemple page 502 à propos des écarts terrains/textes à Numance : « on voit combien, en dehors même de la »querelle alésienne« , il convient d’être prudent dans l’usage des textes antiques et combien la description littéraire peut différer de la réalité archéologique malgré le sérieux et la célébrité de son auteur » (il parle ici de Polybe transmis par Appien mais cela s’applique aussi évidemment à César). Dès lors l’écart texte-terrain s’explique par l’utilisation de lieu-commun, par les régles du genre historique, ainsi vous avez l’explication des trois séries de pièges page 505 par comparaison avec un texte de Philon de Byzance « Il n’est donc pas question de nier l’écart entre les données de terrain et la description césarienne, qui témoigne sans doute autant de la culture littéraire que de la science militaire du proconsul, mais il serait tout aussi excessif de s’y attarder plus longuement ». on peut aussi renvoyer aux conclusion des pages 561 et 562.Si vous trouvez suranné les règles de base de la méthode historique peut-être faudrait-il songer aussi à vous plaindre des physiciens qui utilisent des principes mathématiques qui eux non plus ne bougent pas, c’est très suranné tout cela .Je vais pour finir donner un exemple simple de comment César peut être à la fois crédible et orienté. En I, 45 il décrit la conquête de la Transalpine et dit « les Arvernes et les Rutènes avaient été vaincus par Q. Fabius Maximus ». Là il est exact et factuel, sa précision sur les Rutènes par exemple ne figure pas dans bien d’autres sources. Mais en même temps il est totalement partial parce que la victoire sur les Arvernes devaient aussi beaucoup à Domitius Ahenobarbus (vous connaissez sans doute la voie domitienne et vous remarquerez que l’on ne parle pas de voie fabienne
.Je vais pour finir donner un exemple simple de comment César peut être à la fois crédible et orienté. En I, 45 il décrit la conquête de la Transalpine et dit « les Arvernes et les Rutènes avaient été vaincus par Q. Fabius Maximus ». Là il est exact et factuel, sa précision sur les Rutènes par exemple ne figure pas dans bien d’autres sources. Mais en même temps il est totalement partial parce que la victoire sur les Arvernes devaient aussi beaucoup à Domitius Ahenobarbus (vous connaissez sans doute la voie domitienne et vous remarquerez que l’on ne parle pas de voie fabienne ). Bref Fabius et Domitius étaient politiquement opposés, chacun revendiqua la victoire et tout deux y avaient contribué, César effectue un choix très clair en choisissant de faire comme si Domitius n’avait jamais existé précisément sans doute parce qu’un des héritiers de Domitius était un de ses adversaires politiques et que les Domitii revendiquaient vraisemblablement pour eux seuls la gloire de la victoire sur les arvernes (voir le début de la vie de néron par suétone). Bref un récit crédible, une source sur laquelle on peut s’appuyer mais jamais sans oublier son côté partial et littéraire, jamais sans cesser d’appliquer la méthode historique (critique interne, critique externe, recoupement des informations etc). Il serait temps Bellovese de sortir des simplismes et de vous pencher d’un peu plus prêt sur cette méthodologie.@Blurpymauvaise foi ? non constructif ? ha ha ha. Que les opposants à Alise commence par réfuter Colbert de Beaulieu - c’est à dire quelque chose qui a désormais 50 ans - et produisent un travail archéologique ayant une qualité minimale si on veut les entendre, la dénégation que vous pratiquez ne mène nulle part et ne vous fera certainement pas prendre au sérieux.@ Mourey.Vous le savez je ne débat pas, je ne discute pas avec vous. Vous savez aussi pertinement que j’ai prouvé que vous ne savez pas traduire le latin car vous inventez des sens nouveaux aux mots selon votre caprice (le désormais fameux coagmento), car vous êtes incapable de différencier un sens littéral d’un sens figuré, car vous avez montré que vous ne savez même pas vous servir du gaffiot, car vous vous revendiquez du mot à mot, car vous n’êtes pas choqué de donner un sens différent au même mot à quelques lignes d’écart. Vous savez aussi que j’ai montré que vous ne connaissiez même pas l’église du crest sur laquelle vous fondez vos délires (5 fenêtres et non 3 dans l’abside).Vous mentez encore à propos de l’époque où le site d’alise aurait été violemment contesté, comme le prouve explicitement l’article de chastagnol de 1969 - et de nombreux autres - le site d’alésia n’a plus été violemment contesté depuis les années 1960 : il faudrait différencier les fantasmes des journalistes et l’état réel du champ scientifique, il y a quelques mois un journaliste a à nouveau publié un livre où il présentait la thèse de chaux comme une révélation et canal plus a diffusé une émission favorable à cette thèse, faut-il dire que le site d’alise a été violemment contesté ? Personne, personne dans la communauté des historiens ni des archéologues n’appuie un autre site, et c’était quasiment la même chose en 1981, Berthier étant un épiphénomène qui a été vite ramené à sa juste importance.Bref parce que le professeur Le Gall s’est sans doute montré courtois et charitable envers vous et parce qu’un journaliste, une fois, vous a cité, vous vous êtes fantasmé en sauveur d’alise et en grand manitou de l’histoire antique nationale, mais c’est seulement votre imagination : vous n’avez rien publié dans aucune revue scientifique, aucun colloque, vous n’avez aucune méthode, et vous revendiquez même cette absence de méthode, vous n’avez aucune référence bibliographique vous contentant de piocher dans internet et dans des ouvrages du XIXème dépassé, vous n’avez aucune formation historique ou philologique. Même tactiquement et stratégiquement vous êtes nul : avez-vous publié dans ces domaines ? Cessez de vous faire passer pour le Jomini, le Clausewitz ou le Castex de la guerre des Gaules, qui vous a écouté, qui vous a repris,qui vous a cité en dehors de cet unique article de journal, est-ce que 6 ans plus tard on vous a appelé pour le numéro spécial de la Revue Historique des Armées ?Enfin vous savez que j’ai répondu clairement à tous vos pseudo arguments et que c’est vous qui n’avez jamais répondu chaque fois que j’ai pointé l’un de vos gros mensonges :- coagmento n’a jamais voulu dire cimenté en latin, on attend encore votre réponse- il y a 5 et non 3 fenêtre dans l’abside de l’église du crest ce qui rend ridicule votre assimilation déjà impossible de cette abside aux thermes de sidoine- sur les amphores du beuvray vous n’avez même pas été capable de saisir la base de ce dont il est question- sur les études stylistique du vase de vix que vous attribuez aux arvernes- sur les monnaies à bibracte où le seul exemple que vous avez pris est hors sujet (kaletedu) et où vous n’expliquez pas que dans ce qui est selon vous une garnison arverne <sic !> on n’ai retrouvé en tout et pour tout que 4 monnaies arvernes sur plusieurs milliers - les principales trouvailles étant bien sûr des monnaies éduennes.et je pourrai continuer très longuement…Mourey vous savez que vous mentez, vous savez que vous délirez, qu’aucun de vos articles ne tient face aux faits et face à aucune discipline scientifique, vos conversation avec Bad Guru - dont je salue ici les qualités - l’ont bien montré dans d’autres domaines que l’archéologie et l’histoire gallo-romaine.Vous savez aussi que plus personne ne vous prend au sérieux, sinon vous ne seriez pas sans arrêt à espérer un débat, c’est pathétique. Pathétique pour vous et pour ce site désormais discrédité un peu plus à chaque fois que vous y présenté un article
). Bref Fabius et Domitius étaient politiquement opposés, chacun revendiqua la victoire et tout deux y avaient contribué, César effectue un choix très clair en choisissant de faire comme si Domitius n’avait jamais existé précisément sans doute parce qu’un des héritiers de Domitius était un de ses adversaires politiques et que les Domitii revendiquaient vraisemblablement pour eux seuls la gloire de la victoire sur les arvernes (voir le début de la vie de néron par suétone). Bref un récit crédible, une source sur laquelle on peut s’appuyer mais jamais sans oublier son côté partial et littéraire, jamais sans cesser d’appliquer la méthode historique (critique interne, critique externe, recoupement des informations etc). Il serait temps Bellovese de sortir des simplismes et de vous pencher d’un peu plus prêt sur cette méthodologie.@Blurpymauvaise foi ? non constructif ? ha ha ha. Que les opposants à Alise commence par réfuter Colbert de Beaulieu - c’est à dire quelque chose qui a désormais 50 ans - et produisent un travail archéologique ayant une qualité minimale si on veut les entendre, la dénégation que vous pratiquez ne mène nulle part et ne vous fera certainement pas prendre au sérieux.@ Mourey.Vous le savez je ne débat pas, je ne discute pas avec vous. Vous savez aussi pertinement que j’ai prouvé que vous ne savez pas traduire le latin car vous inventez des sens nouveaux aux mots selon votre caprice (le désormais fameux coagmento), car vous êtes incapable de différencier un sens littéral d’un sens figuré, car vous avez montré que vous ne savez même pas vous servir du gaffiot, car vous vous revendiquez du mot à mot, car vous n’êtes pas choqué de donner un sens différent au même mot à quelques lignes d’écart. Vous savez aussi que j’ai montré que vous ne connaissiez même pas l’église du crest sur laquelle vous fondez vos délires (5 fenêtres et non 3 dans l’abside).Vous mentez encore à propos de l’époque où le site d’alise aurait été violemment contesté, comme le prouve explicitement l’article de chastagnol de 1969 - et de nombreux autres - le site d’alésia n’a plus été violemment contesté depuis les années 1960 : il faudrait différencier les fantasmes des journalistes et l’état réel du champ scientifique, il y a quelques mois un journaliste a à nouveau publié un livre où il présentait la thèse de chaux comme une révélation et canal plus a diffusé une émission favorable à cette thèse, faut-il dire que le site d’alise a été violemment contesté ? Personne, personne dans la communauté des historiens ni des archéologues n’appuie un autre site, et c’était quasiment la même chose en 1981, Berthier étant un épiphénomène qui a été vite ramené à sa juste importance.Bref parce que le professeur Le Gall s’est sans doute montré courtois et charitable envers vous et parce qu’un journaliste, une fois, vous a cité, vous vous êtes fantasmé en sauveur d’alise et en grand manitou de l’histoire antique nationale, mais c’est seulement votre imagination : vous n’avez rien publié dans aucune revue scientifique, aucun colloque, vous n’avez aucune méthode, et vous revendiquez même cette absence de méthode, vous n’avez aucune référence bibliographique vous contentant de piocher dans internet et dans des ouvrages du XIXème dépassé, vous n’avez aucune formation historique ou philologique. Même tactiquement et stratégiquement vous êtes nul : avez-vous publié dans ces domaines ? Cessez de vous faire passer pour le Jomini, le Clausewitz ou le Castex de la guerre des Gaules, qui vous a écouté, qui vous a repris,qui vous a cité en dehors de cet unique article de journal, est-ce que 6 ans plus tard on vous a appelé pour le numéro spécial de la Revue Historique des Armées ?Enfin vous savez que j’ai répondu clairement à tous vos pseudo arguments et que c’est vous qui n’avez jamais répondu chaque fois que j’ai pointé l’un de vos gros mensonges :- coagmento n’a jamais voulu dire cimenté en latin, on attend encore votre réponse- il y a 5 et non 3 fenêtre dans l’abside de l’église du crest ce qui rend ridicule votre assimilation déjà impossible de cette abside aux thermes de sidoine- sur les amphores du beuvray vous n’avez même pas été capable de saisir la base de ce dont il est question- sur les études stylistique du vase de vix que vous attribuez aux arvernes- sur les monnaies à bibracte où le seul exemple que vous avez pris est hors sujet (kaletedu) et où vous n’expliquez pas que dans ce qui est selon vous une garnison arverne <sic !> on n’ai retrouvé en tout et pour tout que 4 monnaies arvernes sur plusieurs milliers - les principales trouvailles étant bien sûr des monnaies éduennes.et je pourrai continuer très longuement…Mourey vous savez que vous mentez, vous savez que vous délirez, qu’aucun de vos articles ne tient face aux faits et face à aucune discipline scientifique, vos conversation avec Bad Guru - dont je salue ici les qualités - l’ont bien montré dans d’autres domaines que l’archéologie et l’histoire gallo-romaine.Vous savez aussi que plus personne ne vous prend au sérieux, sinon vous ne seriez pas sans arrêt à espérer un débat, c’est pathétique. Pathétique pour vous et pour ce site désormais discrédité un peu plus à chaque fois que vous y présenté un article-
@ Samosatensis
copie @ AntenorPrimo. Au sujet du mot « coagmento », c’est le serpent qui se mord la queue. Parce que les archéologues prétendaient et prétendent toujours que les Gaulois ne connaissaient pas l’usage de la chaux, ils ne voyaient de gaulois que des murs aux pierres encastrées et de romain, des murs maçonnés. Et parce que les archéologues disaient cela, les traducteurs du texte latin, tels que le professeur Constans, n’ont pas osé traduire le mot « coagmento » autrement que par « encastrées », en 1926. Et c’est ainsi que Gaffiot a suivi dans son dictionnaire de 1934. Et parce que le Gaffiot donne cette traduction, les bons petits soldats, comme Samosatensis, continuent à répandre cette monumentale connerie, alors que n’importe quel étymologiste sait que le suffixe latin« co » évoque quelque chose de solidement aggloméré. La conséquence est cette autre connerie qui fait que les archéologues se refusent à voir les remparts cimentés de la ville gauloise de Bourges dans les vestiges encore existants.
Secundo. Concernant l’église du Crest, Samosatensis fonde son commentaire sur le fait qu’elle aurait cing fenêtres dans l’abside alors que j’ai écrit qu’elle avait trois ouvertures. Samosatensis a tort. Il n’existe que trois ouvertures ; les deux fenêtres latérales sont des fausses fenêtres qui n’ont jamais été ouvertes sur l’extérieur. Mais ce n’est qu’un détail qui ne change rien au fait que Samosatensis est incapable de fournir un texte qui donne une date de fondation à ce monument.
Tertio. Concernant la polémique d’Alésia, Samosatensis dit que le site d’Alise n’était plus contesté en 1981, et cela depuis 1960. C’est faux ! C’est justement l’époque où la querelle avait repris de l’ampleur dans les médias, notamment avec les publications des frères Wartelle. La Revue Historique des Armées leur ouvraient encore ses colonnes en 1975, 1979 et 1983 et ma revue Casoar avait pris parti pour l’Alésia franc-comtoise.
Quarto. Concernant les monnaies du mont Beuvray, Samosatensis est en pleine confusion. Si les monnaies éduennes s’y trouvent en grand nombre, c’est, comme je le lui ai dit, parce que les Eduens y brûlaient leurs morts en jetant quelques pièces de monnaies dans le bûcher. S’il ne s’y trouve que peu de monnaies arvernes, c’est parce que les Arvernes brûlaient leurs morts à Corent, en Auvergne. Que si la monnaie Kaletedu s’y trouve, c’est parce que cette monnaie était éduenne et non séquane comme l’a proposé M. Colbert de Beaulieu. Et parce que cette monnaie était éduenne, cela signifie que les monnaies Kaletedu retrouvées dans les fouilles d’Alise prouvent un engagement militaire éduen dominant dans la bataille d’Alésia et une absence de troupes séquanes, ce qui est dans la pure logique politique et militaire de l’époque. Inutile de faire appel à Clausewitz. C’est une simple question de bon sens.
Quant au reste du commentaire de cet intervenant, rien de nouveau. Samosatensis est un bon petit soldat de M. Christian Goudineau et de la bien-pensance actuelle.
-
Personnellement , je n’ai jamais cru Colin Powell , les ficelles étaient trop grosses ...Par contre , l’utilisation de lieux communs concernant la topographie que donne César reste à démontrer , si il est facile de comprendre pourquoi César aurait pu mentir sur ses motivations et ses méthodes , on comprend mal pourquoi il nous aurait laissé une topographie erronée quand il est si simple de décrire ce qu’on a sous les yeux , nul besoin d’être géomètre pour cela .Et de ce cote là , à Alise comme à Gergovie d’ailleurs , on ne peut pas dire que la description de César soit en accord avec le terrain qu’on nous présente , mais nous sommes là sur un débat sans fin .« D’une part il ne les minimise pas, M. Reddé n’a jamais masqué les écarts textes-terrain mais il les replace à leur juste importance en les expliquant »Mouais ... Question d’interprétation , moi je lis ceci p 202 :« Entre la description de César et la réalité des fouilles , subsistent certains écarts inévitables , que j’ai moi-même soulignés depuis longtemps , mais qui sont minimes et parfaitement explicables »...Moi je ne les explique pas , mais bon , tout est question d’appréciation semble-t-il ! -
Rectificatif
En effet, je viens de consulter mon Histoire de Gergovie publié en 1993, j’ai bien écrit que l’abside de l’église du Crest avait cinq ouvertures.
-
MENSONGES :
Mourey dit »Samosatensis a tort. Il n’existe que trois ouvertures ; les deux fenêtres latérales sont des fausses fenêtres qui n’ont jamais été ouvertes sur l’extérieur"
que tout le monde aille vérifier ici l’analyse architecturale exhaustive de cette église, les plans et les photos qu’a fait Anne Courtillé dans son ouvrage de référence sur les église en Auvergne et Bourbonnais et lire page 437 "les cinq pans à l’intérieur de l’abside qui ont entraîné l’ouverture de cinq baies, sont un premier caractère notable"
Monsieur Mourey ne sait pas compter jusqu’à 5, et n’a pas peur de mentir encore et encore car j’ai déjà mis ce lien ainsi que lien vers cette photo
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le-Crest_eglise.JPG
où tout le monde peut voir la forme de l’abside et compter 2 fenêtre sur le côté gauche, une fenêtre au bout et avec deux fenêtre sur le coté droit ça fait 5. On voit bien les vitraux donc tout le monde peut constater que ce sont bien de vraies fenêtres. Qu’est-ce qu’il faut de plus pour Monsieur Mourey qu’on lui paye le ticket de bus pour le crest et qu’on lui apprenne à compter sur ses doigts ?
Honte à vous Mourey, incapable de compter, mais capable de soutenir que 4+1 cela fait 5.
5 FENÊTRES MONSIEUR MOUREY…
et vous le savez très bien, il suffit de lire vos délires :
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/le-temple-de-gergovie-19503
où vous écrivez au milieu d’une de vos bouillie de délires ineptes « à condition de comprendre que le sculpteur n’a représenté que les trois fenêtres centrales, les deux autres fenêtres latérales étant probablement closes ou non visibles » et un peu plus loin « les trois fenêtres centrales, la quatrième et la cinquième étant probablement closes comme je l’ai dit précédemment ».
Vous savez bien qu’il y a 5 fenêtres mais vous inventez qu’il n’y en aurait que 3 en inventant une fermeture originelle de ces fenêtres qui n’auraient donc été percée que pour ne pas exister, être immédiatement bouchées, donc vous savez bien que ces fenêtres ont été et sont ouvertes sur l’extérieur, et tout le monde à condition d’être sain d’esprit doit reconnaître l’évidence de l’analyse architecturale la plus simple : il y a toujours eu 5 fenêtres percées et ouverte car c’était le projet de l’architecte, architecte du début de la période gothique comme n’importe qui peut le lire chez Madame Courtillé et voir qu’il s’agit d’un point irréfutable. Qui peut encore vous croire ? Et vous comment pouvez vous croire qu’on peut encore vous croire ?
MENSONGE(2)
Sur coagmento : « les archéologues prétendaient et prétendent toujours que les Gaulois ne connaissaient pas l’usage de la chaux, » mais où a-t-il vu cela ? on a traduit césar bien avant de fouiller et Felix Gaffiot avait infiniment plus de rigueur que vous, et plus d’honnêteté.
« alors que n’importe quel étymologiste sait que le suffixe latin« co » évoque quelque chose de solidement aggloméré » N’importe qui sait que vous racontez n’importe quoi, vous me l’avez déjà fait le cout du « co » et je vous ai déjà répondu que le mot agmen voulant dire troupe, troupeau, file, il faut imaginer qu’une légion coagmentée circulait les soldats collés les uns aux autres ? Et trouvez moi donc un étymologiste qui soutiendra que c’est le préfixe qui donne le sens essentiel du mot… Vous délirez complétement pour éluder le fait très simple : AUCUN texte latin n’a jamais donné à coagmento le sens que vous lui donnez qui est arbitraire, qui est un caprice de votre part élaboré à partir d’une formulation française tentant de rendre un sens figuré latin, vous avez tort, je l’ai déjà montré et PERSONNE ne vous a soutenu sur ce point.
Quant à »co" comment cela voudrait-il dire « quelque chose de solidement aggloméré » dans coalo (se nourrir avec), coalumna (camarade d’enfance), coamator (rival en amour), coaevus (contemporain). Vous êtes acculé, vous inventez vos arguments au fur et à mesure en priant pour le monde soit assez bête pour que l’on vous croie ou assez charitable pour que cet argument corresponde magiquement à la réalité, vous êtes un gosse.
BETISE
« C’est justement l’époque où la querelle avait repris de l’ampleur dans les médias, notamment avec les publications des frères Wartelle. La Revue Historique des Armées leur ouvraient encore ses colonnes en 1975, 1979 et 1983 et ma revue Casoar avait pris parti pour l’Alésia franc-comtoise. » Mais tout cela c’est insignifiant, si l’archéologie progressait grâce aux journaux régionaux et aux revues de vétérans, et si c’était dans ces cadres qu’il fallait présenter les découvertes cela se saurait. Depuis quand le Casoar est-il une référence en histoire romaine, quand à la RHA elle s’était effectivement égaré et se racheta après s’en être rendu compte en 1987 en publiant un dossier alise, mais la RHA n’a jamais été une revue de référence pour l’antiquité et n’avait pas de comité éditorial compétent sur la question. Bref encore une fois vous pensez que votre nombril est le centre du monde mais regardez les publications réellement scientifiques : les colloques, les comptes-rendus de lectures, les comptes-rendus de l’académie des inscriptions : il n’y a pas photo. Encore une fois vous voulez parler de ce que vous ignorer en pensant que vous pourrez imposer vos caprices à tous, mais quel âge avez-vous Mourey, 3 ans ?
DÉLIRE COMPLET
« parce que les Eduens y brûlaient leurs morts en jetant quelques pièces de monnaies dans le bûcher. S’il ne s’y trouve que peu de monnaies arvernes, c’est parce que les Arvernes brûlaient leurs morts à Corent, en Auvergne. »
Tiens donc et qu’est-ce qui prouve que les éduens jetaient des pièces sur le bûcher de leur mort ? Et donc les Arvernes en garnison – selon vous – sur le beuvray ne perdaient jamais de pièces de monnaies, n’enterraient aucune thésaurisation, et disposaient de cercueil réfrigéré pour que le cadavre supporte le trajet beuvray-corent avant de se faire incinérer là-bas ?
Du grand délire…
Imbécile de Mourey un bûcher funéraire ça laisse des traces archéologiques nettes on les aurait retrouvé tes délires, menteur absolu tu inventes des contes à dormir debout pour cacher le fait que ces monnaies crient ton imposture parce que bien sûr on ne les retrouvent pas dans des bûcher parce que bien sûr la typologie et la stratigraphie de leur trouvaille montre l’inanité de tous tes délires.
Les monnaies kaletedu ne sont absolument pas éduenne et pour comprendre leur répartition il faut un peu réfléchir à leur rôle, mais si tu avais un gramme de jugement militaire et de logique, de rigueur et d’honnêteté, Mourey tu serais allé te renseigner sur leur vraie signification et sur leur interprétation actuelle.
« ce qui est dans la pure logique politique et militaire de l’époque » quand Mourey dit cela c’est bien évidemment toujours pour soutenir une affirmation illogique et arbitraire.
Cessez aussi de moraliser sur la bien pensance, je ne vous renvoie que des faits, si savoir compter jusqu’à 5 c’est de la bien pensance… vous allez faire beaucoup rire, en fait ce type de remarques montre que vous êtes acculé, vous avez tout faux , vous le savez vous essayez de faire diversion en attaquant sur la morale, sur la politique, ou que sais-je encore, mais ce ne sont que des mots, vous êtes encore une fois le nez dans votre caca : allez vous voir dans la glace et tentez d’être honnête cinq minute, honneur et discipline non ? Mais vous n’avez aucun honneur, aucun courage vous biaisez à chaque erreur qu’on dénonce chez vous, vous mentez effrontément, et vous n’avez aucune discipline, le simple mot de rigueur ou de méthode scientifique vous hérisse.
Vos troupes sont anéanties Mourey et vous êtes un piètre commandant, il faut dire que vous n’opposez pas beaucoup de résistance, toujours les mêmes rengaines… C’est trop facile, au début j’avais un peu de remords à affliger ainsi un vieillard qui devrait témoigner de la dignité, mais je sais désormais que vous n’êtes qu’un pitre…
-
@ Bellovese
« on comprend mal pourquoi il nous aurait laissé une topographie erronée quand il est si simple de décrire ce qu’on a sous les yeux »parce que le premier exercice de rhétorique que l’on apprend c’est la description, l’ecphrasis en grec (nous avons d’excellent manuels de rhétoriques antiques de quintilien jusqu’Aelius Théon ou Ménandre le rhéteur, encore faut-il les connaître et les lire).Bref décrire c’est le b.a.-ba du métier de l’éloquence et donc tout le monde est attendu au tournant sur une description, on apprend à décrire en refaisant les descriptions célèbre comme celle de la peste de Thucydide, mais aussi les descriptions de lieux etc, on peut faire des livres entiers avec des descriptions (galerie de tableaux de philostrate), des conférences où l’on ne fait que décrire la salle où l’on confère (Lucien, La salle). Ne pas faire une description dans les régles c’est se disqualifier, faire une description qui fait écho à une description célèbre antérieur c’est montrer sa culture, flatter celle de son public cultivé et ravaler ceux qui n’ont pas saisi l’allusion à la plèbe, la masse inculte (oi polloi), alors la topographie après cela, les Romains auraient trouvé scandaleux qu’on objecte un détail de topographie pour reprocher à un auteur la reprise d’un exemplum dès lors qu’il n’y avait pas de contresens évident sur le déroulé final de l’action, sur sa signification, une telle objection n’aurait pu être le fait que d’un rustre, d’un rural mal éduqué et borné. Deux mille ans (et plus) nous séparent de cette culture, la comprendre et l’explorer suppose de ne pas en rester aux réflexes de notre culture à nous, cela demande de la méthode et énormément d’érudition : bellovese avez-vous lu quintilien, aelius théon, ménandre le rhéteur, lucien etc ? Ce n’est pas un reproche mais un constat : n’importe qui peut prendre conscience qu’objecter quelque chose à un physicien nucléaire suppose une connaissance en math considérable, mais pour l’histoire on fait comme si on pouvait débarquer sans pratique, sans un travail considérable et donc comme si n’importe qui pouvait après avoir lu deux livres et une traduction de césar en remontrer à des gens qui parfois y ont passé un vie…« Il est si simple » mais ce n’est précisément pas une culture simple, c’est une culture raffinée, où la distinction peut disqualifier (pensez, pour avoir une image au film « ridicule » et à la cour de versailles).Dans son ouvrage Comment on doit écrire l’histoire Lucien critique sévèrement celui qui n’a fait que simplement décrire les faits : il n’aurait jamais du publier un livre ainsi, c’était tout juste des notes valables pour qui devrait écrire.Bref césar, qui rédigeait un traité sur l’analogie en grammaire durant la guerre des gaules, ne pouvait pas passer pour un illiteratus, et la guerre étant gagné personne ne se souciait de la topographie des lieux, n’oubliez pas que le Bellum Gallicum est composé à la veille de la guerre civile - quand la perspective est inéluctable - et publié durant la dictature.Ce n’est pas un débat sans fin. Les sources littéraires, socialement construites et historiquement dépendante d’un contexte spécifique et l’archéologie, parfois difficile à maîtriser, sont des sources hétérogènes, le débat sera sans fin seulement si on veut absolument faire coller l’une à l’autre en voulant oublier que précisément c’est impossible.Dès lors il faut se baser sur un faisceau de faits, et à Alise on a ce faisceau depuis désormais 50 ans de manière éclatante et toute nouvelle investigation n’a fait que le renforcer, le débat est tranché et le jura a suffisamment de sites archéologiques intéressant pour n’avoir pas à se désoler de n’avoir pas alésia.-
@ Samosatensis
Sans préjuger de l’importance de la philologie , que d’élitisme dans vos propos !Si je comprends bien , un archéologue érudit , serait tout bonnement incapable de décrypter César parce qu’il n’aurait pas lu quintilien, aelius théon, ménandre le rhéteur, lucien ...Même chose pour un militaire , un scientifique , ou n’importe quel quidam passionné d’histoire ?Heureusement nous ne sommes plus à l’époque de Jacques Harmand ( Alésia, une campagne césarienne Paris, 1967 ) et de la philologie pure !Certes il a sans aucun doute publié des études intéressantes , mais il avait parfois tendance à s’égarer dans des hypothèses assez douteuses, il devait penser que son érudition l’autorisait à se permettre quelques excès .Où est-il écrit que l’érudition préserve de l’erreur et du parti-pris ?Où est-il écrit que seul un philologue aurait la matière grise apte à comprendre le texte de la guerre des Gaules ?Quant à César , il ne faut pas oublier que même si son écriture était brillante , et qu’il s’est employé à ne jamais endosser les nombreuses erreurs commises lors de ses expéditions , il s’agit avant tout d’une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts et autant d’esclaves , et d’ailleurs César n’en fait pas mystère !Nous sommes donc devant un texte précis , précis dans sa construction , et dans la relation des événements comme dans certaines descriptions !César décrit toute la réalité d’une guerre et son cortège d’horreurs !Ces événements sont toujours difficile à appréhender dans les textes antiques , ce qui n’est pas le cas dans le de bello qui est très clair sur le sujet , il faut avoir le nez dans les livres et ne plus se souvenir des réalités du monde pour ne pas s’en rendre compte .Et c’est bien là toute la faiblesse du dossier alisien , prendre à la légère le texte de César ...Oubliée la logique géographique , oubliées les descriptions topographiques ( pourtant si précises parfois ) , oubliées les notions stratégiques et tactiques incompatibles avec le site d’Alise , et passés à pertes et profits les nombreux indices archéologiques qui contredisent si bien une chronologie trop ostensiblement affirmée !Il est tellement plus simple de penser que César s’est contenté de faire acte d’élégance ...-
Danielle Porte : Réponses aux questions posées par le colonel Mourey.
(Première partie)
« Où sont les vallées encaissées que vos partisans ont imaginées en lisant ce texte ? Où sont les collines qui auraient mis en « gorges » les deux rivières ? »
Premier point à établir avant toute discussion : la fiabilité du de Bello Gallico.
César n’est pas seul à avoir décrit le site. L’historien consciencieux se doit de faire état des autres textes. Contemporains comme postérieurs, les autres écrivains se réfèrent à des témoignages que nous ne possédons plus mais qu’ils ont pu consulter (p. ex. Servius Honoratus, dit Servius le Grammairien, rapporte le combat préliminaire de cavalerie d’après les Éphémérides de César lui-même, disponible encore, par conséquent, aux IVe-Ve s. ap. J.-C.). Les récits ou les descriptions que nous lisons sous d’autres plumes que celle de César ont pu être empruntés à des contemporains ou quasi contemporains de César, dont on sait qu’ils ont écrit sur la guerre des Gaules : son secrétaire, interprète et garde des sceaux : Pompéius Trogus, l’architecte Vitruve, Asinius Pollion, source d’Appien, de Plutarque et de Dion Cassius, Titus Ampius, source de Suétone, Tanusius Géminus, source de Plutarque, voire les livres de Furius Bibaculus sur la guerre des Gaules, le Bellum Sequanicum de Varron d’Atax, et le livre 108 de Tite-Live… et la correspondance de Quintus Cicéron, son légat, de Décimus Brutus, de Trébonius, de Marc-Antoine qui furent tous à Alésia.
Avant d’invoquer la formation rhétorique de César pour l’accuser de mensonge, il faut méditer sur le témoignage de son ennemi, Marcus Cicéron (Br., 262) parlant des Commentaires : « ils sont nus, exacts et beaux, dépourvus de tout ornement oratoire, comme d’un vêtement qu’on enlève… »
Et l’on se demande bien en quoi avantageait sa gloire ou sa carrière politique d’écrire que les tours étaient distantes de 24 m si elles l’étaient de 58, ou que les fossés étaient larges de 4,35 m s’ils ne le sont que de 2,9 m. Ne parlons pas des 80 cm de profondeur des fossés alisiens, nettement insuffisants pour arrêter une charge ennemie ! La description de travaux techniques demande l’exactitude, surtout si une tricherie n’avance en rien les affaires du tricheur. D’autant que les Sénateurs avaient tous été consuls ou proconsuls et pouvaient parfaitement évaluer les chiffres donnés.
Ensuite : les collines.
La suite du texte de César que vous ne citez pas spécifie que « des collines de même hauteur ceignaient l’oppidum, à une distance réduite, mediocri interiecto spatio », ce qui permet d’imaginer que le lit des deux rivières, serré entre ces collines et l’oppidum, formait ravin. Florus l’exprime en propres termes, en parlant de rivières abruptis ripis, « aux rives abruptes », ce qui conforte le terme subluebant, « lavaient par-dessous », que César emploie pour les deux rivières par rapport à l’oppidum, ce que confirme Strabon (Géogr., 4, 2, 3, periéchiménèn d’oresi kai potamois dusin « encastrée entre des collines et deux fleuves ») : si les rivières « lèchent » cet oppidum, c’est qu’il n’existe pas d’espace libre entre leur cours et les pentes de la colline.
C’est Michel Reddé lui-même qui estime l’espace entre les rivières et le flanc du mont Auxois à 1,2 km (Alésia, l’archéologie face à l’imaginaire, p. 133) On ne peut donc parler de « distance réduite ».
Pour les collines, elles sont distantes de l’oppidum de 2,5 km. Là aussi, parler de « distance réduite » est impossible. En revanche les vallées encaissées de la Lemme et de la Saine sont parfaitement conformes à ce qu’implique l’expression mediocri interiecto spatio : seul (car la route n’existait pas), leur lit séparait l’oppidum de sa ceinture de hauteurs.
« Comment pouvez-vous dire que cette plaine s’étalait en largeur alors qu’il est écrit in longitudinem ? Comment pouvez-vous inventer qu’elle était à perte de vue alors qu’il est écrit qu’elle s’étalait en longueur sur 3000 pas ? »
Vous me semblez, ici, aveuglé par votre engagement en faveur d’Alise, au point d’interpréter les critiques que je formule contre Alise comme une déformation du texte de César. Je persiste à dire, et il m’étonnerait qu’on puisse le contester, que la plaine d’Alise (les Laumes) s’étale en largeur et à perte de vue, tandis que César la présente en longueur, in longitudinem. Et la plaine des Laumes excède les 4,5 km, sauf à être mesurée, cela a été fait, en diagonale.
Au § 7, 70, 1, les cavaliers se battent dans la plaine de 3000 pas in longitudinem, intermissam collibus « en longueur, enserrée entre des collines ». Je ne vois pas que j’aie pu écrire que la plaine « de César » était « en largeur » : je parlais, à l’évidence, de celle d’Alise.
« Pourquoi refusez-vous de voir le contour ovale de l’ancienne muraille oppidumique avec sa citadelle… » « Pourquoi ne voulez-vous pas voir le fossé décrit par César dans le fossé mis au jour par les archéologues de Napoléon III en avant et au pied de l’oppidum, d’une rivière à l’autre ? »
Si le rempart d’Alise avait réellement existé, il me semble que les défenseurs d’Alise s’en réjouiraient, tandis qu’ils déplorent encore de n’avoir à se mettre sous la dent que quelques mètres de murus gallicus (à supposer même qu’il soit « gallicus » : F. Creuzenet, Historia, 77, 2002, établit que les deux tronçons de murus « gallicus » sont en fait gallo-romains, et que le troisième remonte à l’Âge du Bronze).
Ce murus gallicus est typique des villes du IIème av. J.-C., tandis que les remparts d’Alésia « métropole religieuse de toute la Celtique » selon Diodore de Sicile (4, 19, 1-2) doivent remonter à l’époque d’Hercule, i.e. aux siècles de la guerre de Troie, et ressembler aux murs des villes grecques archaïques, Tirynthe, Argos, Mycènes ; être, donc, constitués de dalles cyclopéennes.
Pour ce qui est du « grand fossé d’arrêt » de Napoléon III, il est situé à une distance variable du reste des retranchements (partout à plus de 600 m) alors que selon César il doit être à 120 m (400 pieds), distance conforme à ce qu’implique la portée des machines de guerre romaines. Pour minimiser l’écart entre la réalité d’Alise et les chiffres de César, on a transformé les 400 pieds (400 fois 29,6 cm) en 400 pas (400 fois 148 cm). Mais c’est une correction moderne ad locum, faite en désespoir de cause.
« Pourquoi pensez-vous que la montagne de Bussy ne puisse pas correspondre à la description pourtant précise de César, description que confirme la redécouverte du camp romain étudié par Michel Reddé ? Votre argumentation est de dire qu’elle ne se trouve pas exactement au nord. César dit « du côté des sept étoiles de la petite Ourse » septentrionibus. Ce n’est pas dans ses habitudes d’indiquer des orientations intermédiaires ».
Là, vous me faites vraiment la partie trop facile !
Le camp étudié par M. Reddé n’est pas celui de la montagne de Bussy, mais celui du mont Réa. C’est Labiénus, qu’on installe à Bussy (à cause de cette balle de fronde qui porte les lettres TLAR, lues TLAB, et sur laquelle il y aurait beaucoup à dire), alors que l’attaque du camp nord vise les légats Réginus et Rébillus. Si l’on installe ces deux légats à Bussy, où installe-t-on Labiénus ?
Toutes les armes et les monnaies exhumées l’ont été des fossés du Réa, pas de Bussy. De toute façon, la montagne de Bussy n’est pas au nord, puisque le nord est occupé par la plaine du Rabutin. Mais César n’est pas gêné le moins du monde pour exprimer les orientations intermédiaires, à preuve le 1er paragraphe du 1er chapitre du B.G., où il parle de la Belgique « au nord-est », ou de l’Aquitaine « au sud-ouest » : spectant in septentrionem et orientem solem… et : spectat inter occasum solis et septentriones.
S’il n’a pas précisé, alors qu’il était en mesure de le faire, c’est qu’il n’y avait pas lieu, la montagne étant plein nord.
Pour le camp étudié par M. Reddé, il n’est pas en haut de cette montagne, comme il devrait l’être (7, 83, 1 : superiorum castrorum ; 7, 85, 4 : ad superiores munitiones ; et les Gaulois « escaladent la pente, ascensum dat Gallis, 7, 85, 6 ; ex ascensu temptant » 7, 86, 4) mais en bas de la pente, derrière la gare des Laumes. Ni lui, d’ailleurs, ni celui de Bussy n’ont la taille requise pour abriter deux légions. Il faut 45 ha pour deux légions selon Polybe, le camp de Bussy taille 9,50 ha ; celui de Flavigny, réservé à César, taille 3 ha. On a même décoré du nom de « camp » des enclos de 36 ares ! (le camp n°15, selon J. Le Gall)
Je précise que toutes les critiques que j’ai formulées contre Alise Sainte-Reine sont tirées des écrits mêmes de ses défenseurs, notamment Joël Le Gall, prédécesseur de Michel Reddé...
Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre que ces « loca praerupta » sont les pentes abruptes du mont Rhéa et non les falaises de Chaux-des-Crotenay que César aurait bien évidemment mises en exergue dans son premier tour d’horizon si tel avait été le cas ?
Je me demande où vous voyez des falaises (loca prærupta) au Réa, le « camp » est en pente juste derrière la gare des Laumes, sans obstacle quelconque, hormis qu’il est impossible de grimper (ex ascensu) pour atteindre un endroit situé plus bas que soi. Or, Vercassivellaun attaquerait, selon J. Le Gall, d’en haut, donc, descendrait, alors que César écrit ascensum dat Gallis, et les assiégés qui parviennent aux praerupta y grimpent aussi (ex ascensu temptant), donc, montent, alors que s’ils visaient le camp du Réa, ils seraient, une fois en bas de l’oppidum, quasiment à niveau avec lui. Ils n’auraient donc pas à « escalader » des « abrupts » qui n’existent pas.
Noter que pour atteindre ces prærupta, il est nécessaire que les assiégés aient franchi les fortifications romaines, établies tout autour du mont Auxois. Or, César dit justement que les assiégés n’ont pu venir à bout des lignes de la plaine, et se rabattent sur l’escalade des abrupts. Situation inenvisageable à Alise, mais parfaitement applicable à Chaux, à cause du relief montagneux et de la position de la plaine en avant de la colline, pas tout autour comme à Alise.
Pour ce qui est de parler d’emblée des abrupts, la méthode qu’a adoptée César de décrire au fur et à mesure les éléments du relief qui lui servent pour son récit, ne l’y obligeait nullement. De même mentionne-il la colline de Gergovie où il a concentré son attaque seulement quand la clarté de son exposé l’exige, non dans un panorama d’ensemble avant les événements. Il s’est attardé sur la plaine d’Alésia au début, puisque les premiers combats s’y sont déroulés et qu’il a décrit son système de retranchements. Quand l’armée de secours sera arrivée et qu’elle cherchera à débloquer l’oppidum par une stratégie de contournement en montagne, il décrira la montagne. C’est simple et logique.
(Fin Première partie)
-
Réponse de Danielle Porte : Réponses aux questions posées par le colonel Mourey.
« Où sont les vallées encaissées que vos partisans ont imaginées en
lisant ce texte ? Où sont les collines qui auraient mis en « gorges »
les deux rivières ? »Premier point à établir avant toute discussion : la fiabilité du de
Bello Gallico.César n’est pas seul à avoir décrit le site. L’historien consciencieux
se doit de faire état des autres textes. Contemporains comme
postérieurs, les autres écrivains se réfèrent à des témoignages que
nous ne possédons plus mais qu’ils ont pu consulter (p. ex. Servius
Honoratus, dit Servius le Grammairien, rapporte le combat préliminaire
de cavalerie d’après les Éphémérides de César lui-même, disponible
encore, par conséquent, aux IVe-Ve s. ap. J.-C.). Les récits ou les
descriptions que nous lisons sous d’autres plumes que celle de César
ont pu être empruntés à des contemporains ou quasi contemporains de
César, dont on sait qu’ils ont écrit sur la guerre des Gaules : son
secrétaire, interprète et garde des sceaux : Pompéius Trogus,
l’architecte Vitruve, Asinius Pollion, source d’Appien, de Plutarque
et de Dion Cassius, Titus Ampius, source de Suétone, Tanusius Géminus,
source de Plutarque, voire les livres de Furius Bibaculus sur la
guerre des Gaules, le Bellum Sequanicum de Varron d’Atax, et le livre
108 de Tite-Live… et la correspondance de Quintus Cicéron, son légat,
de Décimus Brutus, de Trébonius, de Marc-Antoine qui furent tous à
Alésia.Avant d’invoquer la formation rhétorique de César pour l’accuser de
mensonge, il faut méditer sur le témoignage de son ennemi, Marcus
Cicéron (Br., 262) parlant des Commentaires : « ils sont nus, exacts
et beaux, dépourvus de tout ornement oratoire, comme d’un vêtement
qu’on enlève… »Et l’on se demande bien en quoi avantageait sa gloire ou sa carrière
politique d’écrire que les tours étaient distantes de 24 m si elles
l’étaient de 58, ou que les fossés étaient larges de 4,35 m s’ils ne
le sont que de 2,9 m. Ne parlons pas des 80 cm de profondeur des
fossés alisiens, nettement insuffisants pour arrêter une charge
ennemie ! La description de travaux techniques demande l’exactitude,
surtout si une tricherie n’avance en rien les affaires du tricheur.
D’autant que les Sénateurs avaient tous été consuls ou proconsuls et
pouvaient parfaitement évaluer les chiffres donnés.Ensuite : les collines.
La suite du texte de César que vous ne citez pas spécifie que « des
collines de même hauteur ceignaient l’oppidum, à une distance réduite,
mediocri interiecto spatio », ce qui permet d’imaginer que le lit des
deux rivières, serré entre ces collines et l’oppidum, formait ravin.
Florus l’exprime en propres termes, en parlant de rivières abruptis
ripis, « aux rives abruptes », ce qui conforte le terme subluebant, «
lavaient par-dessous », que César emploie pour les deux rivières par
rapport à l’oppidum, ce que confirme Strabon (Géogr., 4, 2, 3,
periéchiménèn d’oresi kai potamois dusin « encastrée entre des
collines et deux fleuves ») : si les rivières « lèchent » cet
oppidum, c’est qu’il n’existe pas d’espace libre entre leur cours et
les pentes de la colline.C’est Michel Reddé lui-même qui estime l’espace entre les rivières et
le flanc du mont Auxois à 1,2 km (Alésia, l’archéologie face à
l’imaginaire, p. 133) On ne peut donc parler de « distance réduite ».Pour les collines, elles sont distantes de l’oppidum de 2,5 km. Là
aussi, parler de « distance réduite » est impossible. En revanche les
vallées encaissées de la Lemme et de la Saine sont parfaitement
conformes à ce qu’implique l’expression mediocri interiecto spatio :
seul (car la route n’existait pas), leur lit séparait l’oppidum de sa
ceinture de hauteurs.-
@ blurpy
Vous citez Marcus Cicéron, contemporain de César qui affirme la très grande exactitude du texte de César. Vous avez raison, Michel Reddé a tort.
D’où l’intérêt de traduire correctement le texte de César et de ne pas essayer de le corriger par des textes postérieurs plus ou moins vagues et postérieurs parfois de plus d’un siècle (Florus). En traduisant « reliquis ex omnibus partibus colles mediocri interiecto spatio pari altitudinis fastigio oppidum cingebant » par « des collines de même hauteur ceignaient l’oppidum, à une distance réduite » madame Porte fait un contre-sens. La bonne traduction est la suivante : « De tous les autres côtés, des hauteurs d’une altitude égale (à la sienne), et séparées (entre elles) par un espace médiocre, entouraient l’oppidum ».
Ce « mediocri interjecto spatio »désigne l’espace médiocre qu’il y avait entre les collines qui ceinturaient la colline centrale et non un espace qu’il y avait entre la colline centrale et celles qui l’entouraient.Ces faibles espaces entre les hauteurs qui entourent le mont apparaissent très clairement à Alise mais pas dans le relief du site franc-comtois.
Que madame Porte mette en lumière les contradictions de Michel Reddé, je n’y vois pas d’inconvénients et c’est de bonne guerre mais ce n’est pas une argumentation. Je ne cautionne ni la traduction de Michel Reddé qui commet le même contre-sens ni les erreurs d’interprétation et d’estimation des archéologues concernant l’emplacement des obstacles césariens et leur nature (profondeur, largeur des fossés etc…). Je regrette seulement que les erreurs « officielles » aient eu comme conséquence de semer le doute sur le site d’Alise-Sainte-Reine.
-
Petite précision : des hauteurs d’une altitude égale (à la sienne) ou peut-être : des hauteurs d’une altitude semblable (entre elles). Il faudrait demander leur avis à des latinistes confirmés, s’il en existe encore.
-
Réponse de Danielle Porte : Réponses aux questions posées par le colonel Mourey.
« Comment pouvez-vous dire que cette plaine s’étalait en largeur alors
qu’il est écrit in longitudinem ? Comment pouvez-vous inventer qu’elle
était à perte de vue alors qu’il est écrit qu’elle s’étalait en
longueur sur 3000 pas ? »Vous me semblez, ici, aveuglé par votre engagement en faveur d’Alise,
au point d’interpréter les critiques que je formule contre Alise comme
une déformation du texte de César. Je persiste à dire, et il
m’étonnerait qu’on puisse le contester, que la plaine d’Alise (les
Laumes) s’étale en largeur et à perte de vue, tandis que César la
présente en longueur, in longitudinem. Et la plaine des Laumes excède
les 4,5 km, sauf à être mesurée, cela a été fait, en diagonale.Au § 7, 70, 1, les cavaliers se battent dans la plaine de 3000 pas
in longitudinem, intermissam collibus « en longueur, enserrée entre
des collines ». Je ne vois pas que j’aie pu écrire que la plaine « de
César » était « en largeur » : je parlais, à l’évidence, de celle
d’Alise.-
@ blurpy
Admettons le malentendu ! L’erreur de madame Porte est de raisonner en termes géographiques de notre époque alors que César raisonne en termes stratégiques et tactiques de son époque. La « planitia » de César est une partie plate – sens étymologique du mot - permettant un combat de cavalerie, et donc qui ne l’est plus dès que commence la forêt. Madame Porte devrait raisonner sur la Gaule de l’époque et non sur l’habillage du terrain de notre époque.
-
Réponse de Danielle Porte : Réponses aux questions posées par le colonel Mourey.
« Pourquoi refusez-vous de voir le contour ovale de l’ancienne
muraille oppidumique avec sa citadelle… » « Pourquoi ne voulez-vous
pas voir le fossé décrit par César dans le fossé mis au jour par les
archéologues de Napoléon III en avant et au pied de l’oppidum, d’une
rivière à l’autre ? »Si le rempart d’Alise avait réellement existé, il me semble que les
défenseurs d’Alise s’en réjouiraient, tandis qu’ils déplorent encore
de n’avoir à se mettre sous la dent que quelques mètres de murus
gallicus (à supposer même qu’il soit « gallicus » : F. Creuzenet,
Historia, 77, 2002, établit que les deux tronçons de murus « gallicus
» sont en fait gallo-romains, et que le troisième remonte à l’Âge du
Bronze).Ce murus gallicus est typique des villes du IIème av. J.-C., tandis
que les remparts d’Alésia « métropole religieuse de toute la Celtique
» selon Diodore de Sicile (4, 19, 1-2) doivent remonter à l’époque
d’Hercule, i.e. aux siècles de la guerre de Troie, et ressembler aux
murs des villes grecques archaïques, Tirynthe, Argos, Mycènes ; être,
donc, constitués de dalles cyclopéennes.Pour ce qui est du « grand fossé d’arrêt » de Napoléon III, il est
situé à une distance variable du reste des retranchements (partout à
plus de 600 m) alors que selon César il doit être à 120 m (400 pieds),
distance conforme à ce qu’implique la portée des machines de guerre
romaines. Pour minimiser l’écart entre la réalité d’Alise et les
chiffres de César, on a transformé les 400 pieds (400 fois 29,6 cm) en
400 pas (400 fois 148 cm). Mais c’est une correction moderne ad locum,
faite en désespoir de cause.-
@ blurpy
Concernant le soi-disant murus gallicus vers la croix Saint-Charles, je suis d’accord avec vous, cela ne tient pas la route. Il s’agit d’une assez misérable opération de l’archéologie officielle qui, à l’exemple de Samosatensis, n’a rien compris à ce qu’était un murus gallicus. Je rappelle que César en donne la description à l’occasion du siège de la ville de Bourges contre les murailles de laquelle il a dressé une rampe d’accès de près de 23 mètres de haut. Le seul « murus gallicus » logique est celui dont Garenne a retrouvé la trace, oppidum-refuge pour la population mandubienne dont la ville « gauloise » a été mise au jour sur le plateau mais que les archéologues officiels attribuent à des Gallo-Romains postérieurs (nous sommes toujours dans une histoire de fous).
Concernant « Alésia métropole religieuse de toute la Celtique selon Diodore de Sicile (4, 19, 1-2) », vous faites une erreur d’interprétation. L’alésia dont il s’agit – nom courant et générique – est Bibracte au Mont-Saint-Vincent.
Concernant le grand fossé de Napoléon III, merci de mettre, une fois de plus, en évidence les contradictions encore actuelles. Le fossé en question a bien été construit à 120 mètres des retranchements mais des fortifications (munitiones) du grand camp de la plaine où se trouvait alors César à son arrivée et non à 120 mètres de la ligne de fortification qui n’était pas encore construite. Il faut se replacer dans la chronologie du temps. Ce fossé sera ensuite inclus dans la dite ligne d’encerclement.
-
Petite précision. Le fossé dont il s’agit, celui dont parle César, est le fossé qui deviendra le fossé extérieur de la ligne d’encerclement tournée vers la position de Vercingétorix. Napoléon III s’est complètement fourvoyé en identifiant ce fossé dont parle César à celui dont les archéologues ont retrouvé la trace au pied du mont Auxois, lequel est, en réalité, le fossé gaulois, creusé par les assiégés, d’une rivière à l’autre, pour interdire aux Romains un espace sécurisé « gaulois ».
-
Réponse de Danielle Porte : Réponses aux questions posées par le colonel Mourey.
« Pourquoi pensez-vous que la montagne de Bussy ne puisse pas
correspondre à la description pourtant précise de César, description
que confirme la redécouverte du camp romain étudié par Michel Reddé ?
Votre argumentation est de dire qu’elle ne se trouve pas exactement au
nord. César dit « du côté des sept étoiles de la petite Ourse »
septentrionibus. Ce n’est pas dans ses habitudes d’indiquer des
orientations intermédiaires ».Là, vous me faites vraiment la partie trop facile !
Le camp étudié par M. Reddé n’est pas celui de la montagne de Bussy,
mais celui du mont Réa. C’est Labiénus, qu’on installe à Bussy (à
cause de cette balle de fronde qui porte les lettres TLAR, lues TLAB,
et sur laquelle il y aurait beaucoup à dire), alors que l’attaque du
camp nord vise les légats Réginus et Rébillus. Si l’on installe ces
deux légats à Bussy, où installe-t-on Labiénus ?Toutes les armes et les monnaies exhumées l’ont été des fossés du Réa,
pas de Bussy. De toute façon, la montagne de Bussy n’est pas au nord,
puisque le nord est occupé par la plaine du Rabutin. Mais César n’est
pas gêné le moins du monde pour exprimer les orientations
intermédiaires, à preuve le 1er paragraphe du 1er chapitre du B.G., où
il parle de la Belgique « au nord-est », ou de l’Aquitaine « au sud-
ouest » : spectant in septentrionem et orientem solem… et : spectat
inter occasum solis et septentriones.S’il n’a pas précisé, alors qu’il était en mesure de le faire, c’est
qu’il n’y avait pas lieu, la montagne étant plein nord.Pour le camp étudié par M. Reddé, il n’est pas en haut de cette
montagne, comme il devrait l’être (7, 83, 1 : superiorum castrorum ;
7, 85, 4 : ad superiores munitiones ; et les Gaulois « escaladent la
pente, ascensum dat Gallis, 7, 85, 6 ; ex ascensu temptant » 7, 86, 4)
mais en bas de la pente, derrière la gare des Laumes. Ni lui,
d’ailleurs, ni celui de Bussy n’ont la taille requise pour abriter
deux légions. Il faut 45 ha pour deux légions selon Polybe, le camp de
Bussy taille 9,50 ha ; celui de Flavigny, réservé à César, taille 3
ha. On a même décoré du nom de « camp » des enclos de 36 ares ! (le
camp n°15, selon J. Le Gall)Je précise que toutes les critiques que j’ai formulées contre Alise
Sainte-Reine sont tirées des écrits mêmes de ses défenseurs, notamment
Joël Le Gall, prédécesseur de Michel Reddé...-
@ blurpy
Le camp étudié par M. Reddé est bien celui de la montagne de Bussy et non celui du mont Rhéa comme vous le dites.
Il s’agit bien du camp nord des légats Réginus et Rébillus dont M. Reddé a mis en évidence l’importance, conformément à ce que dit César dans sa description du terrain. Et il est bien du côté des étoiles de la Petite Ourse (comme le mont Rhéa d’ailleurs). La balle de fronde de Labiénus s’accorde avec mon explication de la bataille d’après le texte césarien (le passage où César envoie Labiénus soutenir cette position). Labiénus commandait les réserves, à la botte de César, dans son camp de Flavigny, avant son intervention, question de bon sens.
Quand César utilise l’expression « superiorum castrorum 7,83,1 », c’est pour désigner, d’une façon générale, au début de l’affrontement de cavalerie, les camps romains installés sur les hauteurs et les distinguer des grands camps romains de la plaine qui sont installés… dans la plaine. Quand il utilise l’expression « ad superiores munitiones » 7, 85, 4, c’est pour désigner les fortifications romaines des camps de Bussy tournées du côté des troupes de Vercassivellaunos qui les attaquent à l’extérieur. Quand il utilise l’ expression « ascensum dat Gallis » 7,85,6, il s’agit toujours de ces troupes gauloises de Vercassivellaunos qui arrivent à escalader ces fortifications. Mais quand il parle de « ex ascensu temptant » 7,86,4, il ne s’agit plus de ces troupes gauloises de l’extérieur engagées sur le front de Bussy, mais des assiégés qui s’attaquent de l’intérieur aux pentes abruptes – raides – du mont Rhéa.
Bis repetita, je répète que je ne cautionne pas les affirmations du professeur le Gall et des archéologues et historiens officiels et que je ne peux que regretter que leurs erreurs d’interprétation aient semé le doute sur le site d’Alise-Sainte-Reine.
-
Réponse de Danielle Porte : Réponses aux questions posées par le colonel Mourey.
« Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre que ces « loca praerupta » sont
les pentes abruptes du mont Rhéa et non les falaises de Chaux-des-
Crotenay que César aurait bien évidemment mises en exergue dans son
premier tour d’horizon si tel avait été le cas ? »Je me demande où vous voyez des falaises (loca prærupta) au Réa, le «
camp » est en pente juste derrière la gare des Laumes, sans obstacle
quelconque, hormis qu’il est impossible de grimper (ex ascensu) pour
atteindre un endroit situé plus bas que soi. Or, Vercassivellaun
attaquerait, selon J. Le Gall, d’en haut, donc, descendrait, alors que
César écrit ascensum dat Gallis, et les assiégés qui parviennent aux
praerupta y grimpent aussi (ex ascensu temptant), donc, montent, alors
que s’ils visaient le camp du Réa, ils seraient, une fois en bas de
l’oppidum, quasiment à niveau avec lui. Ils n’auraient donc pas à «
escalader » des « abrupts » qui n’existent pas.Noter que pour atteindre ces prærupta, il est nécessaire que les
assiégés aient franchi les fortifications romaines, établies tout
autour du mont Auxois. Or, César dit justement que les assiégés n’ont
pu venir à bout des lignes de la plaine, et se rabattent sur
l’escalade des abrupts. Situation inenvisageable à Alise, mais
parfaitement applicable à Chaux, à cause du relief montagneux et de la
position de la plaine en avant de la colline, pas tout autour comme à
Alise.Pour ce qui est de parler d’emblée des abrupts, la méthode qu’a
adoptée César de décrire au fur et à mesure les éléments du relief qui
lui servent pour son récit, ne l’y obligeait nullement. De même
mentionne-il la colline de Gergovie où il a concentré son attaque
seulement quand la clarté de son exposé l’exige, non dans un panorama
d’ensemble avant les événements. Il s’est attardé sur la plaine
d’Alésia au début, puisque les premiers combats s’y sont déroulés et
qu’il a décrit son système de retranchements. Quand l’armée de secours
sera arrivée et qu’elle cherchera à débloquer l’oppidum par une
stratégie de contournement en montagne, il décrira la montagne. C’est
simple et logique.« Comment peut-on dire : Pas de crêtes alentour sur lesquelles disposer
23 postes fortifiés ? Ce qui montre à l’évidence comment en sortant du
texte latin – car César ne dit pas qu’il a installé ses postes sur les
crêtes – on peut dire n’importe quoi. »Les crêtes alentour : César dit bien que les camps étaient en haut des
collines (7, 80, 2) ex omnibus castris quae summum undique iugum
tenebant et qu’on peut voir d’en haut, erat despectus, tout ce qui se
déroule dans la plaine. un balcon est, me semble-t-il, en surplomb,
pas à niveau. Il va de soi que, l’oppidum étant partout cerné de
hauteurs qui constituaient une chaîne (iugum), il n’existait pas de
plaines pour les entrecouper, où l’on eût pu installer les castella.
D’ailleurs César dit bien castra oportunis locis erant posita ibique
(et aux mêmes endroits favorables) castella XXIII facta (7, 69, 7). Si
les camps de l’Alise napoléonienne occupent les collines alentour, les
castella doivent le faire aussi. Mais si on les positionne sur les
crêtes autour d’Alise, ils sont bien trop éloignés pour se révéler
efficaces.la bonne logique était justement de placer ces postes sur la pente
pour renforcer et interdire l’obstacle naturel qu’étaient les cours
d’eau.Selon César, toujours en 7, 69, ces castella ont été aménagés pour
protéger les ouvriers en train de construire la contrevallation. Sur
les plans napoléoniens, ils sont tous extérieurs à la contrevallation,
comme s’il s’agissait de protéger des remparts déjà construits contre
une armée extérieure. Or, la circonvallation ne sera envisagée
qu’après l’appel de Vercingétorix à l’armée de secours, bien plus
loin, en 7, 74.Notons que les camps de plaine (tous abandonnés depuis J. Le Gall)
sont situés hors de la circonvallation qui est censée les protéger.
Forcément : la distance de 600 à 1000 m qu’on a admise entre le grand
fossé et les lignes romaines, au lieu des 120 m voulus par César,
resserre d’autant la contrevallation et la circonvallation, puisqu’on
ne peut rien changer au périmètre des lignes indiqué aussi par César :
il ne reste plus que quelque 120 m entre les deux lignes, et le côté
d’un camp romain demande déjà un minimum de 650 m de côté.Pour ce qui est de « l’obstacle naturel » que forment les cours d’eau,
on reste perplexe : il faut barrer l’Ozerain avec des claies de bois
pour empêcher les bœufs de passer…-
@ blurpy
C’est vous qui traduisez « loca praerupta » par falaises, pas moi. Je suis bien d’accord que l’expression est sujette à interprétation. Vous choisissez « falaises », je choisis « lieux escarpés » et je les retrouve au mont Rhéa, mais côté Vercingétorix/assiégés et non côté extérieur/armée de secours/gare des Laumes comme vous le pensez.
Bis repetita, je n’y suis pour rien, ni vous d’ailleurs, si les historiens et archéologues officiels sont toujours dans la confusion en ce qui concerne le mont Rhéa. Cela date du colonel Stoffel qui n’a pas voulu contredire Napoléon III.
Confusion également sur Gergovie, sur Bibracte ! c’est à désespérer de l’intelligence humaine ! et des services du ministère de la culture ! Et du ministre de la Culture…
Les camps dont parle César en 7,80,2 sont ceux de Flavigny et du mont Rhéa qui, en effet, se trouvaient sur les crêtes d’où les Romains pouvaient voir le combat de cavalerie, mais les postes fortifiés/castella n’avaient aucune raison de se trouver sur les crêtes mais sur les pentes, aux endroits favorables, là où on en a d’ailleurs retrouvé la trace.
En 7, 69, César dit bien que ces postes/castella ont été installés, pratiquement dès son arrivée, pour assurer la sécurité des Romains qui travaillaient à la construction de la ligne d’obstacles d’encerclement tournée vers les assiégés. Ce n’est qu’en 7, 74, que César décide de construire une ligne semblable tournée vers l’extérieur. Et les castella mis au jour à Alise-Sainte-Reine se trouvent bien entre les deux lignes.
Bis repetita, je ne cautionne pas les errements des archéologues officiels. Le professeur le Gall a écrit que les camps de la plaine avaient été abandonnés par les Romains. C’est encore une invention de l’archéologie officielle. Rien ne permet de dire cela et voilà pourquoi on n’a rien compris au déroulement de la bataille, ni le professeur le Gall – que j’ai pourtant alerté dès 1981, ni ses successeurs. Et puis, la vérité historique ? Qui s’en inquiète aujourd’hui ?
Rivières, cours d’eau, ou fleuves, qu’ils soient larges, profonds ou modestes, aucun n’est un obstacle, militairement parlant. Un obstacle n’est vraiment un obstacle tactique que lorsqu’il est renforcé (abattis etc…) et battu par des « feux » rapprochés, à distance convenable (javelots, flèches et frondes) ; ce qui est facilement démontrable sur le site d’Alise-Sainte-Reine. Rien à voir avec les petites branchettes ridicules du livre de Michel Reddé.
-
@ blurpy
Précision/explication à ma phrase "les castella mis au jour à Alise-Sainte-Reine se trouvent bien entre les deux lignes« . Il ne faut confondre ces »castella« avec les tours des lignes de retranchement dont on a également retrouvé la trace. Il s’agit d’enclos du type »postes avancés" que César avait disposés dans un premier temps, tout autour de la position de Vercingétorix pour le surveiller. C’est à partir de ces postes avancés que les légionnaires ont construit la ligne de retranchement plus en avant. Ces enclos n’ont pas été abandonnés mais ils se sont trouvés inclus dans le système de défense. C’est dans ces enclos que stationnaient les légionnaires en plus des camps de crête. C’est de là qu’ils détachaient sur l’agger des lignes d’encerclement leurs éléments de guet et d’alerte. Ce sont dans ces enclos que se trouvaient les réserves locales dans lesquelles Labiénus puisera pour aller au secours du front de Bussy (les camps nord des deux légats). Quant aux réserves générales, elles se trouvaient sur le montagne de Flavigny, à la botte de César, mais aussi dans les grands camps extérieurs de la plaine, au pied de Flavigny, avec les cavaliers germains.
-
Réponse de Danielle Porte : Réponses aux questions posées par le colonel Mourey.
« Pourquoi voulez-vous ne pas reconnaître dans les traces mises au jour
par les archéologues l’emplacement de ces tours, des camps, des lignes
d’obstacles, des obstacles eux-mêmes, dont César nous a parlé d’une
façon extrêmement précise ? »Eh, justement !!!
J’emprunte toujours aux défenseurs d’Alise eux-mêmes la suite des
réponses que je vais vous donner. Nous ne sommes pas plus royalistes
que le roi, et n’allons pas sauver Alise là où ses défenseurs eux-
mêmes avouent que rien n’y correspond au texte de César !les tours : il faut 24 m de distance entre elles. Aucun espacement des
fouilles alisiennes n’a jusqu’ici respecté cette mesure : Michel Reddé
l’avoue (Rapport de fouilles p. 110 ) : « 3 tours successives,
espacées d’environ 17/17,50 m l’une de l’autre (soit à peu près 60
pieds), jalonnent l’agger dans le même chantier XXII » et sur la
montagne de Bussy : 58 m ! (même Rapport, p. 130).les camps : les Alisiens n’ont conservé aucun des camps de plaine
(poterie gallo-romaine etc.).Je ne peux admettre, d’autre part, que des camps soient situés en
dehors de la circonvallation, élevée pour les protéger d’une attaque
extérieure, ni que les légionnaires doivent s’entasser entre les
lignes sur seulement 120 m, ni que des camps mesurent de 35 ares à 9
ha lorsqu’il faut 45 ha. Ces simples observations auraient dû arrêter
d’emblée toute identification indue.les obstacles : ils sont disposés en avant des fossés, pour protéger
la confection des travaux (7, 73, 2) et ils se trouvent en arrière :
ils ne protègent donc plus rien du tout.cippi et lilia : ces derniers devraient être sur 8 rangées, les trous
distants de 90 cm, les pieux taillant environ 20 cm de diamètre. Les
lilia napoléoniens sont sur 5 rangées, distants de 2,60 m et leur
diamètre est de 80 cm. Les cippi devraient être en tranchées
continues, profondes de 1,50 m, la profondeur est de 35 cm ; ils sont
parfois en trous individuels. Ni pour les uns ni pour les autres le
nombre de rangées n’est conforme.lignes : 9 km de lignes en excédent par rapport à ce qui aurait suffi
pour bloquer le mont Auxois ; des longueurs de fortifications qui
partent dans la nature, expliquées par la mauvaise volonté ou
l’incapacité des chefs de travaux ! « Ce ne sont pas tout à fait les
dimensions indiquées par César, mais il est clair que le proconsul a
voulu impressionner ses lecteurs tandis que ses troupiers ont fait ce
qu’ils ont pu, ce qui représentait déjà un travail formidable. »
Comment Joël Le Gall (la Bataille d’Alésia, 2000 (1997), p. 64)
pouvait-il supposer cela, quand, justement, les lignes effectives
dépassaient de 9 km les instructions données par César ! Étaient-ce
les « troupiers » qui voulaient impressionner les lecteurs de leur
chef ?Conclusion : « Compte tenu du résultat des fouilles actuelles,
l’archéologie montre à l’évidence que la description faite par César
ne correspond pas, stricto sensu, à aucun des secteurs explorés ».
Signé : Michel Reddé, Catalogue de l’exposition sur Vercingétorix et
Alésia, tenue au musée de Saint-Germain en Laye, 1994.Pour ce qui est de notre site Internet, nous l’avons modifié sans
avoir eu connaissance de vos remarques, simplement pour faire place à
la critique en forme d’Alise et à la comparaison des réalités Alise et
Chaux qui occupe bon nombre de pages (alesia.jura.free.fr, lien sur la
page d’accueil « le point sur la localisation ») et remplace un
développement antérieur trop succinct.Pour ce qui est d’esquiver le débat sur le latin, ce n’est pas
précisément ni mon intérêt ni mon intention, puisque l’hypothèse
d’André Berthier est partie justement du texte latin, qu’il
comprenait, lui, correctement.Pour ce qui est de « chercher une diversion sur les terrains de la
philologie, de l’interprétation archéologique, militaire, stratégique
et géographique », il me paraît indispensable de faire concourir,
précisément, l’ensemble des données de tous ordres qui peuvent
éclairer un texte historique, et le corroborer ou l’infirmer. Sans
quoi, on fait de l’histoire à plusieurs vitesses. Et on permet à
l’archéologie de prétendre que le « flou » de la description de César
autorise à valider tout et n’importe quoi. Si l’Histoire ne se donne
pas comme première loi l’examen rigoureux de toutes les données, où va-
t-on ? À Alise, hélas…Nous n’avons pas parlé de la taille du mont Auxois et de ses 97 ha
(qui laisseraient 10 m2 disponibles à chaque guerrier, à supposer
qu’ils occupent chaque centimètre carré de la colline, sans qu’il y
ait de chevaux, ni de bétail, ni de Mandubiens, ni de ville
mandubienne, ni de pâturages, ni de bâtiments, ni de structures
cultuelles, et à supposer que ces guerriers ne fassent pas un
mouvement hors de leurs 10 m2 pendant plus d’un mois) ; ni des
Séquanes ; ni de la localisation du combat préliminaire de cavalerie.
Ce sont pourtant aussi des éléments à prendre en compte. Et pas non
plus de la reconstitution stratégique, pourtant un élément de premier
ordre, impossible à réaliser à Alise.J’attends à présent que vous me montriez en quoi « à la Chaux-des-
Crotenay rien ne concorde ».Avec sérénité.
Danielle Porte
P S de Blurpy : Le message d’origine a été scindé en plusieurs parties, car le nombre de caractères dépassait le maximum autorisé par commentaire sur le serveur Agoravox.
-
@ Blurpy
Vous dites : J’emprunte toujours aux défenseurs d’Alise eux-mêmes la suite des
réponses que je vais vous donner. Nous ne sommes pas plus royalistes
que le roi, et n’allons pas sauver Alise là où ses défenseurs eux-
mêmes avouent que rien n’y correspond au texte de César !Voilà bien le problème, ou plutôt l’histoire de fous. Dans un sens, vous êtes logique avec vous-même et je ne peux que vous approuver quand vous mettez les « Alisiens » face à leurs contradictions. Mais, bis repetita, cela fait déjà un certain temps que je ne crois plus aux faraboles de l’archéologie officielle et que j’ai choisi de ne me référer qu’aux textes.
Qu’il y ait quelques nuances dans les intervalles séparant les tours, cela prouve tout simplement que les exécutants n’ont pas appliqué à la lettre les instructions de César, pour des motifs divers. Quant aux camps de la plaine, je suis étonné que vous puissiez dire qu’aucun vestige existe, vu qu’on en a retrouvé parfaitement la trace. Etonné également que vous ne compreniez pas l’intérêt tactique et stratégique qu’il y avait à conserver, pour César, ces camps extérieurs, base logistique et base d’intervention à l’extérieur des lignes par des réserves conséquentes notamment germaines. Etonné que vous, et d’autres, ne vous posiez pas la question du lieu de stationnement des cavaliers germains.
Etonné également que vous ne compreniez pas, ainsi que d’autres, qu’au début de l’investissement, César se trouvait dans un camp de la plaine, que ses premières fortifications ont été celles de ces camps, que ses premières mesures de sécurité l’ont été pour protéger son camp de la plaine ainsi que ses abords où les légionnaires rassemblaient et fabriquaient les multiples obstacles qu’ils allaient disposer sur les lignes de retranchement prévues. Il faut se replacer dans le temps. Les premiers retranchements évoqués par César sont en rapport avec les camps de la plaine et non, comme vous le pensez, avec les lignes de retranchement qui n’étaient que prévues.
En ce qui concerne les obstacles, merci de remettre, une fois de plus, en évidence les errements actuels des interprétations officielles. Reportez-vous plutôt aux résultats de fouilles des archéologues allemands et vous constaterez qu’elles corroborent mes explications et interprétations, telles que je les aient développées dans mes ouvrages et mes articles.
Je ne critique pas la méthode d’André Berthier mais, dans ma traduction du texte latin, je ne vois qu’Alise-Sainte-Reine qui puisse correspondre à son portrait robot.
Question taille du mont Auxois et effectifs gaulois, je vous répondrai seulement qu’il ne faut pas confondre effectifs prévus et effectifs réalisés. Je ne doute pas des chiffres donnés par César, ou plutôt par Critignatos, mais, comme il le dit par ailleurs, ce sont les Eduens qui avaient planifié l’affaire pour l’armée de secours. Or qui dit plan dit plan de mobilisation. Voyez les tablettes de recensement des Helvètes. Personne aujourd’hui ne pense que toute la population recensée a émigré.
Bref tout concorde à Alise-Sainte-Reine. Et tout ce que je viens de dire et d’expliquer ne se retrouve pas à la Chaux-des-Crotenay, ou alors, il faudrait que le terrain y soit la réplique exacte de celui d’Alise-Sainte-Reine, ce qui n’est pas le cas et il aurait fallu qu’on n’ait rien retrouvé comme vestiges à Alise. Et je ne vous parle pas de ma localisation de la fameuse bataille de cavalerie etc.
Je pense que vous êtes dans la méthode Coué comme les archéologues officiels le sont pour leurs emplacements de Gergovie et de Bibracte et que, n’étant pas plus royaliste que le ministre de la culture, je ne peux que constater le misérabilisme intellectuel de notre époque et de mes contemporains. Point !
-
On ne reviendra pas ici sur le délire de Mourey, amplement dénoncé ni sur son inconsistance européenne, le pauvre homme étant capable de voir trois fenêtre là où il y en a 5.
Mais l’occasion se présente de présenter les erreurs de Mme Porte et de son mentor, Berthier.
Madame Porte, il faut dire tend les perches :
« Ce murus gallicus est typique des villes du IIème av. J.-C., tandis
que les remparts d’Alésia « métropole religieuse de toute la Celtique
» selon Diodore de Sicile (4, 19, 1-2) doivent remonter à l’époque
d’Hercule, i.e. aux siècles de la guerre de Troie, et ressembler aux
murs des villes grecques archaïques, Tirynthe, Argos, Mycènes ; être,
donc, constitués de dalles cyclopéennes. »
Elle croie donc que l’on va gober ce genre de délire, qu’elle peut délocaliser Mycène dans le Jura comme Berthier délocalisait toute la Numidie jusqu’à rendre incompréhensible toute l’histoire de Rome en Afrique et sans se rendre compte de l’importance de monument qu’il avait pourtant sous les yeux, comme le Medracen.
Eh bien, Madame Porte apprenez que l’archéologie a des régles, qu’on ne peut plus faire du celtomanisme qui mélange tout, apprenez aussi que l’histoire a des régles - mais les avez-vous apprises car quelle est votre formation ? - et que savoir traduire un texte ne sert à rien historiquement si l’on est incapable de le critiquer en suivant les méthodes qui furent développées sur des siècle de Mabillon à Bloch.
Mais surtout Madame Porte parlez nous des analyses de Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu : il y a-t-il un seul partisan de Chaux qui a réfuté ses analyses et les avancées qu’il a donné à la numismatique celtique, et s’il vous plaît ne me citez pas les articulets de vos feuilles confidentielles sans comité de lecture et sans consistance scientifique.
Parlez nous de ces tas d’épierrements que par miracle vous transformez en mur mycénien, parlez nous des analyses de Monsieur Meloche, expliquez nous comment vous pouvez encore vous prétendre scientifique et vouloir parler d’archéologie après avoir fait fi de toute stratigraphie, car n’avez vous pas écrit que vous avez retrouvé à Chaux le niveau que vous fantasmez antique par dessus des niveaux du moyen-âge et n’avez vous pas tenté une argumentation du désespoir : la peste noire aurait entrainé des résurgences culturelles, bel effet du bacile qui ravive la mémoire gauloise !! Bref une erreur de méthode archéologique (typologie aberrante et absence de précision) mais ensuite un crime contre la méthode (faire fi de la stratigraphie), puis un crime contre la logique (inventer de toute pièce une argumentation sur des spéculations dont aucune ne peut-être appuyée par un fait).
Berthier s’est entété sur la Numidie en vain, personne ne l’a suivi dans son absurde géographie, puis il s’est entété sur Alésia à Chaux et aujourd’hui la situation est claire : la totalité de la communauté scientifiques des archéologues et historiens a oublié ses spéculations que M. Picard avait déjà réfuté sans appel au congrès de Dijon.
Jusqu’à quand, Madame Porte, allez vous abuser de notre patience, votre imposture scientifique n’a que trop duré.-
@ Samosatensis
Il y a effectivement cinq fenêtres dans l’abside du Crest comme c’est le cas général. J’ai seulement émis l’hypothèse que les deux ouvertures latérales aient été bouchées. Il faudrait aller voir sur place.
-
@Samosatentis
Qui etes vous pour tenir des propos aussi odieux ? Ne savez vous pas argumenter sans insulter vos interlocuteurs ?
C’est votre impolitesse qui a assez duré !
Jamais un véritable scientifique ne se permettrait une telle attitude.
Faites vous soigner, et revenez discuter après, Monsieur Samosatentis ! Honte à vous ! Votre comportement est inqualifiable.Pierre Gibout
-
@ Samosatensis
J’ignore ce qu’a bien pu vous faire feu André Berthier pour que vous
condamniez l’ensemble de ses travaux avec une telle hargne...
J’ignore si des motifs personnels expliquent le dédain avec lequel vous
critiquez les interprétations des textes avancées par Danielle Porte...
J’ignore si la modestie (apparente) du cursus du colonel Mourey chagrine
l’universitaire que vous semblez être...
Ce que je sais, c’est qu’en vous cachant sous un opportun anonymat, vous
ôtez beaucoup de poids à vos philippiques.
A. Berthier, D. Porte et M. Mourey, publient (ou ont publié) leurs thèses
et leurs idées sous leur véritable identité, à visage découvert.
Pourquoi n’en faites vous pas autant ?
Souvenez-vous que si le courtisan trouve parfois sous le masque une
certaine grandeur, ce n’est jamais le cas du polémiste.
La discrétion peut seoir au premier, même s’il est dans l’erreur. Seul le
second , et votre érudition manifeste aurait dû vous l’enseigner, a
nécessairement besoin de l’ombre quand il veut perpétrer un mauvais coup.
Le vrai Samosatensis était, dit-on, surnommé « Prince du gai savoir »... Il
doit pleurer de honte et de chagrin en constatant les pratiques de son
avatar.@ MoureyVous expliquez la taille de la plaine , qui selon vous correspond sans l’once d’une hésitation , à la description donnée par César , par la présence de forêts .L’espace laissé libre par ces forêts , serait l’espace dévolu aux combats , et correspondrait donc aux mesures délivrées par le texte .Sauf ...Que le texte n’en fait pas mention , pas plus d’ailleurs que le rapport de fouilles !Je cite :« Dans le chatillonais , au pied de Vertillum ...assez semblable à celui d’Alésia , les données palynologiques montrent un déboisement important dès l’âge du fer .Elles montrent que le paysage est ouvert : le pourcentage de N.A.P ( tout ce qui n’est pas arbre ) ...indique une forêt fortement réduite .
...pas de forêt-galerie marécageuse dont nous n’avons aucun argument sédimentologique par ailleurs . »
Donc pas de forêt dans les environs , il va falloir trouver autre chose ...-
@ bellovèse
Je sais que la mode actuelle est de vouloir réécrire l’histoire par la seule archéologie et à l’aide de pseudo-sciences annexes à la fiabilité discutable. Je suis, en ce qui me concerne, de la vieille génération et fais confiance aux auteurs de l’antiquité. Je ne me fie qu’aux textes, à condition bien sûr de les traduire correctement et de bien les interpréter.
Il est vrai que Strabon dit que la Gaule était cultivée et qu’on n’y voyait pas de friches à l’abandon mais je peux vous affirmer qu’en ce qui concerne la Bourgogne, la région était abondamment boisée jusqu’au Moyen-âge et que le Morvan l’était aussi... à l’exception de son sommet pelé. Que la Saône-et-Loire est un des départements les plus riches en vestiges archéologiques et ces vestiges, on ne les trouve pas dans les bois, ni d’hier ni d’aujourd’hui.
Il est vrai que César ne précise pas que sa plaine se fermait sur une forêt. Pourquoi l’aurait-il précisé ? César ne dit que ce qu’il faut pour comprendre le déroulement des combats. Et puis, dans son cerveau latin de tacticien, la plaine est synonyme de terrain plat permettant un affrontement de cavalerie, donc sans arbres. Enfin, il y a la logique de ce qu’était un pagus gaulois. Sur le mont Auxois se trouvaient la ville des Mandubiens et leur oppidum refuge. C’est seulement autour de ce centre, dans un rayon plus ou moins étendu que le terrain était défriché : champs réservés à la culture et prairies pour le bétail et les chevaux. Plus loin, c’était la forêt... et l’insécurité.
-
@MoureyIl me semble , mais je peux me tromper , que vous refusez de vous fier à l’archéologie , parce que celle-ci ne valide pas vos théories .Il est bien évident que les principales sources sur Alésia sont antiques , il convient donc de s’y référer , et effectivement la recherche de la traduction la meilleure doit rester la règle .Mais il faut aussi veiller à ne pas surinterpréter le ou les textes .Concernant l’archéologie , il est tout à fait regrettable que vous ayez choisi de ne pas vous en soucier , d’une part vous vous privez d’une source d’information essentielle , d’autre part , cette attitude enlève beaucoup de crédibilité à vos démonstrations .La qualité de l’archéologue moderne ne saurait être remise en cause , pas plus que l’ensemble des moyens scientifiques à sa disposition .Les analyses palynologiques et anthracologiques effectuées sur le site d’Alise , démontrent que la région était fortement déboisée à la fin de l’âge du fer .Voici d’autres extraits issus du rapport de fouilles :« Les pollens d’herbacées permettent de restituer un paysage de cultures , de céréales ...
La forêt est extrêmement réduite et les véritables espaces forestiers devaient être très éloignés du site ( plusieurs km ? ) ; il ne devait subsister localement que de rares bosquets .
L’abondance de prunelliers , des orties ou du robinier sont des indices palynologiques de forêts altérées , mal ou surexploitées .
Les massifs forestiers étaient quasi absents ou à l’écart »Il ne me paraît pas raisonnable de conclure que l’environnement forestier de la fin de La Tène était le même qu’au moyen-âge , soit la bagatelle de mille ans d’écart !Et ceci , sans démonstration scientifique un tant soit peu étayée .Toutes les analyses à notre disposition indiquent justement que ce paysage était sensiblement le même qu’actuellement .
-
@ Bellovèse
Je ne ne réfute pas du tout l’archéologie mais les interprétations archéologiques qui se sont imposées dans la communauté scientifique sous le nom prétentieux d’archéologie dite scientifique. Pour moi, la recherche historique s’appuie sur trois piliers ; d’abord une meilleure traduction et une meilleure interprétation des textes, ensuite la logique notamment militaire, enfin et seulement en troisième lieu, une bonne interprétation archéologique. Cette troisième condition n’étant pas déterminante mais confirmative ou réfutante alors qu’aujourd’hui, elle écrase tout le reste, d’où l’erreur de localisation de Bibracte et de Gergovie que l’archéologie officielle ne veut pas reconnaître. J’ai retraduit les textes. Ils s’accordent avec la logique et avec l’interprétation archéologique que je propose. Bien sûr que je ne fais pas le poids face à la communauté scientifique comme les différents ministres de la Culture me l’ont clairement fait sentir. Et pourtant, je ne demande que peu de choses : que le ministre de la culture, en liaison avec le ministre de l’éducation nationale, rassemble les meilleurs professeurs de latin pour débattre notamment sur les passages importants du texte de César et de celui de Strabon. Pour ma part, j’ai proposé des traductions plus exactes. Mises à part les vociférations de Samosatensis, aucun latiniste ne les a réfutées.
Je suis très réservé sur les nouvelles techniques que vous invoquez car il me semble assez clair que les interprétations sont à sens unique et n’iront jamais en sens contraire des thèses du collège de France.
Et pourtant, je devrais me réjouir de ce que vous dites sur l’environnement d’Alise-Sainte-Reine car cela s’accorde bien avec mon interprétation du texte de César : les prunelliers, autrement-dit épines noires, que j’ai identifiés avec les fameux « cervi » du texte de César, les robiniers que j’ai identifiés aux fameuses colonnes de la mort que les Romains ont tirés dans le fossé extérieur après en avoir écourté et épointé les branches. En revanche, cela m’étonnerait que les Romains aient été obligés d’aller les chercher à des kilomètres de là. Le texte montre, bien au contraire, que César a trouvé sur place ou non loin de là, tous les arbres et arbustes qui lui ont été nécessaires pour réaliser ses obstacles. S’il avait fallu aller les chercher à plusieurs kilomètres, César l’aurait certainement spécifié car cela aurait nécessité l’organisation de véritables convois.
Bref, je ne veux surtout pas condamner les nouvelles techniques, notamment la dendrochronologie, mais seulement les interprétations aventureuses dans le sens de la pensée dominante ou d’une pensée nouvelle. Et j’en reviens toujours aux textes, car la Bourgogne en est très riche notamment avec ses nombreux cartulaires. Et ces textes semblent bien montrer une permanence des forêts traditionnelles dans le temps. Et, comme vous dites, sauf cas particulier, il est très possible que le paysage ait été sensiblement le même qu’actuellement .
-
@Mourey
Encore une fois , il me semble tout à fait aléatoire et aventureux de considérer que le site d’Alise était recouvert de forêts à l’époque de la guerre des Gaules . Si vous n’avez pas d’autres preuves que des textes moyenâgeux , et conséquemment pas l’ombre d’un texte antique sur le sujet , votre démonstration n’a pas beaucoup de valeur .
Vous vous plaignez de ne pas être écouté , mais sincèrement si vos démonstrations ne sont pas plus étayées , cela ne m’étonne guère !
Il n’y avait pas de forêts dans l’environnement du siège , les fantômes des pièges et des poteaux de tours l’attestent sans l’ombre d’un doute .Les pièges sont pour la plupart de conception légère , idem pour les poteaux de tours d’un diamètre moyen de 20 cm , certains ne faisaient même que 15 cm .L’armée romaine qui a fait le siège d’Alise a utilisé tout le bois à sa disposition ( bois , bosquets , friches ) , et l’absence de pièces de bois importantes sur les travaux de siège en est la parfaite illustration .
Se reporter au rapport de fouilles et à la synthèse sur l’environnement du site d’Alise ( Christophe Petit ) .
Concernant un éventuel débat autour du texte de César , pourquoi pas ?
Mais cette idée ne semble finalement pas motiver grand monde , autant se contenter d’être simplement précis dans la traduction , comme essaye de le faire Danielle Porte .
-
Il semble que les interventions soient terminées , ceci me semble logique , le débat entre Danielle Porte et Emile Mourey est clos , et il était question de philologie et non d’archéologie .
Toutefois dans ce débat , et pour en finir , Mr Mourey , puisque vous y avez introduit quelques réflexions archéologiques , je trouve surprenant que vous défendiez encore l’hypothèse de camps romains dans la plaine et à l’extérieur de la ligne de circonvallation , alors même que ces camps pour les plus emblématiques , ont été invalidés par les dernières fouilles .Quelles sont vos preuves ?
« Bis repetita, je ne cautionne pas les errements des archéologues officiels. Le professeur le Gall a écrit que les camps de la plaine avaient été abandonnés par les Romains. C’est encore une invention de l’archéologie officielle. Rien ne permet de dire cela et voilà pourquoi on n’a rien compris au déroulement de la bataille, ni le professeur le Gall – que j’ai pourtant alerté dès 1981, ni ses successeurs. Et puis, la vérité historique ? Qui s’en inquiète aujourd’hui ? »
Sur quels éléments vous basez vous pour affirmer que l’abandon des camps de plaine par l’archéologie officielle est une invention ? Là encore quelles sont vos preuves ?
« Qu’il y ait quelques nuances dans les intervalles séparant les tours, cela prouve tout simplement que les exécutants n’ont pas appliqué à la lettre les instructions de César, pour des motifs divers. Quant aux camps de la plaine, je suis étonné que vous puissiez dire qu’aucun vestige existe, vu qu’on en a retrouvé parfaitement la trace »
Bis repetita , quelles sont les traces des camps dans la plaine ? Si l’on prend comme exemple le camp I, un des cotés s’est révélé être un paléochenal ! Un autre des fossés , coupe les lignes défensives attribuées à César , ce fossé est donc incontestablement postérieur ... Vous niez les apports archéologiques récents mais qu’avez vous de mieux à proposer ?
Quant aux tours , qu’il y ait des nuances dans les espacements , c’est une notion que tout un chacun est capable de comprendre si l’on considère la longueur des lignes d’investissements , mais qu’à l’emplacement exact ( contrevallation de la plaine des Laumes ) où César effectue ses mesures , nous passions des 17 m du terrain au 24 m du texte , ne voyez vous pas là comme une contradiction ?
L’apport de l’archéologie moderne pour comprendre l’histoire est incontournable , à Alise comme ailleurs , pour autant il n’est pas interdit d’en pointer certaines contradictions .
Par contre s’en passer , ne semble pas sérieux !
-
Concernant le véritable site d’Alésia je dois dire que je suis plutôt d’avis que les traces me semblent parler en faveur de CHAUX DE CROTENAY dont j’aimerais connaître l’étymologie CROTENAY = QUID ???
Je constate avec tristesse que la maffia qu’est l’intelligentsia (cnrs et autres nids à poussière) bloque toute recherche sérieuse à CROTENAY alors que des fortunes sont englouties à Alise...
C’est le combat éternel des innovateurs contre les vieux encroûtés. Nul n’est jamais prophète dans son propre pays et tout innovation est condamnée comme hérétique à la crucifiction ou au bûcher.
Pour toutes ces raisons je salue chapeau bas Madame Danielle Porte.
Je salue également Mr Berthier là haut où qu’il puisse être.
Et merde à tous les empaffés de l’establishment !
Patrick Jouannès alias dictionaricdotcom autodidacte et fier de l’être.-
@dictionaricdotcom
Je me réponds à moi-même concernant l’étymologie de CROTENAY puisque l’étymologie est mon dada.
Hypothèse : La racine CROT— viendrait comme le mot GROTTE du grec CRYPTA « chose cachée » passée en latin et plus tôt en Gallo-roman. Mais pourquoi s’interdire de penser que les Celtes aient pu aussi utiliser cette racine avec le sens de « grotte ».
Dans le cas latinisant CROTENAY serait issu d’un CRYPTANETUM « lieu de grottes ».
Mais ceci n’est pour l’instant qu’une idée qui me vient à l’esprit.
Imagination ou instinct ???
Nous verrons.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








 Donc pas besoin d’en faire une affaire aussi émotionnelle et d’en arriver à l’invective.
Donc pas besoin d’en faire une affaire aussi émotionnelle et d’en arriver à l’invective.
 .
.
