Au nom de la loi
Ou l’arrière-cuisine de la haute finance.
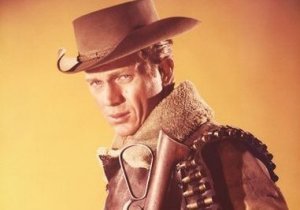
Il ne s’agit pas ici d’un énième commentaire dithyrambique sur Rachida Dati et la politique du gouvernement Sarkozy, bien qu’il y ait beaucoup à dire et à écrire, la volonté affichée par la droite de dépénaliser le droit des affaires n’étant pas le moindre pavé dans la marre.
Non, ce qui me préoccupe maintenant, c’est la façon irresponsable dont la société moderne se laisse peu ou prou piloter par un nombre de "lois" qui s’approprient (ou tentent de le faire) notre réel.
Au risque de le conduire au chaos !
En premier lieu, j’entends ici "décomplexifier" à défaut de "décomplexer", autant que faire se peut, ce que d’autres se plaisent à rendre parfaitement abscons au plus grand nombre d’entre nous.
Je vais essayer de vous parler d’algorithmes, ces fameux modèles mathématiques très à la mode dont se servent avec délectations les "grosses têtes" des salles de marchés boursiers.
Je sais que pour beaucoup d’entre vous, les mathématiques ne représentent pas vraiment de fameux souvenirs du temps passé à l’école... Et je n’ai pour ma part aucune compétence particulière en la matière, si ce n’est quelques souvenirs de ma période scolaire avec un bac scientifique et une année en classe préparatoire à des études commerciales.
Soyez donc rassurés, je ne vais pas rentrer dans des détails très compliqués, mais néanmoins tenter de soulever le couvercle de la marmite !
ALGORITHMES ou les recettes miracles de la haute finance mondiale
Pour faire le plus simple possible, un algorithme correspond grosso modo à une série d’instructions (des lignes de programme) qui permettent à une machine de "traiter" des données (par exemple les trier) et de produire à volonté des états synthétiques (faciles à lire), analytiques (classement des individus=les données, selon leur âge, leur sexe, leur taille, etc.) ou prospectifs (quelle sera la population féminine de plus de 1,80 m dans cinq ans par exemple).
Là où le système mis en place devient cocasse, c’est quand la haute finance a jugé intéressant d’investir en "grosses têtes" et en systèmes informatiques surpuissants pour mettre la vie (économique) en équations. L’enjeu n’est banal puisqu’à défaut de pouvoir transformer le plomb en or, il serait possible de se faire de l’or sur le marché du... plomb (ou du blé, du pétrole, de l’indice bousier des valeurs sud-coréennes de la fabrication d’horloges francomtoises ou que sais-je encore).
Le hic (et ce n’est pas le moindre), c’est que les mathématiques manient couramment la notion d’infini (vous vous souvenez certainement du petit signe qui ressemble à un poisson horizontal), mais un algorithme qui se respecte a tendance à ne pas bien les aimer les infinis, aussi bien l’infiniment petit que l’infiniment grand car le programme tournerait "indéfiniment" sans donner de résultats.
Nous entrons dans le paradoxe de toutes les lois "mathématiques" dont se servent nos élites pour prédire le réel : à un moment ou un autre pour mettre le réel en équation, il faut opérer une simplification et l’infini qui n’existe pas sur terre fait alors l’objet d’approximation, et devient parfois une constante, ou bien parfois est jugé négligeable.
Bien que tout soit fait aujourd’hui pour recadrer les individus, formater leurs consciences et leurs désirs, standardiser leurs envies et leurs comportements et, par là même, faire disparaître, autant que se peut, les comportements "déviants" (par rapport à la moyenne), nous ne serons jamais tous dans la "cloche" de la loi de Gauss.
N’importe quelle personne douée d’un minimum de bon sens sent bien que prévoir la hausse ou la baisse d’une valeur boursière, ou bien calculer l’heure le jour et le créneau horaire au cours duquel il faut passer des ordres boursiers est une gageure.
Pourtant ce système est celui qui prévaut aujourd’hui et l’économie virtuelle, sorte de casino géant pour ados shootés à l’adrénaline, est un cauchemar dont nous sommes les spectateurs effarés.
L’économie de grand-papa, c’est dépassé.
Les grands projets industriels et commerciaux, c’est également dépassé.
Le truc aujourd’hui c’est s’octroyer du crédit (sans avoir de richesse tangible à laquelle l’adosser) et jouer avec d’autres bénéficiaires de crédit à l’algorithme "qui tue". Jackpot pour certains tant que les crédits continuent et que l’on peut encore rembourser ses crédits avec... du crédit.
Mais, au bout du compte, lorsqu’il y a évidemment plantage, que les pertes affichées sont colossales et que le crédit n’est plus possible, alors il faut bien se rendre compte qu’il n’y a plus rien et certainement pas d’autres richesses que d’hommes, ceux-là mêmes qui se lèvent (le matin), suent leur labeur de la journée et rentrent (tard le soir) s’occuper (un peu) de leur famille.
Faut-il comme certains tenter de rechercher le "bug" dans la machine, ou bien ne savons-nous pas très bien que le "bug", c’est eux ?
Documents joints à cet article

12 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









