Autisme : à propos d’un « itinéraire institutionnel d’un sujet en devenir »
Le magazine PsychoMedia, dans son n°46 de mars/avril 2014, nous fait bénéficier sur 3 doubles pages d’un long récit intitulé « Entre soins et apprentissages : itinéraire institutionnel d’un sujet en devenir ». Cet article retrace plus de dix ans de suivi d’un adolescent dans un service de « psychopathologie de l’enfant », dans un grand hôpital parisien. A priori aucun rapport avec l’autisme ?... Cela reste à voir.
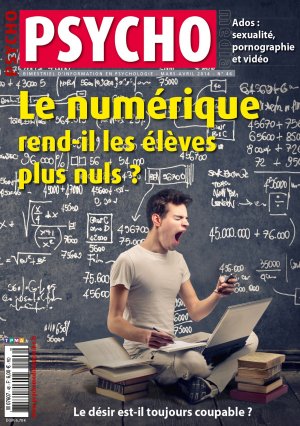
D’emblée, le cadre est posé par les premières lignes de l’article : « quels sont les aménagements et les effets possibles du travail institutionnel dans le traitement de la psychose chez l’enfant ? » On va parler de psychose de l’enfant pendant 6 pages, alors même que ce terme a été abandonné par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis 30 ans, et n’est plus utilisé qu’en France. Ce n’est en effet plus que dans notre pays qu’on considère encore que les enfants peuvent devenir « fous ». Alors que partout ailleurs dans le monde on réfléchit en termes de troubles du développement neurologiques et de rééducations précoces, chez nous on pense en termes de « soins psychiques », malgré les preuves scientifiques, malgré les préconisations de la Haute Autorité de Santé.
Qu’est-ce qui peut donc rendre nos enfants fous, selon les psychiatres et psychologues de cette institution ? Il n’y a pas à chercher bien loin dans l’article pour trouver le coupable : la mère, bien entendu. Car l’enfant, « dans la psychose, (est) imbriqué dans le fantasme de la mère, (…) il devient l’objet de la mère » ; on trouve encore « l’emprise de la mère toute-puissante », « c’est la mère qui lui tient lieu de prothèse désirante – et aliénante ». C’est donc bien sa mère qu’on accuse directement d’avoir rendu son fils « psychotique ». On est dans la pure théorie psychanalytique lacanienne, complètement invalidée et abandonnée partout ailleurs qu’en France, et que même en France la Haute Autorité de la Santé récuse.
Faisons une parenthèse : dans le même hôpital parisien, un service voisin fait partie des centres de diagnostic d’autisme agréé par le Centre Ressource Autisme d’Ile de France. Devant un tableau qualifié de « psychose infantile » tout psychiatre aujourd’hui sait très bien que la HAS et l’OMS préconisent de parler de trouble du développement et qu’il est indiqué de mettre en œuvre les bilans de recherche de diagnostic de l’autisme. Il aurait été facile d’adresser cet enfant aux collègues du même hôpital pour affiner le diagnostic et rechercher un trouble du spectre autistique ; pourquoi donc cela n’a-t’il pas été fait ?...
Revenons à notre « sujet en devenir » ; quels sont ses symptômes exactement ? Le motif de consultation initial est mentionné comme étant la « dyslexie associée à l’hyperactivité ». L’enfant a été agité dès la maternelle, a redoublé la grande section et le CP, et a fait plusieurs années d’orthophonie en libéral sans trop d’effet avant de passer au CMPP qui l’a adressé à ce service. « J. parle sans cesse, remue », « impossibilité de s’engager dans un savoir quel qu’il soit ». On est bien dans un tableau classique de déficit d’attention avec hyperactivité, sachant que ce trouble est fréquemment associé à l’autisme dans l’enfance.
On note aussi des « phrases toutes faites » interprétées comme « écran protecteur contre une menace de désorganisation psychotique » ( !), alors qu’il peut très bien s’agir d’écholalies là encore quasi systématiques dans un autisme. On retrouve plus loin dans le texte la mention de « phrase qui revient comme une ritournelle », de « locutions (avec) énonciation bouclée sur elle-même, parole vide »… C’est pourtant caractéristique des écholalies, ce mot n’apparait nulle part.
J. manifeste par ailleurs un intérêt marqué pour l’armée, disant dès les premières consultations qu’il veut devenir soldat. Il se décrit lui-même d’ailleurs comme « un vrai petit soldat » et se dit « aux ordres ». Cet intérêt reste intact tout au long du suivi pendant plus de 10 ans ; rappelons que les centres d’intérêts restreints sont une des caractéristiques de l’autisme.
Socialement, on nous dit qu’à 16 ans « aucune relation privilégiée avec un pair n’émerge », c’est sa fiancée « qui le sollicite, lui-même restant passif ». On note aussi qu’il lui arrive de caresser les cheveux de son père pendant les consultations. Et aussi « la passivité domine, (…) le dialogue doit être relancé, réanimé par l’autre ». J se plaint constamment de sa « fatigue » qui est interprétée comme venant « nommer un rapport au désir caractérisé par la difficulté à s’y faire sujet ». Plus simplement, les collègues du centre ressources autisme y auraient peut-être, eux, vu plutôt l’effet des efforts que doit fournir une personne autiste pour tenter de comprendre les codes sociaux et s’y conformer à longueur de journée. Car on voit bien se dégager de cette description un déficit certain des capacités sociales.
Bref, au moins deux traits de la « triade autistique » apparaissent clairement chez cet enfant, les troubles de la communication et ceux des interactions sociales. L’intérêt pour l’armée et les écholalies pourraient faire penser au troisième élément, les « intérêts stéréotypés ou restreints ». Rien qu’à la lecture de cet article, on se dit qu’en plus de 10 ans de suivi, on aurait pu penser à un possible trouble apparenté à l’autisme, comme le syndrome d’Asperger, et faire appel aux collègues du bâtiment voisin pour préciser le diagnostic. Cela n’a donc pas été fait, mais c’est une situation très fréquente en France, dénoncée par les associations de familles comme Autisme France ou Vaincre l’Autisme : l’errance diagnostique et les diagnostics obsolètes de « dysharmonie » ou de « psychose infantile » (souvent reprochée encore et toujours à la mère), avec le risque de conduire à des prises en charges non appropriées.
Justement, quelle prise en charge est-elle proposée pour aider cet enfant ? Au début du suivi, J a 8 ans et sort de plusieurs années d’orthophonie peu efficaces. On lui propose « des entretiens familiaux et une remédiation de la langue écrite avec une psychologue, (…) thérapie individuelle qui utilise l’écrit comme support pour introduire la question du symbolique ». Pour quels résultats ? Au bout de deux ans ( !) de suivi, J « commence à s’apaiser » et « un accès à la lettre se fait jour dans l’espace contenant de la feuille » (on retrouve la notion de contenance chère aux adeptes de la théorie du « moi-peau » d’Anzieu). Hélas, les parents décident alors de se séparer, J le vit très mal, et cela « met fin à son évolution ». On note donc en fait peu d’amélioration concrète en deux ans de thérapie, ce qui n’amène nullement l’équipe à remettre en question la pertinence de celle-ci, préférant rejeter la faute sur la séparation des parents.
Le suivi est interrompu puis l’enfant revient à 16 ans, sa mère se posant des questions pour son orientation scolaire et demandant de l’aide. Il est noté que « mère et fils insistent sur l’inefficacité du précédent suivi », « Madame souligne ses relations conflictuelles avec la consultante » -évidemment, si on lui a fait sentir qu’on pensait qu’elle avait rendu son fils fou, cela n’a pas dû aider. D’ailleurs la mère n’a pas de « demande de soin » pour son fils, et elle-même comme son fils refusent de revoir les « soignants qui les ont reçus par le passé ».
Cette fois-ci, on propose un test de quotient intellectuel (le WISC-IV) ainsi qu’un bilan orthophonique. Mais tout d’abord on cherche à prendre J « par le bout du symptôme » car pour cette équipe, « notre travail consiste à solliciter le sujet par-delà le trouble qui l’amène »… On commence donc par des « consultations espacées » avec un médecin et un psychologue, afin (en résumé) « d’aider la mère à céder quelque chose de sa toute-puissance ». Tout de même, quelque temps après, une rééducation orthophonique est mise en place pour travailler sur les « difficultés massives » de J en lecture – à 16 ans, il est grand temps en effet de s’en occuper.
Quelques années plus tard, à 19 ans ( !), un « travail thérapeutique à médiation logico-mathématique » est mis en place. On note que « alors qu’il refuse une prise en charge psychothérapique traditionnelle, J accepte sans difficulté la remédiation ». Apparemment ces séances lui permettent de progresser dans ce domaine. Mais là encore, ce type de prise en charge aurait pu être proposé beaucoup plus tôt, dès les premières consultations, à 8 ans et non à 19 ans !
A l’issue de ces longues années de suivi institutionnel par une équipe manifestement d’inspiration psychanalytique lacanienne, quels ont été les progrès de cet enfant dont les progrès ont été dépistés très tôt, dès la maternelle ? « J est entré dans la lecture » et « a trouvé un moyen de s’inscrire dans les apprentissages ». Mais le principal pour cette équipe est que « (leur) travail aura consisté à désigner une place – initialement vide – au sujet, tout en le recevant là où il était possible pour lui de s’inscrire, c’est-à-dire étayé sur le discours maternel, dans l’idée qu’un dégagement s’opère ». Comprenne qui pourra. Concrètement, J va passer un BEP et reste sur son idée à terme d’intégrer l’armée.
Alors que retenir de tout cela ? Il est évidemment impossible de faire un diagnostic de J à la seule lecture d’un tel texte, et il est toujours facile de critiquer a posteriori le travail des autres. Néanmoins, le cas de J nous interpelle parce qu’il évoque assez fortement des traits typiques d’un trouble tel que le syndrome d’Asperger.
La première chose qu’il aurait été intéressant de proposer à J aurait été de le bilanter au centre diagnostic d’autisme du même hôpital, à son arrivée dans ce service, à 8 ans. S’il s’était agi d’un syndrome d’Asperger, la prise en charge proposée aurait pu être adaptée en fonction des pratiques internationalement reconnues, et que la HAS recommande depuis 2012 : de l’orthophonie intensive avec un gros travail sur la pragmatique du langage, et par exemple des thérapies cognitivo-comportementales axées sur l’apprentissage des habiletés sociales.
Une rééducation psychomotrice aurait aussi pu être mise ne place pour mieux gérer l’hyperactivité. De plus, si le trouble de déficit d’attention associé avait été confirmé, un traitement médicamenteux spécifique aurait pu être proposé, pour faciliter les apprentissages notamment à l’école.
Tout ceci était, il est vrai, peu répandu il y a 10 ans, mais l’histoire se passe à Paris, et il y aurait été plus facile qu’ailleurs de trouver ce type de prise en charge. Il est regrettable de voir que tous les éléments cliniques sont fort bien décrits dans l’article, ce qui est à mettre au crédit du clinicien concerné, mais que malgré ces éléments très clairs, on préfère chercher « par-delà le symptôme » d’hypothétiques causes psychiques (qu’on reproche à la mère et dans une moindre mesure au père), alors qu’il aurait été possible dès le départ de proposer des rééducations et peut-être un traitement médicamenteux adaptés aux difficultés de J.
Cette démarche reste caractéristique de la psychanalyse d’inspiration lacanienne qui est très répandue, et revendiquée, chez encore beaucoup de psychiatres et de psychologues travaillant dans les institutions françaises. Elle est fortement contestée voire rejetée en bloc par maintenant la plupart des associations de familles d’enfants autistes. Ces associations demandent depuis des décennies l’utilisation des méthodes éducatives précoces et intensives utilisées dès avant 3 ans dans la plupart des pays (ABA, TEACCH, PECS) et recommandées maintenant par la HAS. Ces méthodes ont pour but de travailler les déficits de l’enfant en s’appuyant sur ses compétences déjà acquises et sur ses goûts et aspirations propres, en prenant avantage de la plasticité cérébrale permettant de maximiser les progrès en débutant le plus tôt possible. Ce sont ces méthodes qui sont développées en ce moment dans le cadre du 3è plan autisme – et rejetées par les professionnels d’inspiration lacanienne.
Quand nous lisons l’histoire de J, nous en gardons un goût amer. Les progrès accomplis semblent bien modestes. Tant d’autres choses auraient pu être tentées pour faire progresser cet enfant…
On ne peut s’empêcher de faire des suppositions : et si sa mère était allée deux bâtiments plus loin ? Et si on avait tenu compte de leur insatisfaction sur la thérapie proposée ? Et si cet enfant était « tout simplement » atteint du syndrome d’Asperger ? Dans ce dernier cas, la thérapie imposée, contre l’avis de la famille, par le « grand hôpital » parisien, ne constituerait-elle pas une grave perte de chance pour ce jeune ?
11 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









