L’art d’enseigner (bon sens ne saurait mentir !)
« L’art de fortifier ne consiste pas dans les règles et les systèmes, mais uniquement dans le bon sens et l’expérience. »
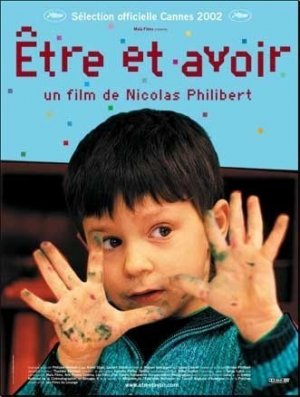
L’homme qui a écrit cette phrase, un certain Vauban*, savait de quoi il parlait, et nombre de ses œuvres, des marches flamandes à celles de l’Italie, subsistent encore de nos jours pour témoigner de ce que fut son génie de bâtisseur militaire.
Un tel langage peut paraître surprenant sous la plume d’un ingénieur qui, avant d’être un bâtisseur, fut surtout un concepteur, un théoricien. Un technocrate dirions-nous aujourd’hui. Et pourtant ce langage est le fruit d’une analyse objective qui, très vite, a conduit Vauban à subordonner le concept à la finalité. Puisant dans l’observation et le bon sens, le technocrate s’est effacé derrière le pragmatique pour réaliser l’œuvre que l’on connaît et s’imposer comme la référence en matière de fortifications militaires.
Quel rapport avec l’enseignement ? Aucun, a priori. Et pourtant, à bien y regarder, enseigner c’est aussi construire, pierre après pierre, pan après pan, un monument de connaissances, un rempart contre l’ignorance et l’obscurantisme. C’est aussi contribuer à l’édification, bastion après bastion, redoute après redoute, d’une citadelle de compétences nouvelles, de nouveaux savoir-faire. C’est enfin consolider les acquis, autrement dit les fortifier.
Le rapport avec l’enseignement est donc beaucoup plus étroit qu’il n’y paraît de prime abord, et l’on peut sans difficulté transposer l’affirmation de Vauban à ce domaine :
« L’art d’enseigner ne consiste pas dans les règles et les systèmes, mais essentiellement dans le bon sens et l’expérience. »
Seule modification par rapport au texte original : le remplacement du mot uniquement par l’adverbe essentiellement, plus nuancé mais aussi plus réaliste, l’usage d’un cadre réglementaire apparaissant, quoi qu’on en pense, indispensable, ne serait-ce que pour baliser les premiers pas des nouveaux entrants dans le métier. Aux acteurs de l’enseignement, à tous les niveaux, de faire en sorte que ce cadre réglementaire n’agisse pas de manière dictatoriale, au risque de faire avorter les initiatives orientées, ici et là, vers une efficacité accrue sur le terrain.
En définitive, et sans vouloir nier le rôle, ô combien irremplaçable, de l’expérience, le maître-mot de cette citation me semble être « bon sens ». Hélas ! il est à craindre ─ n’en déplaise à Descartes et à son fameux Discours ─ que celui-ci ne soit pas « la chose la mieux partagée du monde ». Le sociologue Gustave Le Bon prétend même que « beaucoup d’hommes sont doués de raison, très peu de bon sens. » Lequel pense juste ? Probablement les deux. Simplement, le bon sens sommeille chez la plupart d’entre nous, enseignants ou pas, et ne vient éclairer nos actions que de manière épisodique ou en brillant d’un éclat trop faible pour modifier nos comportements technocratiques ou purement routiniers. Il importe donc de le réveiller et de lui rendre l’importance qui lui revient. Ne serait-ce que pour donner tort à Bernard Grasset qui, dans ses Remarques sur l’action, n’hésite pas à affirmer que « la solution de bon sens est la dernière à laquelle pensent les spécialistes. »
L’éditeur se montre en l’occurrence bien sévère. Non sans raisons, il faut bien en convenir. Quoi qu’il en soit, et quel que soit notre domaine d’activité, ne soyons pas de ces spécialistes-là. Mais, de la nécessité d’éviter cet écueil, il va de soi que nous sommes déjà tous convaincus. Simple question de… bon sens !
* A propos de Vauban, j’encourage ceux qui ne l’ont pas fait à lire l’article de Manuel Atreide paru en juillet 2008 sur AgoraVox en cliquant sur le lien suivant : Fortifications Vauban : interview du directeur du musée des Plans Reliefs | AgoraVox
9 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









