L’éthique individuelle : un bien d’utilité publique ?
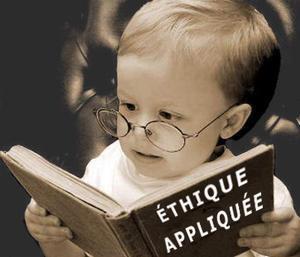
En des temps où l’éthique a plutôt tendance à servir de « moraline » pour soulager la conscience des décideurs de tout poil, une fondation reconnue d’utilité publique a réussi à faire entendre aux plus hautes instances de l’Etat un message simple : il est urgent de travailler collectivement au développement de la conscience éthique individuelle.
La Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine a récemment célébré ses dix ans d’existence. Cet événement doit retenir notre attention. Avec le recul, et pour avoir suivi un certain nombre d’activités de la Fondation ces dernières années, l’originalité de cette institution m’apparaît plus nettement, en même temps que son absolue singularité dans le paysage contemporain. En des temps où l’éthique, quand elle ne se confond pas purement et simplement avec une langue de bois édifiante, a plutôt tendance à servir de « moraline » pour soulager la conscience des décideurs de tout poil, amateurs de chartes et de comités consultatifs, cette fondation reconnue d’utilité publique a réussi à faire entendre aux plus hautes instances de l’Etat, mais aussi et de plus en plus, auprès d’un public large et motivé, une chose à la fois évidente et décisive : le développement de la conscience éthique est, pour chacun, un enjeu pratique.
J’insiste sur ces deux termes : « conscience » (individuelle) et « pratique » (individuelle). C’est là, dans la reconnaissance publique des enjeux concrets de l’éthique individuelle, que réside tout l’intérêt de l’entreprise, et c’est ce que fait bien voir un petit film de présentation réalisé par la Fondation :
Il est question de la recherche en éthique, de son enseignement et de sa diffusion. Mais il ne s’agit pas, une fois de plus, de réfléchir en termes généraux à de nouvelles normes d’action collective, pas plus qu’il ne s’agit d’examiner les théories éthiques existantes d’un point de vue strictement philosophique ou universitaire (ce qui est sans doute nécessaire par ailleurs). La Fondation se propose d’aller « au fond des choses » : chacune de ses activités – des guides pratiques publiés dans la collection « Ethique au quotidien » à L’Harmattan, aux journées de la solidarité humaine qui ont lieu chaque année autour du 11 septembre – apparaît en ce sens comme un « module de sensibilisation à l’éthique ». C’est de l’agit-prop éthique, si l’on veut, mais doublée d’une véritable ambition de recherche collaborative, qui touche aux racines humaines (anthropologiques, psychologiques, morales, spirituelles) du problème. Quel est ce problème, et pourquoi nous concerne-t-il tous ? On peut le formuler très simplement : l’humanité est éthiquement – et pas seulement politiquement, économiquement, socialement – « dysfonctionnelle », comme diraient les Américains.
S’il est bien question de « pratique », on comprend par ailleurs qu’il ne s’agit pas de relayer simplement des initiatives charitables, humanitaires ou autres, qui relèvent généralement des formes sociales ou socialisées de l’éthique et de la solidarité. Plus profondément, j’ai le sentiment que, depuis dix ans, cette fondation, avec l’aide de ses différents partenaires et collaborateurs, œuvre à dégager les conditions d’une prise de conscience individuelle du caractère réellement vital de l’éthique. Bahram Elahi, son président, l’affirme sans détour : l’objectif principal de la fondation est d’« inciter les hommes à avoir un comportement éthique, par pure humanité », et ce afin « qu’ils se rapprochent et se tolèrent mieux [entre eux] ». Ce n’est pas rien ! Et si les notions qui circulent ici et là dans les discours et les présentations (« éthique », « solidarité », « spirituel »), de même que les moyens mis en œuvre (colloques, séminaires, enquêtes, entretiens, publications, bourses et prix) n’ont rien de particulièrement révolutionnaire en soi, l’orientation générale me paraît, quant à elle, absolument nouvelle.
Dans le contexte houleux des débats sur la laïcité, n’y a-t-il pas quelque chose de réjouissant, en tout cas de rafraîchissant, à voir un ancien responsable des fondations au Ministère de l’intérieur, un conseiller d’Etat, ou encore un professeur émérite de philosophie à la Sorbonne, évoquer avec enthousiasme le projet d’une fondation portant le nom d’« un magistrat » qui fut aussi « un philosophe », « un penseur, un sage », « une grande figure du spirituel » – et qui plus est iranien ! Les interlocuteurs officiels, ceux qui ont eu, à l’époque, la responsabilité d’évaluer le dossier de la Fondation pour lui accorder la reconnaissance d’utilité publique, sont unanimes à reconnaître qu’il y a là quelque chose d’inhabituel et de particulièrement stimulant. Comme le dit le conseiller d’Etat Marcel Pochard, placer au cœur des questions l’enjeu de la « compréhension entre les êtres à leur niveau spirituel », « c’était une approche très nouvelle ». C’est le moins qu’on puisse dire, et c’est précisément là ce qui faisait, selon lui, « son très grand attrait pour le Conseil d’Etat »… Le philosophe émérite parle quant à lui d’un « spiritualisme concret », « incarné dans notre époque », et encore – dans la langue de Hegel qu’il maîtrise comme nul autre – d’« une éthique qui se réfléchit et qui s’adresse en sa réflexion à tous ».
Il faut dire que, contrairement à d’autres initiatives qui pourraient sembler partager la même vocation, la démarche de cette fondation est délibérément non dogmatique et déliée de toute attache confessionnelle particulière. Dans le discours prononcé à l’occasion de la cérémonie du dixième anniversaire, Bahram Elahi évoque « une éthique universelle, praticable par tous, quelles que soient leurs croyances et leur origine » :
Je recommande à ceux qui voudraient voir à quoi correspond, concrètement, une telle démarche, un petit tour sur le site de la Fondation, à la rubrique « L’Ethique, parlons-en ! ». Ils y trouveront une vingtaine d’entretiens vidéo sur des thèmes aussi divers que la dignité, la maîtrise de soi, la gratitude, la persévérance, la motivation, la vie de couple ou le rapport à la mort. Des personnalités issues de différents domaines, de Claudie Haigneré à Bernard Stiegler en passant par Guy Bedos ou Anne Roumanoff, y sont invités à s’exprimer en leur nom, en sondant leur expérience personnelle, sur la signification et l’importance qu’ils accordent à un terme (« éthique ») qui, reconnaissons-le, est de plus en plus galvaudé. Une brochure en retranscrit quelques morceaux choisis. Elle s’ouvre (« A comme Action ») sur cette parole forte du philosophe Ali Benmakhlouf : « On pense toujours qu’il faut faire le bien mais, parfois, il faut simplement éviter quelque chose qui perturbe ». Voilà déjà un beau programme de recherche en éthique : comprendre ce que signifie, en chacun et pour chacun, « ce qui perturbe ». N’est-ce pas justement sur cette prémisse que s’est développé le projet d’Ostad Elahi, celui d’une éthique qui serait une « médecine de l’âme » ?
La diversité des voix représentées par les vignettes vidéo et les entretiens manifeste aussi ceci : s’il est urgent de réfléchir collectivement aux enjeux individuels de l’éthique, aucun discours d’autorité, aucune idéologie constituée ne peut se substituer à une réflexion et un engagement personnels. Comme le dit justement Bernard Stiegler dans l’un de ces entretiens : « L’être éthique est un être absolument singulier. Personne ne peut lui donner sa loi. Il est toujours, à un moment donné, confronté à une situation où il n’y a pas de règle. Il faut qu’il se débrouille, il faut qu’il invente ». Voilà ce qu’on peut espérer de la Fondation Ostad Elahi : qu’elle nous aide à trouver un peu de courage, et surtout de nouvelles idées, pour inventer.
Crédit image : La convergence éthique
26 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








 Vous remarquez qu’il n’y a pas de paradis et d’enfer. Qu’il y a une notion de karma. Qu’il n’y a pas d’involution dans l’évolution. Quoique chacun fasse, un jour il arrivera à la vérité. C’est la vitesse de ce voyage qui diffère entre les personnes mais à l’échelle de l’éternité, le temps ne diffère que d’un clin d’oeil. J’ai laissé de côté la philosophie métaphysique de mon ancienne communauté de pensée en découvrant le gnosticisme et en découvrant bien des élèments de la grâce des gnostiques, mélangés à l’islam et à l’hindouisme. Ce qui est normal vue la chronologie des évènements, la fuite des gnostiques vers l’orient, l’apparition de l’islam et la proximité géographique de l’iran avec l’inde, qui en fait un melting pot d’idées et donc de religions.
Vous remarquez qu’il n’y a pas de paradis et d’enfer. Qu’il y a une notion de karma. Qu’il n’y a pas d’involution dans l’évolution. Quoique chacun fasse, un jour il arrivera à la vérité. C’est la vitesse de ce voyage qui diffère entre les personnes mais à l’échelle de l’éternité, le temps ne diffère que d’un clin d’oeil. J’ai laissé de côté la philosophie métaphysique de mon ancienne communauté de pensée en découvrant le gnosticisme et en découvrant bien des élèments de la grâce des gnostiques, mélangés à l’islam et à l’hindouisme. Ce qui est normal vue la chronologie des évènements, la fuite des gnostiques vers l’orient, l’apparition de l’islam et la proximité géographique de l’iran avec l’inde, qui en fait un melting pot d’idées et donc de religions. )
)
 , le corps et les désirs changeant dans le temps, on peut espérer que les motivations changent).
, le corps et les désirs changeant dans le temps, on peut espérer que les motivations changent).
