La parité bien comprise selon Caroline Eliacheff
Caroline Eliacheff a une rubrique sur France-Culture : « les idées claires de Caroline Eliacheff ». En matière de parité, ses idées sont très claires : géométrie variable pour la parité. Les pères qui réclament la garde alternée sont minoritaires, Eliacheff discrédite les pères comme si en démocratie les minoritaires avaient tort et les majoritaires raison. En revanche, elle crédite les mères qui sont contre, elles ne sont pas qualifiées, ni de majoritaires, ni de minoritaires, (sont-elles majoritaires ? On n'en saura rien, elles sont peut-être autant minoritaires que les pères). Les mères sont droites, pures, justes, on peut les croire sans les mettre en questions, ni même les commenter. Les mères ont les idées claires, comme Caroline Eliacheff. http://www.franceculture.fr/emission-les-idees-claires-de-caroline-eliacheff-au-nom-de-la-parite-2013-11-13
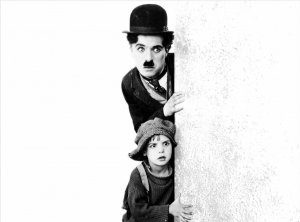
Caroline Eliacheff, ce jour-là, s'est lâchée, sans s'en rendre compte, sur le point nodal de cette question de la parité des femmes et des hommes, sur le tabou par excellence. Le tabou est l'élément obscène, obscène au sens propre : hors de scène, dont on ne parle pas, dont on ne peut parler et qui structure l'ensemble, qui lui donne force et consistance. Je suis un observateur assez attentif des discours sur les relations entre les femmes et les hommes et c'est la première fois que j'entends quelqu'un s'exprimer sur ce tabou, même si c'est par mégarde, par inadvertance ou par ignorance, par hasard, au détour d'une communication pleine de fougue et de foi. Caroline Eliacheff est une femme qui a sûrement et de bonne foi l'impression d'être féministe. D'ordinaire, les discours proclamés féministes contournent soigneusement la question, et se posent sur des secteurs bien balisés : la date (tardive) du droit de vote des femmes, les salaires, la (faible) participation aux instances dirigeantes...
La parité est une demande d'égalité entre les hommes et les femmes. Cette demande concerne les secteurs balisés et évitent tous les autres. Or, une bonne analyse prend en compte toute la réalité. Pour choisir dans la réalité ce qui est signifiant et ce qui ne l'est pas ou moins, il faut disposer d'une « théorie ».
Tout d'abord, personne, aucune féministe, au sens du féminisme instituée, ne demande la parité à l'Education nationale, tandis que ces mêmes « féministes » considèrent que l'inégalité entre les hommes et les femmes est créée intégralement par l'Education et donc soluble dans l'éducation, pourtant pratiquée à une écrasante majorité par des femmes. Comment est-ce possible ? Elles créent donc leur malheur ? Ce sont donc elles, les femmes, qui transmettent la domination masculine ? Que faire ?
Ensuite, les « féministes » ne demandent pas la parité dans les tâches ingrates et sans pouvoir comme le bâtiment, le ramassage des poubelles... etc. qu'elles laissent aux « hommes dominants ». Elles ne demandent pas qu'il y ait autant de plombières que de plombiers. Cette demande de parité ainsi formulée a des trous énormes, et même, a nettement plus de trous que de matière.
Ce sont les deux apories principales de cette soi-disant demande de parité : des secteurs bien choisis et l'oubli volontaire du domaine de l'éducation, pourtant censé tout contenir et déjà surinvesti par les femmes. Ces apories sont contournées, oubliées, écartées, niées... Tout sauf en parler.
Caroline Eliacheff a abordé un troisième point généralement tu, prétendant ainsi mieux comprendre la parité que les autres. La parité est un principe, donc une idée, antérieure à tout examen de toute situation mais elle est soumise, selon Caroline Eliacheff, à des différences selon les cas (les situations). Bien la comprendre signifie lui garder son caractère général de principe et, en même temps, en faire une application variable. Le caractère général est dans les secteurs déjà cités où le « féminisme » se sent fort et la variabilité dans les autres.
Il y a donc une situation (la petite enfance) qui courbe la volonté de parité, qui l'infléchit, la colore... enfin bref, ce n'est plus la même et ceux qui ne l'ont pas compris exagèrent ou le font exprès. Ils n'ont pas compris nous dit Eliacheff.
La psychologie occidentale commune, ordinaire, instituée a fait credo que la mère et l'enfant étaient fusionnels par nature, (dans tous les cas, de tous les temps, quelle que soit la gestion du temps postnatale des humains, quel que soit l'organisation de la famille... aucune exception). La femme et l'enfant sont fusionnels soi-disant pendant la grossesse et ils le restent après l'accouchement. La psychologie instituée assigne à la femme (et à l'homme) de se conformer à ce modèle impératif « appartenant au réel ». Comme les enfants sont les enfants des hommes aussi, la psychologie institutionnelle assigne à l'homme la tâche de casser cette fusion et de donner à l'enfant l'indépendance, la liberté, et au fond, l'accès au monde extérieur, dont sa mère le priverait sans cette intervention bénéfique.
Evidemment, les nobles, les bourgeoises trouvaient indignes de leur condition de s'occuper des enfants et laissaient ce soin aux nourrices et gouvernantes... L'Œdipe africain est multiple, divers et varié... les familles dites monoparentales (la plupart du temps mère et enfant) ne peuvent pas fonctionner comme cela et les tenants de la psychologie instituée n'en font aucune analyse et, au contraire, détournent le regard là aussi, séparant le cas général soi-disant impératif et des millions d'exemples du contraire « conjoncturels ».
C'est vraiment donner caution scientifique à des « genres » extrêmement codifiés, c'est-à-dire à une codification des comportements sociaux contraignants en les naturalisant par un lien stricte et serré au sexe.
Comment concilier cette psychologie ainsi bâtie et qui prétend se bâtir par l'observation du réel, et la théorie du genre, qui se pose alternativement comme un questionnement sur le genre et la déclaration de principe qu'il n'y a pas de genre légitime, que tout genre est bâti arbitrairement.
Caroline Eliacheff a bien compris la parité bien comprise : c'est une question de temps. Quand l'enfant est petit, c'est la psychologie qui s'applique et quand il devient grand, c'est la parité qui s'applique.
Les femmes travailleraient peu ou pas du tout quand leurs enfants seront petits et les instances dirigeantes de la société seraient dans l’obligation de leur accorder la parité avec des hommes qui auront fait le boulot pendant ce temps, qui auront développé leur savoir-faire, leurs contacts, leur expérience des diverses situations professionnelles... etc. et à qui on ne peut pas le reprocher puisque c'est la nature qui veut ça.
Il est grand temps de quitter ce terrain idéologique illogique irrationnel qui préside à tous les discours sur les relations entre les femmes et les hommes et de le prendre dans le respect des faits et gestes, des paroles, des comportements, des attitudes des humains des deux sexes. Il est grand temps de faire l'analyse du réel, de ce qui ne dépend pas de nous et du symbolique, de ce qui dépende de nous.
Madame Eliacheff, il n'y a pas de parité bien comprise que vous devriez nous enseigner, parce que vous vous en sentez propriétaire avec les mères et contre les pères ; vous n'êtes pas scientifique en ce domaine, vous êtes comme une algue sur la vague : vous donnez caution scientifique à des points de vue idéologiques dont le travail dans la société est immensément négatif.
7 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










