Monnaie, monnaie ! Capitalisme ou Socialisme ?
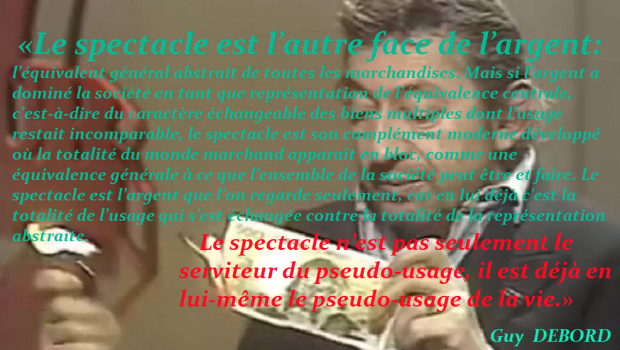
« Notre société est fondamentalement absurde et profondément injuste à cause d’un système monétaire qui est, de fait, une énorme supercherie. » C’est ce que nous dit Marc Jutier en présentation de son fort intéressant livre sur le sujet : « La monnaie pour les nuls », sur le blog VLR (*). Que le système monétaire actuel repose sur une escroquerie à grande échelle, on n’en doute pas, mais est-ce bien la cause fondamentale des maux que nous inflige le capitalisme ? Il réduit à très peu l’indépendance des nations et des États, nous explique-t-il, ce qui parait être une évidence à l’heure de la « mondialisation », mais est-ce là encore le bon fil de la réflexion ? Prenons le déjà par ce bout…
Il est évident qu’un état ne peut être indépendant que s’il contrôle complètement sa propre monnaie. Même si ce n’est pas non plus le seul critère d’indépendance, tout aussi évidemment.
Le contrôle de la création monétaire implique de contrôler les banques, c’est à dire, en pratique, de les nationaliser.
Mais cela ne suffit encore pas à déterminer la nature sociale ou non de la politique suivie, des choix de gestion.
Selon une règle économique de base, l’argent en circulation est censé représenter la valeur globale des biens en capacité d’être échangés.
La valeur globale des biens n’est jamais que la valeur du travail socialement nécessaire à leur production et accumulé en eux.
C’est la loi de l’offre et de la demande, ou loi du marché, qui provoque à la fois des déséquilibre et des crises, en permettant également aux capitalistes toutes les manœuvres de spéculation, de dumping, etc…
Ce n’est que très rarement que le marché permet un équilibre réel entre offre et demande, faisant coïncider valeur réelle et prix du marché.
De plus, sous le capitalisme, cela ne correspond qu’à un équilibre entre production et demande solvable, c’est à dire de la part de ceux qui ont les moyens financiers, indépendamment de leurs besoins sociaux réel, et sans rapport avec la mesure de leurs besoins vitaux.
L’équilibre du marché répond d’abord à des besoins solvables et non à des besoins sociaux.
Il n’est qu’un équilibre illusoire, entre deux crises, et qui laisse les plus démunis sur le carreau, quoi qu’il en soit.
Un état indépendant et réellement socialiste doit donc chercher à se libérer de la loi du marché.
C’est à dire faire correspondre, de manière nécessairement planifiée, la production aux besoins sociaux et aux besoins vitaux réels de sa population.
C’est l’élaboration démocratique du plan, avec la participation de tous, qui fait la différence entre socialisme réel, démocratique prolétarien, et pouvoir bureaucratique, régénérateur de capitalisme.
Avec les moyens modernes de communication et d’échange, à l’ère de l’internet, une élaboration interactive et démocratique du plan, faisant correspondre besoins sociaux et production, c’est devenu tout à fait possible.
La méthode simple d’échange que Marx proposait par les « bons de travail » dans la Critique du Programme de Gotha est aujourd’hui devenu possible à grande échelle, si l’on considère que ce « bon de travail » était la définition même d’une monnaie socialiste alternative indépendante du système capitaliste.
Pour un état réellement socialiste et indépendant, cela implique donc également le contrôle du commerce extérieur, selon la règle qui veut que l’argent en circulation soit censé représenter la valeur globale des biens en capacité d’être échangés.
La part et la nature des imports-exports doivent donc aussi être déterminées démocratiquement lors de l’établissement du plan, avec les secteurs économiques concernés.
Elle doit nécessairement être compatible avec l’équilibre budgétaire global.
Pas de libre échangisme international débridé, pas de mondialisation imposant la dictature d’un système : le capitalisme/impérialisme.
Par la suite s'imposeront des négociations bilatérales financièrement équilibrées entre états souverains, même si de natures sociales par forcément homogènes. Retour à la Charte de la Havane (1948)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_de_La_Havane
Tout ça n'est pas si compliqué, en fin de compte, même si résumé au plus court, ici.
Pour mieux comprendre, voici ce que Marx proposait, dans la Critique du Programme de Gotha, comme principe d’échange économique, pour la période de transition :
» Ce à quoi nous avons affaire ici, c’est à une société communiste non pas telle qu’elle s’est développée sur les bases qui lui sont propres, mais au contraire, telle qu’elle vient de sortir de la société capitaliste ; une société par conséquent, qui, sous tous les rapports, économique, moral, intellectuel, porte encore les stigmates de l’ancienne société des flancs de laquelle elle est issue . Le producteur reçoit donc individuellement – les défalcations une fois faites – l’équivalent exact de ce qu’il a donné à la société. Ce qu’il lui a donné, c’est son quantum individuel de travail. Par exemple, la journée sociale de travail représente la somme des heures de travail individuel ; le temps de travail individuel de chaque producteur est la portion qu’il a fournie de la journée sociale de travail, la part qu’il y a prise. Il reçoit de la société un bon constatant qu’il a fourni tant de travail (défalcation faite du travail effectué pour les fonds collectifs) et, avec ce bon, il retire des stocks sociaux d’objets de consommation autant que coûte une quantité égale de son travail. Le même quantum de travail qu’il a fourni à la société sous une forme, il le reçoit d’elle, en retour, sous une autre forme .
C’est manifestement ici le même principe que celui qui règle l’échange des marchandises pour autant qu’il est échange de valeurs égales. Le fond et la forme diffèrent parce que, les conditions étant différentes, nul ne peut rien fournir d’autre que son travail et que, par ailleurs, rien ne peut entrer dans la propriété de l’individu que des objets de consommation individuelle. Mais pour ce qui est du partage de ces objets entre producteurs pris individuellement, le principe directeur est le même que pour l’échange de marchandises équivalentes : une même quantité de travail sous une forme s’échange contre une même quantité de travail sous une autre forme.
Le droit égal est donc toujours ici, dans son principe… le droit bourgeois, bien que principe et pratique ne s’y prennent plus aux cheveux, tandis que l’échange d’équivalents n’existe pour les marchandises qu’en moyenne et non dans le cas individuel.
En dépit de ce progrès, le droit égal reste toujours grevé d’une limite bourgeoise. Le droit du producteur est proportionnel au travail qu’il a fourni ; l’égalité consiste ici dans l’emploi du travail comme unité de mesure commune. »
Pour comprendre en quoi ce système d'échange constitue néanmoins une rupture d'avec le capitalisme, il faut que l'on se remémore quelques aspects fondamentaux de la loi de la valeur. La notion de valeur est liée à la notion de quantité moyenne (Quantum) de travail socialement nécessaire à la production d’un bien ou d’un service.
Elle est d’abord liée à la valeur d’usage, même si elle n’est pas strictement déterminée par elle, et non pas au prix de marché.
En effet, l’échange commercial ne se produit jamais que pour des biens et services ayant une utilité sociale, une valeur d’usage (hors œuvres d’art et collections).
Le cas d’un service aux personnes dépendantes est exemplaire au sens où il est le plus souvent invendable à son coût de production sur le marché libre. Il a besoin, la plupart du temps, de subventions publiques pour être effectué, alors même qu’il répond à un besoin social et qu’il a donc une valeur d’usage évidente, à la base, au moment de sa conception comme service, à priori invendable.
Dans le système capitaliste les biens et services sont évidemment d’abord conçus pour rencontrer un besoin solvable, mais ils contiennent, dès leur production, un Quantum de travail socialement nécessaire,voire même dès leur conception, celle ci incluant généralement la conception du processus de production adapté, et cela indépendamment du fait qu’ils rencontrent ou non preneur sur le marché, en fin de compte, en fonction des aléas de celui-ci.
C’est pourquoi la conception marxiste de l’économie de transition est incompatible avec la conception trotskyste, que ce soit celle du « Programme de Transition » ou celle définie également par Trotsky lui-même, en 1939, dans son exposé de base prétendant résumer les principes du « marxisme », relus à sa manière :
« En acceptant ou en rejetant les marchandises, le marché, arène de l’échange, décide si elles contiennent ou ne contiennent pas de travail socialement nécessaire, détermine ainsi les quantités des différentes espèces de marchandises nécessaires à la société, et, par conséquent, aussi la distribution de la force de travail entre les différentes branches de la production. »
https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1939/04/lt19390418b.htm
On ne peut plus clairement se mettre à la remorque du marché ni carrément affirmer plus péremptoirement que le plan doit être établi en fonction du marché et non des besoins sociaux réels !!!
On ne peut réviser plus grossièrement les fondamentaux les plus basiques du marxisme !!!
Vue sous cet angle, avec l’aide d’un exemple concret, l’impasse que représente le trotskysme est encore plus évidente que dans l’approche théorique qui s’est dégagée du débat avec le camarade Viriato :
https://tribunemlreypa.wordpress.com/2017/12/04/le-bloc-et-la-faille/
Néanmoins, constater que le trotskysme est disqualifié pour prétendre au renouveau d’un marxisme révolutionnaire n’est qu’une étape parmi d’autres et non pas une fin en soi.
Nous avions déjà pu faire le même constat en faisant l’étude et le bilan du maoïsme, en éclaircissant les ambiguïtés apparentes de la très nébuleuse « Wertkritik », tout comme celles des théories de Boukharine et Preobrajensky, plus marquées par leur époque, mais dont il importait aussi de faire le bilan historique.
Ce que la confrontation du trotskysme avec les problèmes économiques de la période de transition met particulièrement en lumière, c’est l’articulation dialectique des deux lois incontournables qui gouvernent encore actuellement l’économie capitaliste, celle du marché et celle de la valeur, et comment la soumission à la loi du marché mène inévitablement à la soumission au capitalisme et à son rétablissement, au cours de la période de « transition », qui cesse ainsi d’être une voie ouverte vers le communisme.
Alors que le fait de s’en libérer permet de maitriser la survivance provisoirement nécessaire de la loi de la valeur, en maitrisant l’équilibre économique en valeur-travail, afin de subvenir aux besoins sociaux réels, sur la base d’un nouveau mode de répartition et d’échange, où, selon la formule de Marx :
« une même quantité de travail sous une forme s’échange contre une même quantité de travail sous une autre forme. »
Luniterre
Liens utiles :
https://tribunemlreypa.wordpress.com/2017/12/11/monnaie-monnaie-capitalisme-ou-socialisme/
https://tribunemlreypa.wordpress.com/2017/12/04/le-bloc-et-la-faille/
https://tribunemlreypa.wordpress.com/2017-pour-sortir-de-limpasse-la-revolution-du-retour-au-reel/
(* http://mai68.org/spip2/spip.php?article1029 )
*********************************
« ♦ 49 ♦ Le spectacle est l’autre face de l’argent : l’équivalent général abstrait de toutes les marchandises. Mais si l’argent a dominé la société en tant que représentation de l’équivalence centrale, c’est-à-dire du caractère échangeable des biens multiples dont l’usage restait incomparable, le spectacle est son complément moderne développé où la totalité du monde marchand apparaît en bloc, comme une équivalence générale à ce que l’ensemble de la société peut être et faire. Le spectacle est l’argent que l’on regarde seulement, car en lui déjà c’est la totalité de l’usage qui s’est échangée contre la totalité de la représentation abstraite. Le spectacle n’est pas seulement le serviteur du pseudo-usage, il est déjà en lui-même le pseudo-usage de la vie. »
(Guy DEBORD)
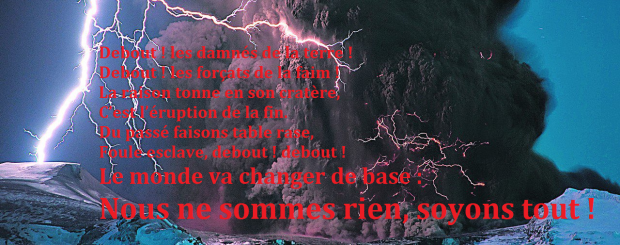
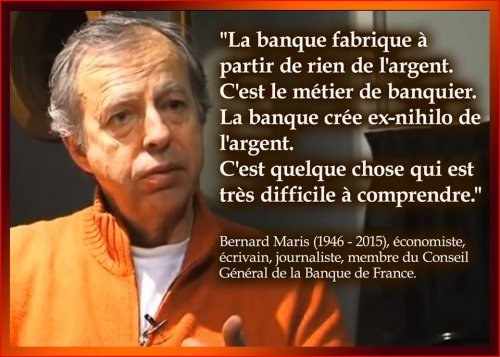
8 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










