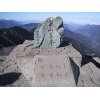Tchétchénie : paix et spectaculaire développement
Il y a quelques années, au milieu des années 1990, le nom « Tchétchénie » accompagnait souvent les informations internationales dans de nombreux pays, dont la France. On y voyait la capitale, Grozny, en ruines et des images de combats acharnés entre troupes russes et insurgés tchétchènes, présentés comme des islamistes fanatiques. Puis, curieusement, depuis quelques années, la Tchétchénie a disparu subitement des actualités.
Une bonne raison pour y revenir en cette fin 2007 car il y a du nouveau, et du nouveau très instructif, en Tchétchénie...
La paix de retour en Tchétchénie : un événement majeur passé sous silence
Rappelons-nous : en 1995, les reportages tournés dans cette ville détruite faisaient penser à Stalingrad en février 1943 ou Berlin en mai 1945 : des montagnes de ruines et une population exsangue, désespérée. Le pays lui-même était ravagé, son agriculture anéantie, son industrie liquidée.
Ceci était le résultat d’un long conflit entre, d’un côté des rebelles tchétchènes, rassemblés autour de chefs de guerre locaux et souvent présentés comme des partisans d’un Etat islamiste, de l’autre, les troupes russes envoyées par Moscou.
Sous l’ère Eltsine, les troupes russes, mal équipées, sous-ravitaillées, souvent démoralisées par le contexte de leur action et la situation difficile que vivaient en Russie leurs familles, subissent pertes et revers, sans parler d’une corruption endémique. L’image qui venait à l’esprit était que l’armée russe s’enfonçait dans un nouveau conflit de type afghan qu’elle ne pouvait gagner.
Quand Poutine accède au pouvoir en 2000, les choses changent rapidement après avoir assuré son autorité sur l’Etat et sur les « oligarques » : envoi de troupes d’élite, réflexion tactique et stratégique approfondie, action politique étayée et relayée par l’action militaire, ravitaillement amélioré et définition d’une ligne de conduite qui se résume en deux principes : utilisation combinée de tous les moyens de destruction disponibles contre l’adversaire et position permanente de main tendue et de pardon assuré à ceux qui veulent faire la paix.
Certes, certaines phrases de Poutine, célèbres sur le plan médiatique, ont exprimé crûment cette stratégie globale. De fait, violence maximale il y a eu, mais résultat politique indéniable il y a aussi à l’arrivée.
Aujourd’hui, les soldats russes de Poutine et leurs alliés tchétchènes, dirigés par le président Ramzan Kadyrov, contrôlent la quasi-totalité du pays et les derniers groupes rebelles, isolés, disloqués, pourchassés, sont sans influence sur les processus en cours de renaissance économique, démographique et politique en Tchétchénie.
La majorité des anciens chefs révoltés ont fait allégeance au régime du président Zadyrov et se sont intégrés, pour s’enrichir au sein du boom économique, dans le société civile. Les menaces d’un Etat islamiste aux frontières méridionales de la Russie sont écartées, et cela avec, les observateurs l’ont aussi noté, la bienveillante passivité du régime islamique de Téhéran. La diplomatie russe a su, à l’évidence, se montrer fort convaincante en Iran.
La guerre en Tchétchénie est donc terminée de
facto. Et cela, dans le Caucase, une région stratégique
vitale, pour les intérêts politiques et économiques
- pétrole et gaz, production et transport - de la Russie.
Une renaissance économique d’une surprenante rapidité
Quiconque a été à Grozny voici dix ans et y revient en cette fin 2007 ne peut en croire ses yeux tant le changement est spectaculaire autant que rapide.
Trois ans après les plus terribles combats et attentats de la guerre, Grozny et sa banlieue sont tous simplement méconnaissables : la ville a été reconstruite avec des moyens et à une vitesse étonnants, la cité a retrouvé sa population, ses magasins, ses activités, son dynamisme. Elle est sous l’emprise d’un essor industriel et commercial étonnant : les chaussées des rues naguère défoncées et parsemées de trous d’obus et de mines sont devenues des voies de circulation modernes qui accueillent une circulation automobile active. Cafés et restaurants récents pullulent, les produits alimentaires et industriels les plus modernes se trouvent un peu partout.
Autour de la ville et dans les autres cités urbaines du pays, une activité intense de construction est notable : immeubles, usines, routes et ponts, le pays renaît de ses décombres.
Les habitants en témoignent et les visiteurs attestent ce qui est le plus marquant de cette renaissance : l’électricité est fournie presque partout 24 heures sur 24, le gaz aussi, les stations d’essence sont aussi bien fournies. Ces informations, ici, font figure de prodiges quotidiens pour les simples citoyens, et ce miracle est attribué par les gens de la rue au président du pays, Ramzan Kadyrov.
Dans les campagnes, le redémarrage économique est moins manifeste, mais aussi sensible. L’agriculture renaît ainsi que l’élévage. Les infrastructures de communication sont reconstruites à grande échelle et vite.
Le visiteur se demande vraiment s’il ne rêve pas et si c’est le même Grozny et la même Tchétchénie que l’on voyait en 1995.
Il convient ici de ne pas s’arrêter sur ces seuls aspects extérieurs, même s’ils sont une partie significative du tableau des faits, mais de regarder aussi sous la réalité des apparences et derrière les événements publics.
Victoire russe dans la modestie, dictature de fait et investissements massifs
A l’évidence, le gouvernement russe joue ici un rôle majeur dans l’intendance économique, mais a su rester sur une note modeste - au moins dans sa communication - en ne clamant pas trop fort son succès politique et militaire en Tchétchénie.
C’est que Poutine a trouvé dans le président Kadyrov un homme qui a su se forger aussi sa place dans l’échiquier politique national, sous son autorité et avec sa complicité.
Ramzan Kadyrov a de facto succédé à son père,
assassiné en mai 2004. Nommé président de la
République par Poutine le 2 mars 2007, Kadyrov ne passe pas
pour un démocrate, bien au contraire. Il lui est reproché
de nombreuses exactions sanglantes : meurtres, viols, vols, affaires
de corruption, etc. Et il est rare d’entendre des citoyens tchétchènes parler en mal, surtout en public et/ou avec des étrangers, du président Kadyrov.
Ceci dit, si le pays est encore au niveau de l’Etat de droit une dictature qui cache bien ses traits et soigne ses apparences externes, Kadyrov semble jouir d’une aura certaine dans la population, lasse de la guerre et de ses souffrances.
Cela paraît tenir au fait que beaucoup de citoyens, qui savent aussi ce qui se dit sur l’homme, ses moeurs et sa violence, le perçoivent simultanèment comme le reconstructeur du pays, son bâtisseur énergique et son « guide » vers la modernité et la prospérité.
Plusieurs commentateurs le comparent sous ces divers aspects à Poutine pour la Russie, à savoir un dirigeant qui ne craint pas d’utiliser tous les moyens qui lui semblent bons et utiles pour atteindre ses buts.
Il a par contre pour les autorités de Moscou et leurs objectifs politiques dans la région des avantages indéniables : il a su ramener la paix dans le pays, même si cela a été fait avec une violence extrême. Il professe un islam de tendance soufiste, très hostile au wahabisme, donc à l’islam intégriste, promeut un nationalisme tchétchène actif tout en étant un partisan déclaré de la Fédération russe.
Il est aussi souvent regardé par des observateurs comme un habile populiste, pragmatique et connaissant ses limites en politique intérieure et étrangère face à Moscou.
Les leçons à tirer de la Tchétchénie
Nul n’ignore que ce gigantesque chantier de construction qu’est la République tchétchène est dû à la vague immense des investissements russes, publics et privés « dirigés ».
Cette renaissance tchétchène est aussi un exemple de la puissance de frappe financière et technologique russe pour un Etat voisin sur lequel Moscou a des vues précises non-dites, mais manifestes : la Géorgie.
Plus généralement, ce qui se passe en Tchétchénie est instructif du renouveau de la Russie et de son dynamisme sur tous les plans dans l’arène mondiale. Mais aussi de son implication croissante dans le Caucase.
Ainsi, les spécialistes en géostratégie internationale, du moins ceux, rares, qui ont suivi le dossier tchétchène, savent que les investissements massifs de la Russie en Tchétchénie ne sont pas faits que par amour des habitants de cette République, mais qu’ils s’inscrivent dans un processus plus vaste qui voit la Russie retrouver, pas à pas, les anciennes frontières internationales de l’ex-URSS d’avant 1991, ceci par des jeux habiles ou interviennent conjointement la force militaire brutale, la diplomatie la plus avisée et souple, la force retrouvée des moyens financiers de l’Etat russe fondée sur les prix en hausse du pétrole, du gaz et des autres matières premières et la négociation avec les élites locales prêtes à comprendre leurs éventuels "intérêts communs" avec Moscou.
A l’aune de la situation dans le Caucase, nul ne saurait nier que Poutine est ici un grand bâtisseur-reconstructeur à sa manière, tout autant que l’on peut constater que son succès en Tchétchénie, inattendu pour beaucoup, concourt bien à son objectif clair de faire réintégrer à la Russie sa place entière de grande puissance mondiale.
La suspension sine die du Traité sur les Forces conventionnelles en Europe dont il a fait une loi, votée le 30 novembre, montre que Poutine est en tout état de cause un homme déterminé autant que capable.
Il est donc des enseignements collectifs riches à tirer de la paix retrouvée et de la prospérité actuelle de la Tchétchénie, avec ses travers, ses racines et ses conséquences.
14 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON