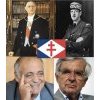« What did you expect ? », « what else ? », la gamme « make up » de l’Oréal : lentement, mais sûrement, la langue anglaise gagne du terrain sur notre territoire, dans tous les domaines. Slogan publicitaire, noms de produits ou de magasins, noms des films. A quand le coup d’arrêt ?

L’anglais qui s’impose
Il est sacrément paradoxal de constater que depuis le vote de la loi Toubon, insidieusement, mais sûrement,
notre belle langue perd des parts de marché dans notre espace public national. Tout le problème vient du fait que cette progression, aussi certaine soit-elle, est lente, et donc peu spectaculaire. Pourtant, pour qui parvient à se souvenir de la situation d’il y a 20 ou 30 ans, la situation s’est largement dégradée. Nous allions faire nos courses dans des Atac ou des Champion, et non des Simply Market ou des Carrefour Market. Le nom des films était presque toujours traduit dans la langue de Molière. Relativement peu de produits avaient des noms aux consonances anglo-saxonnes.
Mais le pire est sans doute atteint dans la communication, où il semble qu’aujourd’hui une communication sur trois comporte un mot d’anglais. On trouve «
l’art de vivre, by Roche Bobois ». On se demande bien quel est l’intérêt de mettre «
by » au lieu de «
par ». Et on ne compte plus les marques qui adoptent des signatures en anglais, certes traduites, mais le plus souvent de manière trop discrète. Schweppes demande «
what did you expect ? », Nespresso, «
what else ? », Adidas affirme «
get ready ! », Sony soutient «
this is for players » pour sa nouvelle console,
Evian promet « live young ». On ne voit pas bien l’intérêt qu’il y a à ne pas traduire en français ses slogans, qui ne sonnent pas moins bien qu’en anglais. Et passons sur le «
motion and emotion » de Peugeot, absolument incompréhensible.
De l’économie et de la politique
La raison pour laquelle les entreprises utilisent des slogans en anglais n’est pas idéologique mais seulement pragmatique et économique. Comme l’anglais est devenu la lingua franca du monde, il est plus simple de demander aux agences de trouver des slogans dans cette langue plutôt que de travailler sur des slogans locaux qui imposent traductions et validations. Encore une fois, il semble que le néolibéralisme rêve d’une planète qui serait plate et de consommateurs qui seraient plus globaux que locaux. Tout ceci permet des économies d’échelle et une facilité de gestion que les langues nationales compliquent grandement. La globalisation des affaires n’a que faire des langues et des cultures.
Pourtant, aussi lente soit elle, cette progression de l’anglais n’en est pas moins insidieuse et doit absolument être combattue. D’abord, parce que la langue officielle de notre République est le français, pas l’anglais, et qu’il revient à l’Etat de défendre l’espace public de cette invasion. Le Québec a montré la voie avec des lois volontaires. Par-delà le snobisme de certains anglophones à l’égard de ceux qui maîtrisent moins bien la langue de Shakespeare, pour qui l’anglais représente souvent une forme de rejet de ce qu’ils sont, la langue est un élément majeur de notre identité et de notre culture. En ne la défendant pas, nous laissons faire la déconstruction partielle de notre identité et de notre culture.
Bien sûr, les partisans du « laisser-faire » hurleront sans doute à la censure et à l’autoritarisme, mais parce que le français est notre langue officielle, il doit être défendu beaucoup plus fermement face à ces dérives. Cela doit passer par l’interdiction totale de l’emploi de l’anglais dans notre espace public.