De la notion de république et des déclarations des Droits de l’homme contradictoires
La lecture de l’intéressant ouvrage de Jean-Paul Brighelli intitulé « Une école sous influence ou Tartuffe-roi » m’a mené à me demander ce qu’est la république en France en 2006, quelle est la res publica, chose commune, dont il est question. La réponse dépasse ce que j’aurais cru de prime abord.
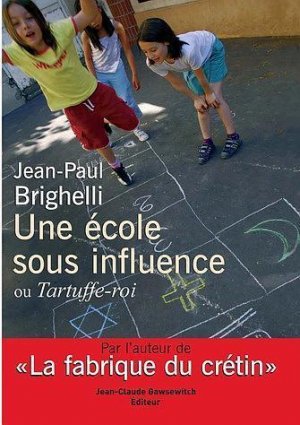
Dans un chapitre, Brighelli oppose démocratie et république, oppose valeurs républicaines et valeurs démocratiques. Ce propos me semble tout à fait farfelu : notre république fut fondée en inspiration à la fois de l’oligarchique république romaine antique et de la démocratique Athènes antique, les humanités prises en opposition au passé médiéval, très largement et indûment diabolisé.
Notre république n’est pas apparue ex nihilo. On trouve de multiples résidus historiques dans ses fondements, par exemple le droit de grâce présidentiel (Constitution de 1958, article 17), pouvoir régalien s’il en est. Notre république n’est pas apparue comme une invention soudaine et pure, exempte d’inspirations contradictoires, ni comme un retour au passé antique. Certes, le nom république en dit long sur l’environnement symbolique de ses fondateurs ; on trouve ainsi sur nos monuments nationaux les faisceaux, attributs des licteurs accompagnant les magistrats romains (rappelons que le magistrat romain est un citoyen mandaté en politique et en religion), marquant le pouvoir coercitif de ces derniers. Mais on ne doit pas croire que les hommes ayant fait ou préparé, consciemment ou non, notre Révolution ont fait un choix délibéré pour un aller directement vers la Rome antique. Même si nous avions cru vivre une Renaissance en fermant l’ère médiévale, qui n’aurait été qu’une parenthèse, cette chose commune, cette res publica, développée pendant l’Ancien Régime (élaboration permise, ceci étant dit en passant, par l’ère médiévale qui a réalisé le passage du Royaume des Francs au Royaume de France puis à la France, comme autant d’étapes vers la création d’une unité nationale, parfois fragile), est le produit d’inspirations multiples, notamment l’inspiration du modèle démocratique athénien. Ainsi, lorsque les Droits de l’homme et du citoyen sont déclarés en 1789, on évoque en préambule « Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale ». Qu’est-ce donc que l’Assemblée nationale, sinon l’ekklesia de la démocratie selon un modèle représentatif (la démocratie directe est impossible dans un pays où il faut plusieurs jours pour se rendre d’une ville à l’autre, sans moyen de communication tout à fait fiable). L’Assemblée nationale ne constitue pourtant pas le Parlement à elle toute seule : s’y joint le Sénat, oui, comme dans Senatus populusque romanus (SPQR), c’est-à-dire une institution qui trouve sa source dans l’oligarchie romaine. Que ce soit par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ou par notre Constitution (l’actuelle étant celle de 1958, et de toute façon inclut dans le bloc constitutionnel la Déclaration de 1789), le fondement démocratique du pouvoir est martelé : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » (Déclaration, article 3), « Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (Constitution de 1958, article 2), « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum » (Constitution de 1958, article 3). Nous pourrions aussi évoquer le principe du jury populaire des Assises, parfois moqué ces temps-ci, principe qui marque, doit-on pourtant le rappeler, l’apparition de la démocratie dans le judiciaire.
Il faut se rendre à l’évidence : notre république, notre res publica, c’est à la fois bien moins et bien plus que celle des Romains. Jean-Pierre Chevènement m’irritait, lorsqu’il employait à toutes les sauces le terme république. J’étais souvent irrité lorsque j’entendais parler de « valeurs républicaines », ce qui, pour moi, trop au fait de la nature de la République romaine, paraissait insensé. Il avait pourtant vu juste.
Rome est évidemment la République par excellence. Enfin, c’est la res publica par excellence, car on comprend bien que le terme république est un terme français d’étymologie latine, pas un terme romain antique. Y avait-il des valeurs républicaines à Rome ? Je crois qu’il faut dire qu’il y avait surtout la conscience d’un bien commun, littéralement d’une res publica donc, mais qu’il ne faut pas y voir la définition d’une forme précise de gouvernement. En histoire romaine, en France, nous avons pris l’habitude de distinguer trois périodes : la période archaïque des rois, la période républicaine, le Principat. Nous avons fait le choix, quand nos connaissances sur le sujet étaient peut-être moindres (il y a quelques siècles), quand nos méthodes n’avaient pas encore vocation scientifique, de parler de république pour désigner la période qui satisfaisait le plus nos propres ambitions. Mais dans les sources, pour les Romains antiques, la res publica est une constante, c’est Rome, indépendamment des formes de régime qui la gouvernent. Lorsque nous avons décidé de parler de période républicaine pour désigner la période oligarchique, nous croyions que nous pouvions estimer que le Principat (régime de forme monarchique, période parfois dite impériale) usait du terme res publica comme d’une propagande, que c’était un terme galvaudé. Assurément, notre point de vue, à une époque où l’on contestait les monarchies un peu partout en Europe, n’était pas forcément très lucide, alors que ressentions le besoin de prouver que la monarchie était incompatible avec l’idée de res publica. On pourra certes trouver des sources antiques critiquant le Principat, en particulier à sa naissance, le donnant comme trahison de la res publica : que des Romains aient pu ressentir le principat comme une trahison de la chose commune ne signifie pas que ce fût la forme de gouvernement qui en soi était la trahison, mais son usage et ses dérives. Ainsi, Cicéron dans De re publica, aux prémices de ce que sera le Principat (Marius, puis Pompée, puis Sylla, des citoyens devenant tour à tour des citoyens plus puissants, en dignitas et auctoritas, que le reste des gens, familles, oligarques), met en garde ses concitoyens contre la tentation monarchique : il évoque les expériences monarchiques des débuts de Rome, « cette magnifique constitution établie par Romulus », il ne prétend aucunement que l’idée de res publica soit apparue avec la forme de gouvernement qu’il défend (l’oligarchie) et qu’il décrit comme « forme mixte » de gouvernement d’ « équilibre tempéré » ; il part du principe que la forme de gouvernement à laquelle il adhère est devenue nécessaire quand de mauvais rois ont corrompu la bonne constitution monarchique ancienne, bref, quand des monarques, contrairement à leurs prédécesseurs, ont cessé de tenir compte de la res publica.
Notre république est donc bien moins que celle des Romains : la nôtre ne concerne qu’un petit maillon de l’histoire de France, c’est précisément une certaine conception de la France. Mais de ce fait, c’est aussi bien plus : cette certaine conception de la France repose sur un certain nombre de valeurs énumérées précisément dans notre Constitution et dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, valeurs dont la démocratie fait largement partie. On peut donc à raison parler de valeurs républicaines en France. Et on a le droit de nier le républicanisme d’associations comme Ras-le-Front, par exemple, qui se décrivent comme opposées à « la mise en place d’une société [...] qui remet en cause les valeurs républicaines », alors qu’elles soutiennent des groupes révolutionnaires (intrinsèquement antirépublicains, donc) et prônent la désobéissance aux lois dotée de la légitimité républicaine (notamment celles portant sur l’immigration).
On ne saurait agréer Brighelli quand il oppose démocratie et république française, puisque la démocratie en fait partie. Mais ce n’est point dramatique, car je crois que le fond de sa pensée, ce qu’il cherche à dire, est cependant juste. Ce qu’il combat, si je comprends bien, c’est l’idée que les Droits de l’homme et du citoyen doivent dépasser leur portée de définition civique et doivent être appliqués à tous les maillons de l’activité humaine, en faisant fi des limites aux droits. Dans le cadre scolaire, cette idée, cette idéologie, c’est croire que l’enseignant est égal à l’élève. Son ouvrage illustre parfaitement bien, je crois, les conséquences de cette absurdité.
L’incarnation même de cet esprit néfaste qui corrompt la République se trouve, je crois, dans la Déclaration des droits de l’homme de 1948, de l’ONU, qui pervertit le bon sens de notre déclaration de 1789. Notre Déclaration stipule dans son article premier : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » Nous reconnaissions la possibilité de distinctions sociales fondées sur l’utilité commune, permettant légitimement de considérer qu’un enseignant est supérieur à un élève pour tout ce qui concerne l’enseignement. La Déclaration de l’ONU dans son article premier déclare :« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » On trouve là une assertion discutable, l’idée que tous les êtres humains sont raisonnables (même les tueurs en série ? même les nourrissons ?) mais surtout s’est envolée la notion de distinction fondée sur l’utilité commune, et cela est préjudiciable. Autre exemple. Dans notre article 11 est stipulé : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. ». Dans la version de la Déclaration universelle, article 19, une fois de plus, tous les abus sont permis : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ». Le plus dramatique, c’est de se dire que la Déclaration la plus mesurée, celle qui envisage des limites, est celle qui fut écrite à une époque où la liberté d’expression n’était acquise nulle part. C’est un signe à ne pas ignorer, le fait que ceux qui ont fait preuve de la plus grande prudence sont aussi ceux qui pourtant ont été le plus affectés par les problèmes dont il est question, ceux pour qui ces problèmes étaient une réalité vécue (mise à l’index, publications en Hollande, justice arbitraire, hiérarchisation sociale des droits des individus, etc.), bien plus que n’importe quel diplomate de l’ONU ou n’importe quel chef d’État d’une démocratie en 1948.
Il y a, certes, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, de bonnes intentions. Mais ce texte est à l’image du TCE : un fourre-tout très inégal. Pour une part, cette déclaration est redondante avec notre Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (et avec les textes d’esprit équivalent des autres démocraties - car il en existe évidemment, notre Déclaration elle-même n’a pas été écrite sans source d’inspiration ni sans en inspirer d’équivalentes) dans la défense des droits essentiels (légalité des peines, égalité de droit, etc.) ; pour l’autre part, cette déclaration fait état d’intentions généreuses mais elle prétend faire du droit avec des sentences imprécises (or tout flou juridique est porte ouverte à l’arbitraire, puisqu’il reviendra au juge de l’éclaircir).
Par exemple, pour en venir aux questions éducatives chères à Brighelli, dans l’article 26 de cette Déclaration universelle, quel droit essentiel protège-t-on quand on déclare que « l’enseignement technique et professionnel doit être généralisé » ? En quoi un tel choix social (qui est positif, à mon avis) est-il de l’ordre d’un droit essentiel pour l’homme ? Pourquoi ne pas ajouter, à tant faire, un article stipulant le nombre de boulangeries par habitant qui doit être disponible ? Quand on déclare que l’éducation doit « favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux », n’impose-t-on pas d’idéologiser l’éducation de manière absolument contradictoire avec notre république ? Si notre éducation est laïque, c’est donc qu’elle ne prend pas parti en matière religieuse : ni contre, ni pour. Notre Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 disait : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » Pourquoi veut-on se coltiner un article demandant de faire du prosélytisme religieux ? En quoi est-ce un droit essentiel de faire subir aux enfants un prosélytisme religieux dans un pays où chacun peut pratiquer librement sa religion dans la sphère privée ?
On peut être d’accord ou pas avec les intentions généreuses de cette Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU, qui est dans l’ensemble à l’image de cet article 26. On peut être d’accord, disais-je, il est néanmoins flagrant que dans la plupart des cas, ce ne sont pas des droits qui sont exposés, mais des intentions, des programmes politiques. Or, lorsqu’un programme politique est défini dans un traité international et non pas au Parlement, la démocratie est bafouée (notamment parce qu’on ne peut revenir sur un traité international comme on peut le faire en amendant une loi). Par ailleurs, lorsqu’il s’agit bien de droits essentiels, tous les verrous, toutes les limites pour prévenir des abus sont supprimés.
Notre république comprend dans ses fondements un corpus de valeurs dont la contestation me semble être le ferment des conflits religieux et ethnicisés. Il est terrible de constater qu’un texte de l’ONU sert de support à cette contestation. Mais le discrédit mérité du texte de l’ONU ne doit pas se déporter sur notre brillante Déclaration, qu’il est toujours bon de relire, si parfois on se met à douter de sa clairvoyance.
28 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










 !
!
