Tocqueville et le paupérisme : une vision toujours très actuelle
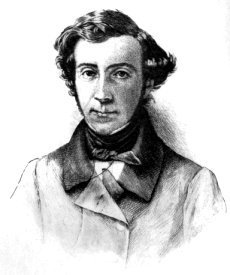
En ces jours de duels politiques, d’affrontements idéologiques, politiques, sociaux et économiques sur l’avenir de notre pays, j’ai pris le parti de poster un court billet sur l’analyse du paupérisme faite par Tocqueville en 1835 et qui aujourd’hui plus que jamais semble conserver une incroyable actualité, car il me semble qu’elle ne doit pas faire l’économie d’un traitement politique réinvesti en ce début de XXIe siècle.
En 1833, après un voyage en Angleterre, Alexis de Tocqueville (1805-1859) se lance dans une réflexion sur les causes du paupérisme qui touche les pays en phase d’industrialisation. De cette réflexion sortira un essai, intitulé Le Mémoire sur le paupérisme publié en 1835.
Avant tout, il fait une distinction entre misérabilisme et paupérisme. Quand le premier touche les pays pauvres, non encore industrieux (Europe du Sud par exemple), le second est la spécificité des pays industriels, Angleterre et Nord de la France notamment à l’époque où il écrit. Le terme de paupérisme apparaît d’ailleurs en Angleterre en 1822.
Tocqueville part du constat suivant, posé comme paradoxal, auquel il va tenter d’apporter une réponse. Comment expliquer ce phénomène en apparence contradictoire qui veut que ce soit dans les pays les plus riches que l’on observe la plus grande pauvreté ?
A partir du XIXe en Angleterre et dans une moindre mesure en France, on assiste à un mouvement sans précédent d’exode rural et paysan. La situation misérable du monde agricole et rural entraîne ces derniers à quitter les provinces pour gagner les zones urbaines et trouver un travail en usine. De fait, dans les grandes villes naissantes, le brassage est dense, les migrations internes et externes importantes et la ville s’édifie cahin-caha dans une sorte de brouhaha généralisé, où les solidarités anciennes, familiales, communautaires et religieuses se délitent au profit de liens plus superficiels et informels. Les individus urbains se retrouvent plus isolés. En outre, l’arrivée massive de main-d’œuvre des villages et campagnes constitue un vivier exceptionnel de forces productives pour l’employeur. Celui-ci dispose d’une « armée de réserve » conséquente, pour reprendre une terminologie marxiste, sur laquelle il peut faire jouer la concurrence et réduire de manière drastique le salaire. Si bien que l’ouvrier du XIXe se retrouve dans une situation de pauvreté et d’indigence souvent plus grande que celle qu’il pouvait connaître dans les campagnes. Son salaire est un « salaire de subsistance », mais s’il vient à lui manquer le travail, il lui manquera aussi de quoi survivre. Le paysan, mal loti avait au moins la chance de subvenir à ses besoins.
Voilà pour le constat. Mais Tocqueville va développer une analyse prospective d’une grande pertinence, à partir de la lecture de la situation historique, sociale et économique de l’époque, que l’on pourrait résumer à travers son propos suivant : « Plus une société est riche, industrieuse, prospère, plus les jouissances du plus grand nombre deviennent variées et permanentes. »
Ainsi, plus un pays s’enrichit, plus de nouveaux besoins apparaissent pour contenter l’enrichissement de la société. Par exemple, des habits propres, des biens superficiels, deviennent une nécessité. Si bien que celui qui n’en dispose pas, faute de moyen, est considéré comme pauvre et nécessiteux. Il réclame son dû comme il réclamait autrefois de quoi se nourrir. L’habit devient produit de nécessité, au même titre que la nourriture. En revanche, Tocqueville constate qu’en Espagne, au Portugal, nulle nécessité de porter l’habit propre. La population vit misérablement, mais elle ne vit pas pauvrement. Le vêtement ne constitue pas un besoin impérieux. « Dans un pays où la majorité est mal vêtue, mal logée, mal nourrie, qui penserait à donner au pauvre un vêtement propre, une nourriture saine, une commode demeure ? » En revanche, dans une société industrieuse, qui s’enrichit (on parlerait de croissance économique et de développement aujourd’hui), des jouissances nouvelles apparaissent qui deviennent bientôt des besoins. « L’homme naît avec des besoins et il se fait des besoins » nous dit Tocqueville. De ses besoins nouveaux, il se fait un devoir de les combler, sans quoi il sera considéré et se considérera lui-même comme pauvre. Ainsi, plus une société s’enrichit, plus la pauvreté doit également aller en s’accroissant, sauf à y trouver un remède, un moyen efficace d’enrichir le plus grand nombre sans appauvrir le reste de la population. Ce constat est partagé par l’auteur. « Si toutes ces réflexions sont justes, on concevra sans peine que plus les nations sont riches, plus le nombre de ceux qui ont recours à la charité publique doit se multiplier, puisque deux causes très puissantes tendent à ce résultat : chez ces nations, la classe la plus naturellement exposée aux besoins augmente sans cesse et, d’un autre côté, les besoins s’augmentent et se diversifient eux-mêmes à l’infini. » L’auteur fait preuve ici d’une incroyable perspicacité théorique et empirique qui se vérifie toujours près de deux siècles après (même si les Trente Glorieuses ont laissé croire à l’égalitarisme social, à tel point que certains sociologues ont pu parler à cette époque de l’ « embourgeoisement de la classe ouvrière »).
Ainsi, plus un peuple, une société, un pays s’industrialisent et s’enrichissent, plus croît la part de population pauvre. Plus ces pauvres accèdent à des besoins, plus se créent de nouveaux besoins inaccessibles à eux-mêmes. Si bien que la richesse d’un pays peut se mesurer à l’ensemble des biens et services jugés comme « nécessaires » pour les individus qui y vivent. Plus un pays s’enrichit, plus ses « pauvres » s’appauvrissent puisque parallèlement à leur incapacité à subvenir à leurs besoins, s’ajoute de nouveaux besoins toujours indisponibles à leur situation.
Mais alors, comment faire pour éviter ce creusement économique et social entre riches et pauvres ? Comment faire pour éviter le mouvement de révolte sociale qui risque de se diffuser dans ces classes laborieuses, exploitées et indigentes qui constituent la manne principale de la société industrielle naissante ? C’est déjà le souhait que formulera Tocqueville bien conscient du danger social potentiel que représentent ces formes nouvelles d’inégalités, en plus de l’inacceptabilité morale de la chose, en ces termes :
« A mesure que le mouvement actuel de civilisation se continuera, on verra croître les jouissances du plus grand nombre ; la société deviendra plus perfectionnée, plus savante ; l’existence sera plus aisée, plus douce, plus ornée, plus longue ; mais en même temps sachons le prévoir, le nombre de ceux qui auront besoin de recevoir l’appui de leur semblable pour recueillir une faible part de tous ces biens, le nombre de ceux-là s’accroîtra sans cesse. On pourra ralentir ce double mouvement ; les circonstances particulières dans lesquels les différents peuples sont placés précipiteront ou suspendront son cours ; mais il n’est donné à personne de l’arrêter. Hâtons-nous donc de chercher les moyens d’atténuer les maux inévitables qu’il est déjà facile de prévoir. »
Une vision fataliste en guise de conclusion, loin d’être rassurante quant à l’avenir des sociétés industrielles. Pour autant, Tocqueville souligne bien la nécessité de ne pas tomber dans une vision manichéenne. « Fixons sur l’avenir des sociétés modernes un regard calme et tranquille. » Mais succèdera à cet appel à demi-masqué à l’intervention de l’Etat dans la régulation de l’économie moderne de la part de Tocqueville, la théorie libérale qui deviendra la théorie économique dominante, formalisée autour la thèse de la « main invisible » du marché d’Adam Smith, et qui restera maîtresse jusqu’à la fameuse crise de 1929. Pourtant, cette approche tocquevilienne de la paupérisation semble se réactualiser depuis une vingtaine d’années, avec l’apparition de la précarisation des parcours professionnels, de la désaffiliation sociale (R. Castel), des « working poor », du chômage de masse, etc. qui devraient inviter nos deux futurs prétendants à se décider sur les mesures politiques sociales et économiques à prendre pour enrayer, ou tout au moins infléchir, le renouveau des situations de paupérisation de nos sociétés hypermodernes.
7 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









