Du renoncement libérateur à la rencontre céleste (théorie du PCRA 4)
Après les 1, 2, 3 premières parties de cette étude, nous allons tenter ici d’achever l’esquisse d’une théorie psychologique de l’amour courtois en explicitant comment l’aban-don de soi, c’est-à-dire, le sacrifice entendu comme renoncement à son désir de satisfaction, à la possession de l’objet désiré se trouve être tout à la fois la condition de possibilité d’une rencontre de sujet à sujet, mais aussi, la source d’un désir qui, porté à l’incandescence, ne s’éteint jamais et constitue en soi, une source de jouissance qui ne connaît pas la crise.
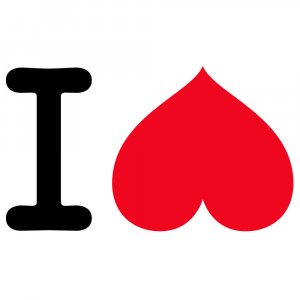
Que nous l’assumions ou non, la dimension sacrificielle inhérente à l’aban-don de soi auquel invite la passion amoureuse n’est pas un héritage suranné. Car c’est toujours par ce que l’on est prêt à lui sacrifier que l’on dit à l’autre la valeur qu’il/elle a à nos yeux. Le monde marchand l’a bien compris qui, avec force publicité, invite l’amant à casser sa tirelire pour offrir à sa belle le plus beau des bijoux.
Le renoncement à l’accomplissement du désir physique qui se dit dans l’épreuve amoureuse de l’assag — quand la belle et le chevalier passent une nuit nue à nu, sans se toucher, seulement séparés par une épée — n’est donc pas du masochisme, mais une discipline que l’on s’impose joyeusement car au travers d’elle nous disons à l’autre qu’il n’est pas le simple objet de nos désirs sexuels, mais le sujet que nous désirons rencontrer.
L’amour humain peut (doit ?) dépasser l’animalité de l’Eros possessif en y associant l’Agapé, cette forme d’amour qui porte au don de soi, et qui s’incarne généralement dans l’attitude des parents disposés à tout sacrifier, y compris eux-mêmes, pour leurs enfants ; ce dont, notons bien, l’animal est lui aussi capable.
L’amour courtois ou fin’amor est, comme son nom l’indique, un amour civilisé, tout empreint de bonnes manières qui sont, à tout instant, dans la plus minuscule des attentions, dans la moindre parole, l’occasion de dire à l’autre le respect qu’on lui porte.
l faut y insister, cela s’opère à chaque fois par une forme de renoncement à la toute puissance primitive de nos désirs qui fait de l’autre un objet de satisfaction. Le simple fait d’être capable de se taire, pour laisser la parole à l’autre et simplement l’écouter, est déjà une forme de renoncement, un sacrifice miniature qui, sans mot dire, fait comprendre à l’autre qu’on le considère comme un sujet, comme un être libre que l’on entend respecter en tant que tel et dont la parole a pour nous de la valeur, quoi que ce soit qu’elle veuille dire. Lorsque nous sommes portés par le désir, lorsque nous avons le souci de plaire, nous savons sacrifier à cette règle de politesse que, malheureusement, nous nous empressons souvent d’oublier dès que l’objet du désir est venu en notre possession.
L’amour courtois a porté cet esprit de renoncement, l’Agapé, au cœur de l’Eros. Il en a fait une règle qui, tout en s’appuyant sur les autres règles — les interdits qui permettaient de faire obstacle à l’accomplissement du désir —, les a dépassées et a ouvert un nouvel espace relationnel, celui de la rencontre de sujet à sujet.
La condition d’une telle rencontre étant le renoncement au désir naturel de « possession » de l’autre, le refus de le réduire à un statut d’objet de satisfaction de nos besoins sexuels et affectifs, on peut comprendre que cet espace, ouvert il y a un millénaire, soit encore quasiment vierge.
Il reste à conquérir. Car, vous l’avez compris, la révolution de l’amour courtois est depuis longtemps révolue, laminée et récupérée qu’elle fut par l’institution du mariage. Trop vite réduit à ses dimensions sociales et biologiques, l’amour libre des anarchistes n’a, quant à lui, connu qu’un feu de paille lors des belles années de la contre-culture. Son potentiel révolutionnaire n’a pu s’affirmer faute d’une maîtrise suffisante de la dimension psychologique. La libération de la pulsion sexuelle a surtout fait apparaître l’actualité de la domination masculine. Au moins en avons-nous fini avec l’angélisme du désir sexuel, qui n’est pas automatiquement bon parce que « naturel ».
Mais il nous faut encore en finir avec l’angélisme du sentiment. Il est temps de reconnaître qu’au travers de la possessivité qu’elle tend à légitimer, l’innocente sentimentalité constitue le réservoir constamment renouvelé de l’archaïsme, c’est-à-dire, de la violence, qui caractérise encore les relations de couple.
Ainsi Pascal Bruckner a bien raison quand il écrit… :
" On sait aujourd'hui que l'amour n'est pas démocratique, qu'il ne répond pas à la justice ni au mérite, qu'il charrie la dépendance, l'abjection, la servitude aussi bien que le sacrifice et la transfiguration. C'est cette complexité de l'amour que nous devons redécouvrir. "
Mais il le dit en croyant encore au sentiment, en croyant qu’après la révolution sexuelle des années 60 et 70, il suffira de lui faire à nouveau une place pour que vienne la paix des couples. Insondable naïveté. Le monde a parfois connu la paix des braves mais jamais celle des couples, au moins pour ce qui est du plan sociologique, c’est-à-dire, statistique. Cette paix reste à forger.
La référence que fait Bruckner à la démocratie, surprenante dans le contexte amoureux, est cependant des plus judicieuses car c’est bien du respect du sujet, du respect de sa liberté dont il s’agit. Renoncer à posséder l’autre, à le « contrôler », à l’avoir en son pouvoir pour en faire un être-sous-la-main, un objet de désir destiné à combler nos besoins sexuels et affectifs, c’est renoncer à l’archaïsme et à l’« ancien régime », c’est lui reconnaître la totale liberté d’être ce qu’il/elle est ou veut être, c’est-à-dire, la totale liberté d’agir selon son désir de sujet libre. C’est, en somme, permettre à la démocratie d’advenir dans le couple.
Aussi incongrue que cette dernière puisse sembler ici, elle est éminemment souhaitable car l’autre devient alors infiniment désirable pour au moins deux raisons. D’abord parce que « rien ne me fait plus envie qu’un objet qui toujours m’échappe ». Ensuite parce que le fait que ce soit un être totalement libre qui me choisisse est certainement ce qui donne la plus grande valeur à sa présence auprès de moi. Car l’attention d’un être que je tiens en laisse (affective, sexuelle, financière, etc.) n’a de valeur que si je suis angoissé à l’idée de vivre seul. Pour paraphraser Coluche, je dirais que certains ont des conjoints parce qu’ils ne voient pas qu’un chien leur conviendrait aussi bien (vu la manière dont ils les traitent).
Tel est donc ce qui donne son sens au parfois douloureux effort de contenir encore et encore son désir tout en jouissant (quel autre mot ?) de l’énergie et de l’ardeur qu’engendre son inaccomplissement, tant il est vrai que « le plaisir de cet amour se détruit quand le désir trouve son rassasiement ».
Renoncer à faire de l’accomplissement du désir sexuel sa priorité, renoncer à le chercher pour le laisser advenir, savoir même y renoncer complètement autant de fois et aussi longtemps que nécessaire, c’est mettre un terme à la violence de l’instrumentalisation, de la possession, c’est consentir au statut de sujet libre qu’a l’autre au sein de ce que l’on pourrait appeler une démocratie amoureuse.
Exprimer le plus complet respect à égard de l’autre passe même, me semble-t-il, par le fait de, non seulement le laisser (verbe qui traduit un je-ne-sais-quoi de subi et donc d’éventuellement réticent) mais le vouloir libre. Il s’agit en somme de manifester clairement sa compréhension et sa pleine adhésion au fait que seule la rencontre d’un être libre a de la valeur… pour un être libre.
Une fois les amants accordés sur une telle vision, les moindres de leurs gestes, les plus petits murmures seront comme des offrandes qu’ils se feront réciproquement et qui leur procureront la plus intense jouissance par ce fait même qu’ils auront su préalablement renoncer à toute attente et vivre ainsi un Agapé qui « contient » Eros au double sens du terme contenir que de Rougemont avait souligné en son temps. Plutôt que de venir remplir un vide ou un manque, la présence, l’attention de l’autre sera vécue comme un cadeau inespéré qui, dans un voluptueux chavirement, fera déborder de plaisir celle ou celui que l’incandescence de son désir avait déjà comblé(e).
Parce qu’elle est tout entière placée sous le sceau du renoncement, parce qu’elle n’est porteuse d’aucune attente, d’aucune revendication, d’aucune recherche de satisfaction via l’autre-fait-objet, une telle relation d’aban-don et de respect mutuels constitue, à ma connaissance, le seul lieu où l’amour puisse être vécu dans une paix et une félicité proprement céleste qui confine au sacré.
La rive du fleuve qui reste à atteindre me paraît donc être, ni plus ni moins que celle où l’amour se vit dans la spiritualité, lorsque nous touchons au divin ou que, plus exactement, nous cessons de lui faire obstacle ; lorsqu’au sortir du fleuve, « nue à nu », nous le laissons advenir, au travers de l’autre, qui nous le rend bien :-)
Voici comment on peut, je crois, décrire le paysage proprement tantrique sur lequel l’amour courtois ouvrait et pour lequel il serait bon d’avoir à nouveau un chemin d’accès tracé et dégagé. Car depuis au moins deux mille cinq cent ans que les innombrables aventuriers de cette forme d’amour nous ont laissé des jalons, nous en avons une telle profusion qu’ils risquent de nous égarer au moins autant que de nous aider.
C’est pourquoi dans les deux prochaines et dernières parties de ce texte, je proposerai une réflexion sur quelques principes que je crois nécessaires pour (a) véritablement mettre en acte la volonté de respecter l’autre totalement, donc dans sa liberté absolue de désirer et (b) construire ainsi, grâce à l’accord auquel il s’agirait de venir, une relation où la paix sera assurée. Dans un tel contexte, chacun peut baisser la garde, renoncer au souci de soi, venir à l’aban-don de soi et laisser ainsi advenir l’inouï d’une rencontre qu’on peut reconnaître comme céleste en cela que, par la diversité de ses formes et le caractère extatique de la présence qu’elle engendre, elle déborde infiniment l’étroitesse du cadre dans lequel la société, dans son souci de reproduction a, jusqu’à présent, tenté de maintenir les couples.
9 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









 .
.
