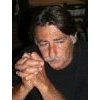Emprunter plus pour produire moins…

Je ne suis pas forcément réjoui lorsque des relais dans la presse ou le monde politique confirment ce que je pense. Perdu dans ma bulle, loin du monde, je préfère croire que la cause de ma radicalisation n’est somme toute que le résultat de ce qu’affronte aux quatre coins du monde : violence, pauvreté, déchéances, arbitraire, et j’en passe. Je me dis, depuis longtemps déjà, qu’à force de remplacer le salaire décent par l’emprunt, la vision et l’anticipation politique par l’urgence (de la dette, de la guerre, des « réformes », etc.), peuples pays et dirigeants n’existent plus que par leur statut de « clients ». A force d’observer l’Argent fuir toute activité à long terme, tout investissement stratégique, toute rémunération du Travail pour se démultiplier au sein des arcannes financières, il me paraissait naturel, qu’au bout du compte (ou du conte), on se dirigeait vers un monde ou la seule ambition ou projet politique serait de rester suffisamment « respectable » aux yeux de la gouvernance financière pour pouvoir encore et toujours emprunter. Cette mécanique me paraissait si absurde (et si désastreuse pour mon propre pays, la Grèce), que j’avais tendance à supposer que le problème était en moi, que j’étais déconnecté, fantasque et que d’autres paramètres, qui m’étaient inconnues, faussaient mon analyse d’apprenti sorcier.
Hélas, même la Standard and Poors conclue pareillement en expliquant la perte du triple A de plusieurs pays européens. Le sommet européen, affirme-t-elle a fait une mauvaise analyse : ce n’est pas l’orthodoxie budgétaire la problème, c’est la productivité, les déficits commerciaux. Il ne faut pas plus de rigueur, il faut plus d’exportations. Bien entendu la S. and P. a autre chose à la tête : il faut compresser encore plus le coût du travail, rendre la « flexibilité » encore plus effective en réduisant les protections du Travail au sein de l’espace européen. Cependant, et en partant de son constat on peut argumenter différemment : c’est la monopolisation des capitaux par le secteur financier qui freine la productivité au profit de la spéculation.
Tous ceux qui ne mettent pas en cause les us et coutumes financières ne peuvent agir que sur la marge, sur les miettes que « loue » la finance à l’économie réelle et au développement des Etats.
Justice et finance sont des termes oxymores : jamais le secteur financier n’a prétendu faire dans du moral ou du social. Mais, encadré, limité, contrôlé, il le faisait plus ou moins jusqu’aux années 1980, faute de mieux : le secteur de l’économie réelle offrant alors des bénéfices comparables à ceux de la finance et ses restrictions légales. C’est le constant détricotage de ces restrictions, l’absolue autonomie de la finance, la dépendance idéologique et politique des Etats à son égard (quoi qu’en disent nos élites politiques), qui sont à l’origine de la crise permanente que nous subissons. Car parallèlement, toutes les restrictions qu’on enlevait à la finance on les réintroduisait au sein des Etats, de leurs fiances et de leur fonctionnement. Cela s’est fait presque en catimini, loi après loi, directive après directive, décrets d’applications après décrets d’applications, mais avec cohérence. Ainsi, le citoyen pouvait peut-être manifester contre la privatisation des services essentiels ou stratégiques de l’Etat (transports, télécommunications, éducation, énergie, etc.), mais n’avait pas la moindre idée de la privatisation de l’Etat lui-même et de son budget. Il observait bien les débats sur les impôts, le déficit budgétaire ou le commerce extérieur, mais on lui expliquait que pour la dette, un clic sur l’ordinateur procurait (auprès du mystérieux marché) les milliards journaliers nécessaires. Il y avait, surtout chez nos élites libérales, un discours contradictoire : d’une part on discourait sur les dépenses exagérées des Etats, mais d’autre part, on n’expliquait pas pourquoi cette rigueur était nécessaire puisque on pouvait toujours se procurer à moindre frais les sommes manquantes.
Ainsi on pouvait sans vergogne discourir sur le scandale de la sécurité sociale ou de la caisse des retraites, mais sans jamais pointer du doigt les dettes abyssales de l’Etat lui même. Cela permettait, entre autres, d’occulter le rôle de l’impôt : le gouvernement actuel ne s’est pas senti obligé d’expliquer en quoi consistait la baisse des impôts, le bouclier fiscal etc., si ce n’est pour donner une prime au cynisme : si on ne le fait pas, les riches partiront. Depuis, il a fait ce que font tous les gouvernements libéraux (c’est-à-dire tous au sein de la zone euro), il a peu à peu remplacé l’impôt par des taxes, c’est-à-dire qu’il fait payer à l’ensemble des citoyens les cadeaux octroyés aux plus favorisés. Sans empêcher pour autant un glissement de plus en plus raide vers la dette. C’est tout de même étonnant que la dette, toujours plus importante depuis les années 1980, connaît des pics asymptotiques chaque fois que des pères fouettards de la rigueur (Juppé, Balladur, Raffarin, Fillon) sont aux affaires. En trente ans, la seule période ou la dette a diminué est celle ou Jospin était premier ministre, et pour être exact, la (courte) période Villepin.
Ce n’est pas anodin : toute l’infrastructure idéologique du libéralisme (et du Sarkozisme qui en est une variable exotique), est basée sur la critique d’un Etat dépensier et des méfaits du coût du Travail. On peut dire ce que l’on veut mais la preuve est faite que la coordination des mesures « Dette - Travail - Budget » ont été efficaces sous Jospin tandis qu’elles ont creusé des déficits abyssaux sous Sarkozy. La preuve est faite aussi que le choix, encore et toujours le même, de sauver avec les deniers des citoyens le secteur financier chaque fois qu’il est en faillite (c’est-à-dire de privatiser les bénéfices et de « collectiviser » les pertes) garantit une impunité du secteur financier et lui permet de continuer sans vergogne son chantage vis-à-vis des Etats en perpétuant les fonds dits spéculatifs, en misant tout (ou presque tout) dans le marché obligataire. Inutile de souligner (et là c’est « l’expert » qui parle) que le marché obligataire est la cuve commune où se dilue l’argent gris et noir de toutes les activités délictueuses, de tous les trafics illégaux.
Mais là aussi, c’est une autre histoire
52 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON