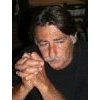Grèce : déni de démocratie

Je disais souvent concernant la Turquie et à l’adresse des technocrates européens, qu’ils devaient choisir entre une démocratie réelle qu’ils souhaitaient mais qui aboutirait in fine à un conflit interne opposant les « occidentalisés » à la Turquie profonde et profondément religieuse, et une démocratie formelle, sous tutelle de l’armée garante de la laïcité kémaliste. Je leur disais que l’on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. Et que surtout, que l’on n’impose pas, à marche forcée, notre vision du progrès et de la démocratie. A l’époque, j’étais à des lieues d’imaginer que ces mêmes technocrates iraient jusqu’à bafouer la démocratie réelle grecque (avec les défauts qui lui sont attachés), produit d’une genèse douloureuse issue de la rencontre du mythe grec et de la dure réalité d’un pays créé au forceps et qui, de tout temps, subissait les interventions étrangères au point qu’elles sont devenues partie de son patrimoine génétique.
La démocratie grecque, souvent confisquée par des rois imposés, s’est affirmée comme un processus à la fois libérateur et spolié par ceux qui le dirigeaient. Que ce soit les marchands ou pirates iliens (aujourd’hui armateurs), par des intellectuels, hommes politiques, ou militaires venus d’ailleurs (Italie, Allemagne, Angleterre, Russie etc.), que se soit par les grands propriétaires terriens ou l’église (et qui devaient leur richesse à leur collaboration avec la porte sublime), les grandes fortunes compradores férues des Lumières ; que ce soit par les bandits et autres seigneurs de la guerre qui lancèrent la révolution finissant par guerroyer quelques mois plus tard entre eux, que ce soit, bien plus tard, par les adorateurs des régimes totalitaires, impérialistes ou communistes, les va-t-en guerre, les agents de la City, de Wall Street ou les fournisseurs de la sixième flotte américaine « garantissant » la « sécurité » en méditerranée, la vie politique grecque, sous influence, n’a rien à voir avec un long fleuve tranquille.
De 1821 jusque en 1973, le jeune Etat grec n’a connu que la guerre, les coups d’Etat, les régimes autoritaires, l’arrivée massive des refugiés de la Turquie, la guerre civile, et c’est dans cet environnement guerrier qu’elle a vu son territoire tripler mais la grécité s’effilocher avec l’invasion de Chypre, et, précédemment, la mort soudaine des communautés grecques en Turquie, en Egypte, en Tunisie, en Afrique noire et à Madagascar.
Tant bien que mal, depuis la chute de la dictature des colonels (1967-1073), l’Etat grec a su endormir ce passé douloureux, en finir avec les séquelles de la guerre civile, intégrer les centaines de milliers de refugiés et instaurer un Etat de droit, loin des dictats internes ou externes, sans jamais faire abstraction de la complexité géopolitique et des dangers sous-jacents, que les guerres en ex-Yougoslavie ont ravivé. En effet, sa relation avec l’Europe, et surtout avec l’Allemagne, idyllique dans un premier temps, fut perturbée par cette guerre, le démon nationaliste (Macédoine) allant de paire avec une incompréhension mais aussi une crainte inavouée générée par le rôle que joua Berlin dans le démantèlement de ce pays voisin, avec qui la Grèce a toujours eu une relation privilégiée, souvent perturbée par ses alliés de l’OTAN. C’est à ce moment précis qu’Athènes intériorisa le fait que dans cette Union Européenne son avis ne comptait pas. L’élargissement, précipité et bâclé, renforça cette perception, ainsi qu’un sentiment pour la première fois carrément anti-européen renforcé par le retour de la certitude que « même membres de l’Union », les grecs étaient seuls et isolés sitôt qu’ils pensaient autrement. Qu’une machine technocratique totalisatrice (comme jadis les « grandes puissances »), imposerait ses choix quel que soit l’avis (et l’intérêt) de la Grèce et surtout des grecs. D’autant plus que Chypre entrait dans l’Union sans intégrer la partie nord de l’île, et que l’Europe - et ce jusqu’à aujourd’hui - délaisse cette situation pour le moins oxymore.
La crise des subprimes suivies de celle des dettes souveraines éclate dans ce contexte de défiance (réciproque). Dès lors qu’éclate la « crise grecque », et dès l’apparition de la fameuse Troïka, il devient évident que la « solidarité européenne » n’est qu’un mythe supplémentaire, un de ceux qui travaillent la société grecque. Sa gestion, qui aboutit à l’éviction d’un premier ministre élu et à son remplacement par un technocrate de la finance internationale apparaît comme un déni de démocratie réelle, cette arlésienne pour laquelle tant de sang a été versé dans ce pays. Dès lors, tout ce qui advient à ce pays apparaît comme une offense à la démocratie, engendrée par Bruxelles. Les partis traditionnels du bipartisme éclatent, et des combinazione à la romaine court-circuitent la vraie représentation populaire qui se divise depuis entre une majorité réelle hostile aux plans de « restructuration » de l’économie et de la société grecque et une majorité parlementaire fidèle aux diktats européens qui sont, à juste titre, identifiés à Berlin, ce qui, entre autres, ravive la mémoire populaire sur l’occupation nazie, la résistance et la guerre civile. D’autant plus que la crise génère une force néo-nazie (aux dépends d’une extrême droite « classique »).
La technostructure européenne et les croisés néolibéraux berlinois exigent des chiffres pour cette normalisation qui vise avant tout non pas tant l’orthodoxie budgétaire mais la baisse du prix du travail, des services et l’annihilation de ce qui faisait la force de l’économie grecque, le petit commerce, les petites entreprises vivant essentiellement du marché intérieur. Pour y aboutir, l’Europe ferme les yeux sur les moyens : législation par décrets, lois spécifiques « d’urgence » entérinant les accords entre la troïka et le gouvernement, décisions arbitraires et anticonstitutionnelles, etc. Venue pour mettre une fin à la fraude fiscale des « puissants » elle ordonne désormais (toujours pour l’orthodoxie des chiffres et faute de pouvoir s’en prendre à ces « riches ») une saignée fiscale des couches les plus défavorisées de la population, à une paupérisation sans précédent de l’Etat qui doit se démettre de ses prérogatives élémentaires (santé, sécurité, éducation, autorités locales) et exige le démantèlement à prix cassé des entreprises et services de l’Etat, dont pour l’instant personne ne semble être preneur, sauf, bien entendu, ces fameux « riches » et dont la fortune est issue de la prédation systématique et corruptive de leur propre pays.
Cette modernisation de la Grèce prend de plus en plus, du moins pour les Grecs, l’allure d’un Etat entropique, « à la botte des étrangers », qui renforce l’insécurité, bafoue les institutions, l’éducation, la justice, la santé en démolissant tout ce qui avait été bâti durant les dernières cinquante années. La voix de la Grèce est désormais inaudible, et le peuple grec, pour la première fois de son histoire est tétanisé par la peur.
Comme en Espagne, en Italie ou au Portugal, comme pour les pays nouveau venus et dont personne ne parle à commencer par la Roumanie, la Hongrie ou la Bulgarie, il y a un basculement évident de la démocratie réelle à une démocratie non plus formelle mais peinant à en garder la forme. Quant à l’esprit, il s’est perdu dans les méandres de la technostructure européenne, sacrifié aux intérêts des banques européennes qu’elles soient allemandes, françaises ou grecques et immolé par le manque de clairvoyance et de volonté politique du couple Franco-Allemand, de la City des armateurs et du fameux déficit de démocratie des institutions européennes…
27 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON