La France encore condamnée par la Cour européenne : la liberté d’expression, un problème français ?
Une fois de plus, jeudi 7 juin 2007, la France vient d’être condamnée pour "violation de la liberté d’expression » par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Vu les contraintes de saisine de la CEDH seulement après épuisement des recours nationaux, bien propre à épuiser surtout les victimes, il a fallu encore attendre plus de dix ans pour que justice soit rendue ! Le poison de l’injustice a eu le temps d’agir.
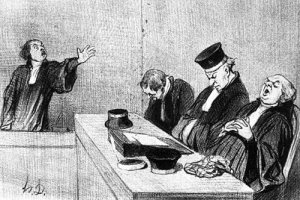
Le système judiciaire français, du tribunal de grande instance de Paris à la Cour de cassation, avait condamné entre 1998 et 2001 les deux journalistes J. Dupuis et J.-M. Pontaut, auteurs d’un ouvrage intitulé « Les Oreilles de l’Élysée » paru chez Fayard en 1996, sur l’affaire d’État qu’étaient devenues « les écoutes téléphoniques de l’Élysée » : il leur était reproché le délit de recel de violation du secret de l’instruction ou du secret professionnel.
La Cour, au contraire, « estime que la condamnation (des deux journalistes) s’analyse en une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté d’expression et qu’elle n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique ». L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme est donc bien violé : « Toute personne, stipule-t-il, a droit à la liberté d’expression » sous réserve de respecter certains devoirs et certaines responsabilités.
Le contexte des « écoutes téléphoniques de l’Élysée »
Le livre incriminé, « Les Oreilles du président », faisait le point en 1996 sur le système illégal d’écoutes téléphoniques organisé entre 1983 et 1986 par « la cellule antiterroriste de l’Élysée », elle-même installée par le président Mitterrand entre 1982 et 1986. La lutte antiterroriste était sa mission affichée après les sanglants attentats perpétrés en 1982 rue Marbeuf et rue des Rosiers à Paris. Elle aura surtout cherché par des écoutes illégales à maîtriser certaines affaires compromettantes pour le pouvoir, comme « l’affaire des Irlandais de Vincennes », ou à préserver les secrets de famille du président.
Sous couvert d’une « mission de coordination, d’information et d’action contre le terrorisme », ces écoutes se sont intéressées à près de « 2 000 personnes », parmi lesquelles figuraient nombre de personnalités, des avocats, des gendarmes, des journalistes, tous soupçonnés d’être de dangereux terroristes sans doute.
Après publication dans la presse de listes des victimes de ces écoutes illégales, au début des années 1990, une information judiciaire a fini par être ouverte en 1993.
Les deux journalistes condamnés sur plainte de G.M.
Comme d’autres acteurs de la cellule antiterroriste - qu’on retrouvera condamnés par la cour d’appel de Paris le 13 mars 2007 - « G.M. directeur adjoint du cabinet du président Mitterrand » (c’est ainsi que l’arrêt le nomme) a été mis en examen pour atteinte à la vie privée d’autrui et sera condamné, plus de dix ans plus tard, le 9 novembre 2005, à une peine amnistiable plutôt légère de six mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros. Ayant fait appel, il a été à nouveau condamné, le 13 mars dernier, lui et les autres coupables soupçonnés, à verser des dommages et intérêts à leurs victimes : la cour d’appel a, en effet, contredit le premier jugement de 2005 en estimant que cette atteinte à la vie privée d’autrui était non une « faute de service » mais « une faute personnelle détachable du service », car, pour devoir obéir au président de la République, ils n’en devaient pas moins rester soumis aux principes constitutionnels républicains. On a expliqué cet arrêt en mars dernier sur Agoravox. Depuis, tous les condamnés se sont pressés de se pourvoir en cassation pour tenter d’échapper au versement de ces indemnités, voire au remboursement coûteux des frais pris jusqu’ici en charge par l’État au titre de la protection statutaire.
Entre-temps, la plainte déposée par G. M. contre les deux journalistes avait prospéré à une bien plus grande vitesse. Leur condamnation en première instance est tombée dès le 10 septembre 1998, leur appel a été rejeté neuf mois plus tard, le 16 juin 1999, et leur pourvoi en cassation, deux ans plus tard, le 19 juin 2001. Les tribunaux français ont cru ainsi pouvoir « protéger le droit de G. M. à un procès équitable dans le respect de la présomption d’innocence ».
Les journalistes, ces « chiens de garde de la démocratie » selon la Cour
La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas entendu de cette oreille cette défense d’un des acteurs des « écoutes de l’Élysée ». Elle fait valoir trois principes, royalement ignorés de la justice française, et consacrant de longue date le rôle majeur joué en démocratie par l’information.
1- Selon la Convention, rappelle-t-elle, le droit de critique dans le domaine politique ne connaît guère de restriction : un homme politique ne peut être traité comme un simple particulier : ses propos et son action nourrissent légitimement le débat contradictoire public. Et sa place d’ « homme public influent » a exposé G. M. à ce traitement.
2- D’autre part, « les écoutes illégales de l’Élysée » sont devenues une affaire d’État, intéressant légitimement l’opinion publique au plus haut point. Les journalistes étaient dans leur rôle en livrant des informations précises et fondées sur des pièces à conviction - les fac-similés et les extraits de procès-verbaux incriminés - : « le public avait un intérêt légitime à être informé et à s’informer sur (le) procès » qui était en cours.
3- La Cour souligne enfin avec force le rôle éminent qui revient aux journalistes dans toute relation d’affaire pénale, et surtout dans "un débat public d’une telle importance », en raison de la gravité des faits reprochés à G. M. et aux autres responsables des « écoutes téléphoniques ». Elle n’hésite pas à rappeler que les journalistes en pareil cas « (exercent) leur mission de "chiens de garde" de la démocratie ». La formule peut surprendre : depuis le livre de Paul Nizan, en 1932, elle était péjorative ; certaines féministes ont cru la réhabiliter en se baptisant « les chiennes de garde » contre le sexisme.
Le conflit de devoirs résolu par la Cour
En conséquence, la seule question qui se posait, selon la Cour, était de savoir si « l’intérêt d’informer le public l’emportait en l’espèce sur les devoirs et responsabilités pesant sur les (journalistes) en raison de l’origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés » : autrement dit, la publication de ces documents pouvait-elle nuire à la protection de la présomption d’innocence de G. M. et à son droit à un procès équitable ? La Cour est formelle : non ! Vu le nombre de victimes écoutées et interrogées, certains documents étaient déjà connus ou publiés ; G. M. s’est exprimé lui-même dans les médias ; et, en 1996, à la parution du livre, il était mis en examen depuis déjà trois ans et sa condamnation n’est intervenue que près de dix ans plus tard ! « Le gouvernement (français), observe la Cour, n’établit pas en quoi, dans les circonstances de l’espèce, la divulgation d’informations confidentielles aurait pu avoir une influence négative tant sur le droit à la présomption d’innocence de G. M. que sur son jugement et sa condamnation ».
Une leçon de liberté d’expression à la justice française
Enfin, la Cour fait la leçon à la justice française. Dans un débat politique d’une telle ampleur, cette manière de privilégier la défense du secret de l’instruction plutôt que la liberté d’information est lourde de menaces pour une démocratie : « une atteinte à la liberté d’expression peut risquer d’avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de cette liberté », même si les journalistes n’ont été condamnés qu’à des amendes modérées (762,25 euros chacun, à quoi se sont ajoutés 7622,50 euros de dommages et intérêts dus à G. M.)
- C’est bien le problème de la justice française que de se montrer si peu attentive à la liberté d’expression. En 1999, la CEDH avait pourtant déjà tranché dans l’affaire opposant, depuis 1989, Le Canard Enchaîné et M. Calvet, alors PDG de Peugeot : la publication de sa feuille de paie par l’hebdomadaire établissait la preuve que M. Calvet avait bénéficié d’une augmentation de salaire quand ses employés en grève en 1989 en étaient, eux, privés.
La Cour avait alors rompu avec éclat le dilemne infernal dans lequel était enfermé le journaliste : car, jusque-là, ou il n’avait pas de preuves, et c’était un diffamateur, ou il en apportait et on en faisait un receleur ! La Cour interdisait donc de poursuivre la simple détention d’un document si l’article lui-même était irréprochable. D’autre part, n’étant pas tenus au secret de l’instruction, les journalistes ne pouvaient pas davantage être poursuivis pour « recel ».
- On a vu, à nouveau, une dérive comparable de la justice, dans l’affaire opposant récemment le procureur Hontag contre le même Canard Enchaîné, condamné en première instance et en appel pour atteinte à la présomption d’innocence. On en a rendu compte aussi sur Agoravox. Il est vrai toutefois qu’en cassant un premier arrêt, dans cette affaire, la Cour de cassation a commencé, en février 2007, à recadrer le zèle de ces juridictions pour éviter la Cour européenne.
Force est de constater, tout de même, au vu de ces arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, que la justice française ne paraît pas prêter une attention suffisante à ses leçons jurisprudentielles. Heureusement que, tous les jours, dans tout bureau de poste, chacun peut voir une affiche d’un opérateur téléphonique qui prétend prendre le plus grand soin de la liberté d’expression en France. Son slogan ? « On n’est pas près de vous couper la parole ! » Seulement l’ambiguïté volontaire de la formule ne peut faire illusion : elle feint de se soucier de la liberté d’expression quand elle ne parle que du coût prétendument avantageux des communications téléphoniques. Pourquoi d’ailleurs cet opérateur se priverait-il de badiner dans un domaine si essentiel, puisque « les écoutes téléphoniques de l’Élysée », comme une culture tenace de la justice française, montrent que la liberté d’expression n’est pas prioritaire en France ? Paul VILLACH
Documents joints à cet article

11 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









