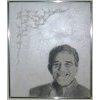Violences juvéniles et troubles des conduites
Violences juvéniles et troubles des conduites, une question d’actualité. Leurs prises en charge, un enjeu de société
Les incivilités et les violences de certains jeunes, qu’elles soient individuelles ou collectives, ponctuent l’actualité de façon inquiétante. Leurs prises en charge nécessitent la définition de repères et de stratégies qui font débat. Les enquêtes de l’ODAS permettent, par exemple, de saisir l’ampleur des maltraitances sur les enfants et de supposer leurs séquelles. C’est aussi en ce sens que l’INSERM a rendu récemment un rapport sur le trouble des conduites. Ce rapport est contesté car, à côté d’une guidance familiale justifiée, il préconise des psychothérapies comportementalistes et des traitements médicamenteux, là où les aléas des histoires familiales, les intrications relationnelles conflictuelles et les difficultés psychologiques des jeunes nécessitent des accompagnements pluridisciplinaires patients et durables. Il l’est aussi parce que ses recommandations se limitent à une clinique adaptative à la vie sociale qui, dans son orientation préventive, s’illusionne en oubliant que le processus de développement des subjectivités est conflictuel. Ces considérations expertes divergentes devront donc être arbitrées par des choix politiques car ces symptômes, au-delà des cas particuliers, témoignent de l’état de notre société et de son évolution.

1) Des troubles et des violences qui questionnent : quelques exemples indicatifs.
Lundi matin, B., 7 ans, arrive dans son institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (anciennement institut de rééducation), le visage renfrogné. Les professionnels présents lui souhaitent le bonjour auquel il répond en balançant son cartable et en frappant les portes et les meubles à coups de pied. Le directeur en prend aussi pour son grade, obligé d’esquiver les shoots et les insultes que l’enfant lui décoche avec un plaisir teinté d’angoisse. Un éducateur finit par l’attraper fermement et l’accompagne, afin qu’il s’apaise, dans une salle aménagée avec de gros coussins. Le temps passe et, une fois de plus, la poussée de violence de B. se dégonfle, fragile processus psychique qui se réactive selon son humeur et selon les événements.
Jeudi, dans le même établissement, les enfants jouent sous la surveillance du personnel qui, lui aussi, se détend après avoir dirigé les multiples ateliers du début d’après-midi. Ce temps libre laisse souvent cours aux pulsions destructrices. Quelques pigeons se posent à proximité du regard des enfants. En une fraction de seconde, des pierres sont saisies et lancées en direction des volatiles. Les adultes présents interviennent, mais trop tard. Dans l’emportement, les jets ont franchi le mur d’enceinte de la cour et dégradé plusieurs véhicules en stationnement. Des passants s’affolent, des cris fusent, les gestes s’arrêtent et les interrogations accusatrices viennent augmenter le climat d’inquiétude.
Vendredi après-midi dans le même établissement, X., 11 ans, est en classe avec deux de ses camarades de son âge et de son niveau. Le cours de mathématiques commencent avec un rappel des opérations connues : calculs de sommes, de différences et de produits simples. Le professeur leur demande ensuite de trouver la solution d’un problème de niveau cours élémentaire 2e année (classe d’âge 9 ans) : Yann est malade. Le médecin lui demande de se soigner avec 7 comprimés chaque jour, pendant 10 jours. Combien de comprimés Yann doit-il prendre en tout ? Ce problème banal, comme ceux faisant appel aux notions d’argent ou de réalité courante, suscitent chez les enfants troublés des réactions bien inquiétantes. Malgré une lecture attentive et partagée de l’énoncé par le groupe, X. ne supporte pas de se retrouver seul face à cette question. Il est pourtant capable de dessiner le schéma des 70 comprimés cumulés. Il peut aussi faire une addition et même la simple multiplication 7 x 10 = 70. Le professeur insiste peut-être trop lourdement, essayant de rassurer X, qui finit par s’énerver et hurle : Je ne sais pas ! Je ne veux pas chercher ! C’est à vous de me donner la solution, vous êtes le professeur ! De toute façon, ici c’est une école de merde, vous n’aidez pas bien les enfants ! Pendant ce temps-là, son camarade de table trouve la solution, ce qui fragilise un peu plus X., qui finit par faire voler son cahier et sa trousse à travers la classe et qui sort de la pièce en claquant la porte. X. n’aime pas réfléchir et résoudre les problèmes mathématiques. Son histoire familiale serait-elle une suite de problèmes non résolus qui lui pèsent trop pour pouvoir en affronter d’autres ? Sa peur de l’échec est aussi patente et dramatique, suite d’une scolarisation désastreuse dans son école de quartier. X. cumule les stigmates d’un développement déséquilibré, que seule une prise en charge pluridisciplinaire et concertée pourra atténuer, voire effacer.
Des affaires semblables ponctuent le quotidien des établissements spécialisés dans les troubles du comportement. Ils sont aussi de plus en plus répertoriés dans les écoles ou dans les structures extra-scolaires classiques. Ces enfants ou ces adolescents sont aussi des élèves qui, pour la plupart, ont un retard scolaire et qui éprouvent des difficultés d’attention, de concentration et souvent d’ordre orthophonique ou psychomoteur. Ce sont pourtant des enfants à l’intelligence normale ou quasi normale, qui peuvent communiquer et comprendre les particularités ou la gravité des situations. Mais ils semblent bien souvent dépassés par l’étrangeté ou l’inadaptation de leurs paroles et de leurs actes. Mus par des intentions qui leur échappent partiellement, ils sont, en y regardant de plus près, victimes de leur propre histoire.
2) Des phénomènes qui se développent, l’actualité et l’ODAS en témoignent.
Ces observations seraient utiles, mais toutes relatives, si elles ne suscitaient pas quelques liens avec les drames individuels ou collectifs qui entachent l’actualité : des préadolescents volent une voiture et percutent des passants, des jeunes de banlieue se laissent emporter dans une révolte sauvage et gratuite, un mineur blesse son camarade avec une arme blanche, des enfants de 10 ans vandalisent une école maternelle, etc., etc. Les journaux rapportent régulièrement des faits similaires et des statistiques étatiques signalent leur augmentation (1)
Des questions et des pistes de réflexion en découlent nécessairement : comment comprendre ces comportements antisociaux et la genèse de ceux-ci ? Peut-on déceler préventivement des troubles significatifs chez ces jeunes ? Ces enfants et ces adolescents seraient-ils possédés par quelques démons qui les écarteraient du chemin d’une socialisation équilibrée ? Seraient-ils atteints par quelques désordres génotypiques ?
Une première piste de réflexion vient des études et statistiques de l’Observatoire décentralisé de l’action sociale (ODAS). Dans son rapport concernant 2004, cet organisme qualifie d’inquiétante la forte augmentation des enfants en danger. Plus de 95 000 enfants ont été recensés comme maltraités ou « en risque », situations en augmentation de plus de 7 % par rapport à 2003. De plus, durant cette période, les nouveaux signalements effectués auprès des conseils généraux ont explosé. Des négligences éducatives lourdes, des violences physiques, psychologiques ou sexuelles, d’une part, et des situations familiales déstabilisées, d’autre part, en sont, d’après cet organisme, les raisons.
Le rapport de l’ODAS note aussi que « cette évolution traduirait une progression de la violence dans les rapports sociaux. On a le sentiment d’une société de plus en plus déstabilisée dans les règles élémentaires du vivre ensemble » (2). A l’encontre des idées reçues, la précarité économique et des troubles psychopathologiques des parents ne seraient pas les facteurs essentiels de ces maltraitances. Par contre, l’ODAS explique les signalements par « le déficit relationnel entre parents et enfants, d’une part, entre les familles et leur environnement, d’autre part... Le facteur le plus fréquemment cité est celui des carences éducatives des parents, qui renvoie souvent à une immaturité des ceux-ci, à une absence de repères et à un repli sur soi. Cela permet de relever à nouveau l’importance de l’isolement social, bien souvent à l’origine de la dégradation du comportement des familles » (2).
La dégradation du comportement des familles se traduit donc dans des paroles et des actes dramatiques qui laissent souvent des traces néfastes et durables sur leurs enfants. Il n’est pas étonnant qu’un rapport de l’INSERM indique, en février 2003, qu’un enfant sur huit souffrirait d’un trouble mental, et qu’un adolescent sur cinq en serait atteint, ces troubles étant majoritairement d’ordre émotionnel (troubles anxieux et de l’humeur) et comportemental (hyperactivité, troubles oppositionnels).
C’est ici aussi qu’il serait souhaitable de se rappeler la trajectoire extrême du meurtrier psychopathe, Guy George (né en 1962), qui a souffert de négligences éducatives graves, de troubles affectifs importants et qui, bien entendu, a été en échec scolaire, trajectoire dont le guidage a été mené avec irréflexion par les autorités tutélaires.
Si l’on constate que les modes de relation et de communication de certains parents sont violents ou inappropriés, on peut donc supposer que leurs enfants peuvent, en conséquence, souffrir de troubles comportementaux plus ou moins significatifs. Les violences ou les conduites antisociales de certains jeunes seraient l’expression réactionnelle à des manques et à des affects résultant de ce qu’ils vivent dans leur environnement familial ou social. La question est donc de mieux comprendre les degrés de gravité de ces troubles, et de séparer ceux qui nécessitent des stratégies thérapeutiques étoffées de ceux qui, par des aménagements éducatifs et familiaux, peuvent s’estomper et disparaître.
3) Des experts qui s’y intéressent : le rapport 2005 de l’INSERM.
Ce n’est donc pas un hasard si, le 22 septembre 2005, l’INSERM, a aussi rendu public un rapport à propos des troubles des conduites. Ces experts médicaux les caractérisent « par la répétition et la persistance de conduites au travers desquelles sont bafoués les droits fondamentaux d’autrui et les règles sociales » (3). Concrètement, ces enfants ou ces adolescents présentent divers signes, des crises répétées de colère et de désobéissance aux agressions graves comme le viol, les coups et blessures et le vol.
Des études internationales, aux USA en particulier, montreraient le risque important d’évolution vers une personnalité antisociale à l’âge adulte, si l’apparition de ces troubles est précoce. Attachée à son approche neurobiologique de la psychiatrie, centrée sur les symptômes, l’INSERM souhaite voir développer « le repérage des perturbations du comportement dès la crèche et l’école maternelle », afin de prévenir le développement des comportements antisociaux et délinquants. Une large information du public et des divers professionnels du champ de l’éducation devrait aussi permettre l’établissement d’enquêtes épidémiologiques utiles à la compréhension des phénomènes et de leur évolution. Une seule étude de ce type a été réalisée en France. Elle confirme la prévalence de 5 à 9 % dans une population d’enfants ou d’adolescents.
Les événements décrits plus haut trouveraient donc un cadre conceptuel approprié. Si les propositions des experts sont retenues, le dépistage précoce faciliterait l’organisation de prises en charge et des soins ciblés : programmes psychosociaux de guidance parentale en s’inspirant d’exemples canadiens ou américains, thérapies individuelles de type comportementaliste et si nécessaire, traitements psychotropes à « l’action anti-agressive. » (3)
4) Des avis qui divergent : des spécialistes contestent les propositions de l’INSERM.
Bien que les experts de l’INSERM reconnaissent le caractère complexe et plurifactoriel de ces troubles et de leur genèse, d’autres spécialistes de l’enfance et de l’adolescence jugent leur rapport confus et réducteur. En effet, les premiers écrivent que « le trouble des conduites est le produit d’interactions complexes entre des facteurs individuels (facteurs génétiques, tempérament, personnalité) et des facteurs environnementaux (relations familiales, environnement social) ». Mais, leurs préconisations semblent occulter le sens profond des souffrances exprimées par les jeunes au travers de leurs comportements antisociaux, et minimisent le travail psychique nécessaire à leur traitement.
Pour les seconds, réunir sous un même syndrome dénommé « le trouble des conduites », des troubles comportementaux dont les étiologies sont très différentes, est une erreur. Cette systématisation simplificatrice viserait en fait le traitement des troubles d’adaptation à la vie sociale, « à l’intersection des champs de la psychiatrie, de l’éducation nationale et de la justice ». En conséquence, « un risque grave se profile : celui de dérive des pratiques, sous couvert de médecine, vers des fins normatives, voire totalitaires... » écrit un collectif de pédopsychiatres, car « l’expertise de l’INSERM se réfère à un seul choix de lecture de la clinique basé sur une définition statistique de ce que seraient une conduite « normale » et un comportement humain « pathologique » » (4) .
Une telle approche épidémiologique aurait du mal à rendre compte de la diversité des situations individuelles et familiales. Elle éluderait la subjectivité qui sous-tend chaque acte conduit par un enfant ou un adolescent. Elle minimiserait la nécessité de la construction de rencontres où la parole et les aides permettent aux jeunes de se rééquilibrer de façon durable.
Si les modèles comportementaux permettent de se repérer globalement face à un enfant ou un adolescent perturbé, on ne peut, d’après ce collectif de spécialistes, faire l’économie ni d’une écoute particulière de l’individu et de son environnement, ni d’une compréhension partagée des facteurs historiques, culturels et/ou familiaux qui ont présidé à ses troubles. Et c’est la qualité de ces rencontres, de leurs conséquences pratiques au quotidien qui font la pérennité des rétablissements.
Ce collectif regrette aussi la stricte application d’un schéma classique de santé publique (repérage, dépistage, programme de prévention) sans une consultation sérieuse des professionnels du champ des troubles mentaux, l’INSERM « insinuant même qu’ils seraient à sensibiliser et à former sur cette nouvelle entité clinique : les troubles oppositionnels avec provocation. » Après les TOC (troubles obsessionnels compulsifs), nous aurions les TOP !
5) Des arguments cliniques qui s’imposent, car représentatifs de la complexité humaine.
Depuis longtemps, de nombreux professionnels des secteurs de la santé, du médico-social ou du scolaire travaillent sur les troubles du comportement. Ils savent que les passages à l’acte traduisent un dysfonctionnement du mode d’expression habituel qu’est la parole, parce qu’elle est soit inaccessible, soit insuffisamment structurée ou même refusée.
Ils constatent aussi que la violence de l’affrontement à l’autre résulte de l’absence ou de l’insuffisance de la présence de tiers symbolique car il y a « nécessité pour l’enfant comme pour l’adolescent de s’affirmer par l’opposition : l’autonomie, l’individualisation passent inévitablement par le « non » » (4). Le malaise social actuel ne facilite pas ce processus car les problèmes d’autorité au sein des familles et la déstabilisation de l’institution scolaire laissent certains jeunes seuls face à leurs angoisses et à leur destructivité.
Une prévention telle que l’INSERM l’a proposée, risque de déboucher sur un dressage des comportements des jeunes, dressage qui fait fi du processus de constitution de leur subjectivité. En conséquence, le collectif de médecins cité plus haut conteste les choix de l’INSERM qui « stigmatise comme pathologiques des colères et des actes de désobéissance et qui les présente comme « prédictifs » d’une future délinquance... », alors que l’institut devrait plutôt nous inciter à discerner ce qui relève de troubles réactionnels à un environnement défaillant et ce qui appartient à un individu ayant du mal à surmonter les contraintes et les frustrations qui s’imposent dans sa vie quotidienne et à son psychisme.
Enfin, si ce rapport souhaite anticiper l’évolution comportementale des moins de 13 ans, dont les statistiques les plus récentes montrent que leur délinquance augmente significativement, il tend à confondre deux types de délinquance :
- le premier renvoie à des troubles pathologiques qui nécessitent à la fois des stratégies thérapeutiques esquissées plus haut et d’éventuelles actions préventives relevant de mesures sociétales beaucoup plus larges que celles proposées par l’INSERM.
- le second est occasionnel et à but initiatique. Les jeunes l’instituent comme une étape au sein de leur groupe, palliant ainsi les manques organisationnels et éducatifs de leur environnement social. Cette délinquance relève alors de
En fin de compte, dans ce rapport officiel, avec la confusion entre « le malaise singulier de la subjectivité de l’enfant, la question de l’autorité -qu’elle soit parentale ou scolaire - et l’élision de la dimension symbolique dans la vie sociale », nous sommes donc invités à nous inquiéter d’une dérive idéologique de l’expertise de l’INSERM qui prétend pourtant à la rigueur scientifique. Ces propos nous incitent aussi à réfléchir doublement sur les processus institutionnels et thérapeutiques qui sont mis en place pour aider les générations montantes dans leur accession à l’autonomie et à la dignité humaine.
6) Des enjeux qui nous concernent tous : intérêts politiques et économiques et devenir sociétal.
La souffrance psychique et les troubles comportementaux qu’elle induit ne sont pas des épiphénomènes, et la manière dont une société les considère et les prend en charge n’est pas neutre. Il serait tout d’abord utile de faire un lien entre le pourcentage des jeunes troublés qui sortent du système scolaire sans ou avec peu de qualification professionnelle, et celui des jeunes chômeurs dont les difficultés d’insertion sont dramatiques. Rappelons, selon l’INSERM, qu’un enfant sur huit souffrirait d’un trouble mental et qu’un adolescent sur cinq en serait atteint. Il serait peut-être aussi utile de faire un lien entre l’évolution du nombre de cas d’enfants troublés et celle de leur dégradation vers des comportements antisociaux d’adulte, faute de structures spécialisées et des stratégies sociétales adaptées. En ce sens, l’évolution du nombre de mineurs condamnés ou incarcérés pose aussi questions : par exemple, le nombre de leurs condamnations pour délits est passé de 9 404 en 1995 à 37 266 en 2000 (5).
Pour nous résumer, les ratés de l’enfance ont de bonnes chances de faire les désastres de l’âge adulte. Bon nombre de jeunes présentant des troubles psychiques et comportementaux deviendraient des adultes à charge de la société, qu’ils soient chômeurs ou malades psychiatriques ou délinquants incarcérés. C’est un tableau pessimiste du futur car, à côté de l’évolution positive d’une minorité résiliente, le poids de ces jeunes en souffrance semble augmenter et ne pas être pris en compte à sa juste mesure.
Si le rapport de l’INSERM a l’intérêt de médiatiser un peu plus ces problèmes, c’est malheureusement de façon partielle et partiale. Il dit peu de choses, par exemple, sur les conséquences des bouleversements économiques et des contraintes budgétaires actuels qui pèsent dans les choix sociétaux en ces domaines, et qui laissent deviner de sérieux enjeux financiers. Ainsi, ces experts critiquent les centres éducatifs fermés au nom de leurs effets contagieux vers la délinquance sur les jeunes regroupés (ce que les professionnels démentent). Quand on sait le coût de tels établissements (entre 500 € et 700 € par jour et par adolescent pris en charge), les enjeux de pouvoir et les intérêts financiers qu’ils représentent peuvent susciter bien des convoitises.
Le lobby de l’industrie pharmaceutique n’est pas non plus absent d’une démarche épidémiologique et d’une approche neurobiologique des troubles.
Les violences répertoriées dans les établissements scolaires, le taux de suicide ou des comportements addictifs de certains jeunes, leurs incivilités, leurs actes délictueux ou criminels progressent, et deviennent nécessairement l’objet de préoccupations politiques et économiques. Chacun doit donc comprendre la complexité et la durabilité de ces faits pour pouvoir peser sur les choix sociétaux à venir.
Les souffrances psychiques cumulées trouvent des exutoires ou entraînent des passages impulsifs à l’acte qui entretiennent le cercle vicieux des violences. A côté des douleurs inéluctables, il est dommageable que les savoirs accumulés en médecine ou en sciences humaines, dont la littérature témoignent, n’invitent pas plus les décideurs sociétaux à agir sur les maux réductibles. Serait-ce parce que leur logique tient souvent pour de simples variables les comportements socioculturels de ceux qui n’appartiennent pas à leur sphère ? Serait-ce parce qu’ils se contentent de gérer au mieux les risques, et de tirer profit des scénarios du moment en conduisant leur déroulement ? Serait-ce enfin, comme l’écrit l’auteur de cyberfiction William Gibson, parce qu’ils se bornent à identifier des schémas dont l’incertitude anticipe difficilement les flux matériels et humains, ainsi que leurs dysfonctionnements ? Que les grandes utopies généreuses d’une part, et les forces inconscientes relevant plus d’Eros que de Thanatos d’autre part, puissent ne pas nous laisser enfermer dans des scénarios sclérosants et improductifs, voire tragiques !
Didier LESCAUDRON
(1) Rapport de l’Office nationale de la délinquance et entretien avec J.P. Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny dans l’Humanité du 11/02/05
(2) Article d’Anne Chemin dans Le Monde du 3 novembre 2005
(3) Article de Cécile Prieur dans Le Monde du 23 septembre 2005
(4) Courrier de E. Lenoble, M. Berges-Bounes, S. Calmettes et J.M. Forget
dans Le Monde du 3 novembre 2005
(5) J’ESSAIME - Journal du syndicat de la magistrature n° 7 - mai 2003
(6) Article d’Alain Salles dans Le Monde du 23 septembre 2005
16 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON