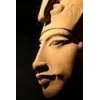Entreprises publiques, entreprises privées, services publics, services privés ?
Peut-on ouvrir les services à la concurrence, et en particulier l’énergie , les transports et sous certaines conditions, l’éducation ? La controverse fait rage par les temps qui courent, et les approches contradictoires se multiplient, pesant sur les grandes entreprises publiques dispensatrices de biens communs.
Doit-on réellement admettre que l’on puisse demander à des entreprises d’entrer en concurrence sur l’électricité d’origine nucléaire ? L’énergie implique des investissements massifs qui ne peuvent dépendre des fluctuations des matières premières uniquement. Juste après la première Guerre du golfe, le baril de pétrole est descendu à 11 dollars ; à l’époque, les services du ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Bérégovoy, avaient calculé qu’il fallait que le baril descende à 7 dollars pour que le nucléaire ne soit plus rentable (en réalité, ils n’avait pas vraiment pris en compte le coût des investissements à venir). Toutefois, si l’on avait fonctionné dans un système concurrentiel, à l’époque, qui aurait préconisé de continuer à développer le nucléaire, d’autant que le pétrole est demeuré longtemps bon marché... A l’heure où les énergies renouvelables offrent des débouchés moins gourmands à nos appétits de croissance et de consommation, est-il raisonnable de mettre le sort de l’énergie entre les mains de la seule concurrence ? Il n’est pas choquant, finalement, qu’EDF récupère de magnifiques rentes de sa production, c’est même très bien. Tant mieux. C’est une affaire qui tourne. On cite souvent Tchernobyl que l’on agite, comme un épouvantail, comme modèle de la faillite d’une production d’énergie d’Etat : mais sur ce point, le problème n’est pas que la centrale ait été publique, mais plutôt que l’Etat ait été déliquescent et irresponsable.
En ce qui concerne les transports, considérons l’Angleterre : il y existe de profondes disparités de développement économique entre les régions, parce que les transports ne sont plus assurés sur les lignes jugées "non-rentables", et il y en a un grand nombre. Il faut maîtriser un minimum la politique des transports pour envisager un développement harmonieux du territoire. A la limite, on peut envisager que l’Etat délègue certaines responsabilités par un cahier des charges, mais pas toutes.
Est-il juste de se plaindre de la SNCF ? Les TER sont une véritable réussite. Rapides, à l’heure, modernes, confortables et efficaces. Quand, effectivement, la ligne ferrée n’est vraiment pas rentable, il y a des lignes de bus qui desservent les petites communautés rurales à proximité d’une plus grande communauté. Par ailleurs, la ponctualité des trains est la plupart du temps impressionnante, ces derniers arrivant à la minute près à l’horaire prévu. Il faut avoir voyagé dans de nombreux pays pour saisir que cette performance est tout à fait exceptionnelle. Confier des lignes non rentables à des entreprises privées pourrait coûter très cher, et peut-être bien au minimum aussi cher qu’utiliser une entreprise qui a déjà un savoir-faire reconnu et ancien en la matière. Objectivement, qui serait capable de rivaliser avec la SNCF à l’heure actuelle ?
Et comment comprendre la décision de privatiser un système autoroutier qui s’avérait performant et rentable ?
Quant à l’Education, les écoles privées existent déjà. L’enseignement privé alternatif existe plus que largement : les écoles de commerce, mais aussi les CFA (très reconnus sur le marché du travail et dans plus d’un établissement public), les établissements scolaires sous contrat (pas une commune où il n’y en ait pas au moins un)...
En revanche, le monolithisme de l’Education nationale est certes patent. Mais, sur ce point, il faudrait regarder les choses de près : les responsables presqu’exclusifs de ce monolithisme sont à trouver dans les administrations centrales : partout elles bloquent à peu près toutes les innovations, et, bien plus encore que les syndicats, promeuvent non les plus méritants, mais les plus courtisans. Toute la programmation de l’EN actuelle n’est pas le fait des enseignants, qui, pour une large majorité, et contrairement à une idée fort répandue d’ailleurs, se contentent d’appliquer ce qu’on leur dit de faire. En ce qui concerne la cartes scolaire, en l’état, il vaut mieux en effet la supprimer : l’hypocrisie de ceux qui la défendent est tout simplement insupportable. Toutefois, à l’instar de François Bayrou, on pourrait aussi proposer que tous les établissements scolaires puissent offrir un parcours d’excellence. Cela suppose de revenir sur un dogme, lui, hélas, ancré chez les professeurs, les associations de parents d’élèves (PEEP comprise), les professeurs, beaucoup de parents d’élèves et plus encore l’administration centrale : le dogme de l’hétérogénéïté. Pour qu’un établissement offre un parcours d’excellence, il faut admettre qu’il y ait au moins une classe d’élite. Beaucoup confondent également (souvent volontairement) hétérogénéïté sociale et hétérogénéïté scolaire (des résultats et du niveau scolaire), même s’il faut reconnaître qu’elles tendent à se superposer. Cette hétérogénéïté sociale, ce n’est pas la peine de confier à l’école la mission de la réaliser. Ce n’est pas un problème scolaire, comme on essaie de le faire croire, mais avant tout d’urbanisme.
On pouvait lire tout récemment un échange sans fard rapporté par l’hebdomadaire Marianne entre Gaston Deferre et George Marchais. Aucun des deux n’y allaient par quatre chemins pour expliquer que les concentrations d’immigrés dans une commune grevaient les budgets sociaux et posaient de graves problèmes pour l’ordre public. Moyennant quoi, et cela se passe en 1977 ou 1978, ils concluaient qu’il faudrait disperser les immigrés dans toutes les communes de France à raison de 10% maximum par commune. On connaît la suite... Le problème est là. Et l’école n’y peut absolument rien. A cela s’ajoute une démagogie sans précédent depuis trente ans à propos de l’école pour camoufler l’échec des méthodes et la dispersion des moyens sur des enseignements non disciplinaires (heures de vie de classe, EJCS et TPE au lycée, brevet de sécurité routière, info ceci, info cela, pseudo activités d’éveil à l’école primaire, etc.). Le pompon, c’est ce que l’on demande au baccalauréat et au brevet des collèges aujourd’hui. Mais là encore, ce n’est pas de la faute des professeurs : qui conçoit ces épreuves ? Inspecteurs, recteurs, formateurs et tutti quanti, assistés de leurs créatures, quelques professeurs contraints ou rénégats, prêts à avaler toutes les couleuvres possibles et imaginables par servilité ou pour un avantage misérable (au moins s’il s’agissait de détourner quelques millions, on pourrait se dire qu’il y a un intérêt pécuniaire objectif, mais même pas, en plus).
L’appropriation
publique d’entreprises marchandes est-elle nécessairement néfaste ?
L’Etat doit-il se nourrir exclusivement de recettes fiscales, et non
d’activités marchandes qui reposeraient sur une prise de risque qui
n’est pas de son ressort ?
Soyons très pragmatiques. Concernant le capitalisme monopolistique d’Etat, il est tout de même intéressant d’en observer les effets dans un pays comme la Chine, dont la croissance frise les 10% chaque année. Evidemment, la Chine n’est pas non plus partie du niveau de la France, mais tout de même. Plus près de nous, la gestion socialiste des années 1980 mérite d’être examinée à la loupe. La nationalisation des banques a été un fiasco complet, du début jusqu’à la fin ; en revanche, pour l’industrie, le verdict est plus contrasté. Si l’on considère l’industrie automobile (mais pas seulement, la sidérurgie, la construction navale, l’aéronautique aussi), sous l’effet des fonds publics injectés, on peut constater qu’elle s’est considérabement rénovée. Les Renault 25 et 21 sont symptomatiques de cette modernisation. Il y a quelques années, on pouvait lire dans un magazine automobile l’exemple d’une Renault 21 turbo diesel qui avait passé son existence à parcourir l’Europe et la Sibérie de long en large, accomplissant ainsi un périble de 1 200 000 kilomètres, et ceci en changeant deux moteurs seulement. Renseignements pris sur ce modèle, on s’apercevait que grand nombre d’entre eux dépassaient allègrement les 500 000 kilomètres... L’Etat français, en nationalisant, a aussi modernisé considérablement une bonne partie de l’appareil productif français, celui-là même qui s’est avéré en partie responsable de l’échec patent de la relance par la demande de 1981.
Il est vrai que l’appropriation publique a un relent de dékoulakisation peu séduisant. Mais, à l’heure actuelle, ce seraient plutôt les bijoux de famille que les trois derniers gouvernements ont eu tendance à vendre (les socialistes ont été d’autant plus silencieux sur nombre de privatisations que ce sont eux qui les ont entamées, et notamment celles des autoroutes...). Il ne s’agit nullement de s’opposer par principe aux privatisations, mais elles doivent être sensées.
Il est vrai qu’un Etat marchand pourrait déroger à la règle de la concurrence libre et non faussée.
Fondamentalement, quels sont les deux reproches que l’on peut adresser à une entreprise d’Etat ? 1. De ne pas respecter les règles de concurrence. 2. De ne pas être perfomante. Si l’entreprise d’Etat répond à ces deux critères, pourquoi faudrait-il la privatiser ? En outre, en ce qui concerne la concurrence, le véritable problème pour un pays comme la France, ce sera les réactions de ses partenaires européens. Pour les cas que nous citons, transports et énergies, c’est surtout l’ire de concurrents européens que la France a à craindre. Toutefois, dès lors qu’un accord serait trouvé et conclu avec nos partenaires pour que l’Etat français conserve sous la marque déposée et estampillée "Etat français" certaines entreprises, où serait le mal ? Finalement, dès lors que nos entreprises publiques ne participent pas à notre asphyxie (mais il faut tenir compte de leur valeur ajoutée, pour cela, et pas seulement de leur coût), pourquoi devrait-on inciter l’Etat à s’en désengager ? Le reste est une affaire de gestion.
Toutefois, on peut envisager de déléguer certains services de proximité à des partenaires privés dans les communes rurales éloignées des grands centres urbains. On assisterait alors au retour de l’épicerie d’antan, c’est-à-dire d’un commerce généraliste, sauf que, cette fois, ce ne seraient plus seulement des biens de consommation que l’épicerie vendrait, mais aussi des services que lui délèguerait l’Etat : poste, caisse de Sécurité sociale, impôts... Voilà un métier nouveau qui pourrait avoir de l’avenir : un épicier-buraliste qui suivrait une formation sommaire d’agent de l’Etat multi-fonctions. Nombres de services administratifs ne requièrent pas de formation approfondie. Ces épiciers pourraient en assurer le fonctionnement moyennant une rétribution de l’Etat, et ce serait à l’avantage de tous, car cela permettrait de conserver une vie dans les petites communautés et coûterait à l’évidence moins cher à l’Etat, donc au contribuable.
Les monopoles (ou oligopoles
!) ne sont pas le seul fait des entreprises publiques. La Lyonnaise des
eaux et la CGE se sont certainement longtemps accordées secrètement
pour fixer sur une base non concurentielle le prix de l’eau. Dans les
premiers temps du câble, cette même Lyonnaise des eaux, sous le doux nom
de Cybercable, numéricable et deux trois autres opérateurs passant par
le câble (leurs noms m’échappent), se sont partagés longtemps le marché.
Pour la téléphonie, l’année passée l’on soupçonnait un accord secret
entre les opérateurs de téléphonie. En remontant plus loin dans
l’histoire, on trouve sept compagnies pétrolières qui se partagaient
90% des concessions de la planète dans les années 1960-1970 : les majors.
Les coûts de production d’une entreprise publique sont-ils nécessairement prohibitifs ? Il serait intéressant de comparer ceux de Renault et de PSA sur les trente dernières années. Evidemment, pour être juste, il faudrait prendre en compte les subventions mastodontesques que PSA a reçues aussi.
Enfin, à qui dénigrerait les résultats de la France, sous économie dirigée, par rapport à d’autres pays, il faut rappeler qu’elle a tout de même longtemps été classée au quatrième rang mondial pour la puissance économique, et surtout, qu’en la comparant au Japon ou à l’Allemagne, il faudrait considérer le coût monstrueux pour son économie de sa sanctuarisation nucléaire, de son financement d’une armée pendant longtemps opérationnelle et autonome, de sa politique de soutien et de développement dans ses ex-colonies (seuls l’URSS et les USA en ont fait autant pendant les années 1960-1970-1980). Si le Japon et l’Allemagne avaient dû payer leur défense nationale au prix fort ainsi que leur décolonisation, seraient-ils parvenus à un tel niveau de développement si vite ?
Sans être favorable à un tout public, il demeure souhaitable que les Etats conservent, s’ils le peuvent évidemment, un pied dans les secteurs stratégiques (éducation, transports, énergies, communications), soit par la biais d’une entreprise d’Etat, soit par le biais de l’actionnariat ( c’est-à-dire en disposant d’une part de capital suffisante pour infléchir la politique de l’entreprise).
Pour conclure, il ne s’agit pas de promouvoir une économie planifiée, ni même dirigée, mais de plaider pour une présence de l’Etat là où un opérateur privé n’a pas les reins assez solides pour se préoccuper de l’avenir à long terme, et finalement, de mettre en avant les solutions qui réussissent, publiques ou privées, sans dogmatisme, mais avec pragmatisme.
35 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON