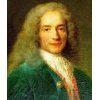Représentation politique à la radio : le déséquilibre persiste
Les média français ont été fortement critiqués lors de la dernière campagne présidentielle pour leur couverture apparemment biaisée en faveur de certains candidats. Suite aux différents appels faits au Conseil supérieur de l’audiovisuel, et aux avis émis par celui-ci, une brève analyse des émissions phares des grandes radios généralistes indique que le problème persiste.

La couverture des partis politiques dans les médias fait l’objet de nombreuses contestations, qui sont rarement argumentées. Et quand des chiffres sont disponibles, comme ceux provenant du CSA, ils sont souvent remis en question, en raison des méthodes de calculs employées. Afin de vérifier si l’apparent ressenti de nombreux citoyens, indiquant un fort déséquilibre de la couverture médiatique des personnalités et mouvements politiques, était confirmé par les faits, je me suis livré à une brève petite analyse au cours du mois dernier.
La méthode
Ne disposant pas des moyens du CSA, j’ai effectué cette analyse à partir des éléments suivants :
- Le média : j’ai choisi les quatre chaînes de radio généralistes les plus connues : RTL, Europe 1, RMC et France-Inter. Plus précisément, plutôt que de comptabiliser l’ensemble des temps de parole des intervenants, ce que prend en compte le CSA, je me suis focalisé sur 4 émissions de grande audience, correspondant aux interviews matinales réalisées par ces chaînes. Toutes ces radios ont en effet une émission matinale basée sur le même format, au cours de laquelle elles ont un invité interrogé par un chroniqueur vedette. Ces émissions, qui se déroulent au moment du pic d’audience vers 8 h 30, sont très représentatives et ne souffrent pas du biais lié à la façon dont les événements sont présentés : les invités sont largement traités de façon similaire, et libres de leurs propos qui ne sont donc pas déformés par les journalistes.
- Les critères : la comparaison a été effectué en fonction de la provenance des invités, selon 5 catégories : gouvernement, majorité présidentielle hors gouvernement, Mouvement démocrate, Parti socialiste et apparentés, autres partis politiques (FN, Verts, PC, etc.).
- La période : l’analyse a porté sur la période du 15 novembre au 15 décembre inclus. Cette période a été choisie en raison de sa richesse en événements politiques : conflits sociaux, période pré-électorale, événements de politique extérieure, création d’un nouveau grand parti politique (MoDem), sortie du livre de Ségolène Royal, remous au PS, congrès national de plusieurs autres partis, etc. De ce fait, la grande majorité des invités matinaux de ces quatre chaînes de radio ont été des personnalités politiques.
Il est important de souligner que cette analyse est largement qualitative et non statistiquement pleinement significative. Pour plus de rigueur, il faudrait bien entendu effectuer cette étude sur une plus longue durée en ajoutant d’autres critères que je commenterai par la suite. Néanmoins, la comparabilité des émissions et le nombre d’invités permet de tirer un certain nombre de conclusions avec un faible risque d’erreur.
Les résultats
Les résultats bruts de cette étude sont résumés dans le tableau suivant :
|
Gouvernement |
Majorité |
MoDem |
PS |
Autres partis |
|
|
RTL (JL Aphatie) |
6 |
1 |
0 |
5 |
0 |
|
Europe 1 (JP Elkabach) |
6 |
3 |
0 |
5 |
0 |
|
RMC (JJ Bourdin) |
10 |
4 |
1 |
2 |
1 |
|
France-Inter (N Demorand) |
7 |
1 |
1 |
5 |
0 |
|
Total |
29 |
9 |
2 |
17 |
1 |
L’analyse
La première chose qui frappe à la lecture des résultats est bien sûr la sur-représentation d’invités du gouvernement. À eux seuls, ces invités représentent environ la moitié du total. Quand on ajoute à ce nombre celui des représentants de la majorité hors-gouvernement, on arrive à environ les deux-tiers, proportion recommandée par le CSA (mais dans un ratio plus équilibré, un tiers gouvernement, un tiers majorité, un tiers opposition).
Face à cette présence massive de membres du gouvernement, la réplique est quasi-exclusivement donnée par des invités du Parti socialiste. La seconde caractéristique de cette analyse est en effet l’absence quasi-totale de représentants des autres partis politiques, malgré l’actualité politique importante les concernant. On peut d’ailleurs penser qu’en l’absence du congrès fondateur du Mouvement Démocrate pendant la période considérée, le nombre d’invités de ce parti aurait sans doute été diminué de moitié, au moins.
La couverture politique des grandes radios généralistes, telle qu’elle apparaît lors de leurs émissions phares, se traduit donc par une parole très généreusement donnée aux représentants du gouvernement, et par une vision uniquement bipolaire du paysage politique (UMP et apparentés contre PS). Si la présence de nombreux représentants du gouvernement est parfois compensée par celle de représentants syndicaux (ouvriers et patronaux, les second en moindre proportion), 30 à 40 % des électeurs français, qui ne votent pas pour les deux partis principaux, ne sont eux quasiment jamais représentés par leurs élus dans ce type d’émission.
Et les autres média ?
Mon intention première était d’effectuer une analyse comparable sur un certain nombre d’émissions-clés, à forte audience, des chaînes de télévision : journaux d’information du soir, grand journal de Canal+, etc. Malheureusement, ces émissions n’étaient pas disponibles en libre accès sur la période considérée (les archives sont généralement disponibles sur les quinze derniers jours). Cette étude sera donc effectuée pour le mois de janvier. Néanmoins, une analyse très rapide des informations disponibles a permis de noter quelques éléments communs :
- Pour une émission à invités politiques comme Le Grand Journal de Canal+, comparable dans son concept aux émissions radio analysées précédemment, les invités se répartissent dans les différentes catégories définies ci-dessus de façon très similaire aux matinales des radios : surabondance de représentants du gouvernement, et quasi-absence de représentants hors UMP-PS.
- Pour les grands journaux d’information du soir, on retrouve en première approximation environ deux reportages centrés sur le président de la République, deux sur le gouvernement, et un peu moins d’un pour l’opposition (PS quasi-exclusivement) par journal.
Quant à la presse écrite, l’excellent site de Jean Véronis (http://sites.univ-provence.fr/veronis/Presse2007/ ) permet d’effectuer une analyse intéressante de la présence médiatique des principaux leaders politiques dans la presse quotidienne. Le critère considéré est ici le nombre de citation de ces personnalités dans les différents articles parus. Il n’y a donc pas de critère d’importance (« titres », « unes »), mais plutôt une image globale du « buzz » des différentes personnalités.
Au cours de la période disponible sur son site actuellement (11 au 18 décembre inclus), sur environ 1 150 citations, j’ai ainsi pu constater la répartition suivante :
Nicolas Sarkozy : 40%
Membres du gouvernement : 35 %
Membres du PS ou apparenté : 13 %
Membres du MoDem : un peu plus de 4 %
Membres de la majorité présidentielle : 4 %
Membres d’autres partis : environ 3,5 %
Il faut noter dans cette répartition quelques biais, dus à l’absence de certaines personnalités non encore répertoriées dans le moteur de recherche (comme JF Copé pour la majorité présidentielle par exemple). D’autre part, certains membres du gouvernement s’expriment aussi en tant que responsables de partis (Hervé Morin par exemple). Le pourcentage de citations de membres du gouvernement est donc sans doute légèrement surestimé, tandis que celui des membres de la majorité présidentielle est assez nettement sous-estimé. Plusieurs personnalités du PS ne sont aussi pas répertoriées, mais d’autres sont encore considérée comme PS alors qu’elles interviennent comme responsables en dehors de ce parti (comme Dominique Strauss-Kahn).
Ces réserves une fois indiquées, on peut cependant noter que la proportion de citations de personnalités du pouvoir en place dans la presse quotidienne atteint environ 80 %, proportion qui paraît assez similaire à celle entre-aperçue dans les journaux télévisés du soir.
Conclusions
L’objectif de cette analyse très préliminaire était de vérifier si le ressenti, souvent exprimé par de nombreux internautes, d’un « matraquage » médiatique en faveur d’un camp politique, était effectivement corroboré par les faits. En effet, les données très exhaustives du Conseil supérieur de l’audiovisuel ne tiennent pas compte de l’indice d’écoute, et donc de l’impact réel des interventions et reportages des émissions analysées (ce qui serait tout à fait réalisable en utilisant les données de Médiamétrie). Pour circonvenir cet inconvénient, il était donc intéressant de s’intéresser à un nombre certes plus restreint d’émissions, mais dont l’audience et l’impact sont importants.
Effectuée dans un premier temps au niveau des grandes radios généralistes, ces mesures tendent à confirmer le déséquilibre ressenti. La surreprésentation constatée de représentants du gouvernement, et la très forte sous-représentation de personnalités situées en dehors des partis dominants ne peut que renforcer les thèses de maîtrise des médias par des intérêts proches du pouvoir. Il est notamment frappant de constater la très faible représentation du nouveau troisième parti politique français, lancé au cours de la période analysée. Ceci tend à étayer l’analyse exprimée récemment par Alain Duhamel dans une chronique de Libération, où celui-ci indique « François Bayrou avait envisagé d’observer une année de silence après la victoire de Nicolas Sarkozy. C’était inutile, les médias s’en chargent. Depuis le 6 mai, Bayrou n’existe plus à la télévision. La presse sérieuse l’enterre, les médias de masse l’ignorent. Bayrou a disparu ».
(http://www.liberation.fr/rebonds/chroniques/chronique_politique/297358.FR.php).
Pour autant, il faut se garder d’interpréter de façon définitive les résultats de cette étude encore très succincte. Au-delà de la nécessaire analyse des émissions de télévision, qui ont le plus fort impact auprès du public, deux questions encore non résolues se posent :
· cette situation est-elle nouvelle ?
· cette situation est-elle comparable à celle qui prévaut dans les autres démocraties européennes ?
Pour répondre à la première question, il faudrait analyser les résultats obtenus à partir d’émissions diffusées, par exemple, peu après l’élection de Jacques Chirac en 1995 et 2002, et après le changement de majorité politique en 1997.
Quant à la seconde, l’idéal serait donc d’étudier les résultats pour des émissions comparables chez nos voisins allemands, britanniques, espagnols et italiens, par exemple.
Enfin, il serait aussi très intéressant de regarder la représentation politique sur les principaux sites d’information internet, afin de voir si celle-ci, au sein de médias a priori moins liés au pouvoir, est fondamentalement différente.
Si ces premiers résultats laissent entrevoir l’existence possible d’un problème au sein des médias français, ce qui peut expliquer le malaise ressenti par nombres d’électeurs, il faut néanmoins être prudent avant de conclure à un véritable déni de démocratie.
58 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









 ) trop présents dans les médias, il me semble qu’il y aurai moins d’écho si il y avait un peu plus de bruit autour ...
) trop présents dans les médias, il me semble qu’il y aurai moins d’écho si il y avait un peu plus de bruit autour ... ), mais pourriez-vous m’expliquer succintement la tendance politique généralement attribuée aux radios concernées par votre étude ?
), mais pourriez-vous m’expliquer succintement la tendance politique généralement attribuée aux radios concernées par votre étude ?