Faudra-t-il craindre les nanoarmements ?
La manipulation et l’organisation de la matière au niveau nanométrique (soit 10-9 mètre ou un milliardième de mètre), c’est-à-dire aux échelles moléculaire et atomique, augure de perspectives d’applications révolutionnaires, de même que de promesses de marchés financiers colossaux (la Commission européenne évoquant le chiffre de mille milliards d’euros). Les dimensions militaire et géopolitique de la révolution nanotique sont, pour leur part, les victimes d’un sous-investissement allant même jusqu’à reléguer l’approche des risques à l’arrière-plan des préoccupations politiques et citoyennes. Et pourtant. Si les bénéfices susceptibles d’être extraits des nanotechnologies apparaissent comme des gages d’assurance pour nos systèmes politico-militaires, c’est, toutefois, sans compter sur le fait que ces derniers évolueront dans un contexte géopolitique bien différent des équilibres internationaux actuellement connus.
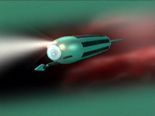
Les promesses
Comme chaque révolution technologique, la vague nanotechnologique génère dans son sillage des perspectives d’applications nouvelles venant tantôt améliorer le rendement des systèmes d’armes existants, tantôt déboucher sur des équipements originaux. De grandes attentes sont nourries à l’endroit des propriétés énergétiques, résistives, furtives et adaptatives des matériaux (matériaux à mémoire de forme, à composants piézoélectriques, etc.).
On songera, à titre d’exemple, aux avantages à la fois logistiques et financiers (au travers de possibilités de réduction des frais d’entretien) qui pourraient découler du développement de véhicules militaires hautement résistants aux phénomènes de corrosion et capables de se confondre, sur demande, avec les caractéristiques topologiques environnantes, tout en s’adaptant aux conditions climatiques du théâtre d’opération.
Quant à la nanostructuration des propergols employés pour les aéronefs, missiles et lanceurs spatiaux, elle contribuerait à une extension de l’autonomie des systèmes poussant de la sorte les équipages humains aux limites de leurs capacités métaboliques ; faisant des solutions de plates-formes autonomes des alternatives indispensables en vue de tirer le plus grand profit des prouesses techniques ainsi réalisées.
Les dispositifs de surveillance et de détection profiteront, eux aussi, des avancées de ce secteur au travers, notamment, du déploiement envisagé d’une multitude d’essaims de nanocapteurs qui se révèleront les maillons indispensables d’un vaste réseau de méta-contrôle en temps réel à la fois stratégique (prévention des risques de crise et de conflit), social (contrôle de la criminalité) et environnemental (détection avancée des catastrophes naturelles).
Selon certains scénarios, ces instruments de surveillance et de recherche de nouvelle génération permettront, ensuite, à des nano-robots de parfaire des opérations ciblées. Une zone et sa population environnante s’avèrent volontairement contaminées par l’anthrax à la suite d’un acte terroriste ?
Il suffira à des agents nanométriques d’infiltrer ladite zone et de pénétrer l’enveloppe charnelle des individus pour réaliser une désinfection complète des lieux et de ses habitants et locataires. Il conviendra, cependant, de veiller aux risques environnementaux auxquels pourrait conduire une dispersion de particules nanométriques. On citera, également, les attentes pouvant être nourries par les militaires dans le domaine des armes autonomes ou dirigées à distance, laissant présager l’imminence de l’irruption d’une intelligence artificielle pour la prise de décision tactiques (les décisions de niveaux stratégiques et opératifs demeurant la prérogative de responsables humains). Il suffit, dès lors, d’imaginer l’impact que génèrerait l’introduction d’aéronefs de combat autonomes sur la conduite d’opérations militaires auparavant à dominante humaine.
Aux Etats-Unis, l’Air Force a récemment investi pas moins de 2 millions de dollars dans des activités de R&D, destinés à alimenter la conception, d’ici 10 à 15 ans, de bombardiers à long rayon d’action, autonomes. Et il est certain que, si le rythme des percées technologiques le permet, une intégration de composants électroniques moléculaires sera assurément envisagée par les ingénieurs. Enfin, les nanotechnologies pourraient conduire à une redéfinition des fondements de l’industrie de défense, en accroissant la rentabilité des chaînes de production mais en altérant aussi de façon dramatique la structure matérielle des équilibres stratégiques internationaux et la répartition des bassins d’emploi dans le monde.
La perspective de mise en œuvre de nano-usines moléculaires (molecular nano-factory) autonomes serait de nature à réduire à seulement quelques jours ou heures (au lieu de deux ou trois décennies) tout à la fois la conception, la confection et l’expérimentation de systèmes d’armes. Les nano-usines moléculaires réduiraient, selon certains prospecteurs, le coût de développement d’un système finalisé à celui d’un vulgaire prototype. L’édification d’un arsenal ne nécessiterait plus, donc, la possession de vastes installations, pas plus que l’alimentation des activités de fabrication en matières premières en grandes quantités.
Les risques
Janus à deux faces, le secteur des nanotechnologies est aussi de nature à générer, au-delà des problèmes d’ordre sanitaire, de graves questionnements sur des dérives éventuelles que l’on situera, tantôt, dans des perspectives d’emploi incontrôlées, tantôt au travers de conséquences géostratégiques mal anticipées. Ainsi, bien que les Etats-Unis et l’Europe constituent, aujourd’hui, les acteurs dominants de ce secteur de recherches, le haut degré de standardisation sur lequel déboucheront les nanotechnologies permettra, à terme, à tout Etat, voire à tout groupement infra- ou non-étatique (terroriste ou criminel) qui le désire, de disposer d’une panoplie de moyens militaires avancés et aisément reproductibles.
Cette situation sera de nature à réunir les conditions favorables à une nouvelle course aux armements dans laquelle chaque entité politique disposant d’une expertise développée ou acquise sur étagère dans ce domaine - fût-elle momentanée - cherchera à anticiper et à surclasser les moyens de son adversaire - supposé ou avéré. À une échelle globale, les nanotechnologies remettront en cause les fondements sur lesquels s’étaient établis jusqu’alors les équilibres militaires et géopolitiques de la planète.
Ceci est notamment vrai pour les équilibres nucléaires internationaux et régionaux. La dissuasion nucléaire classique repose sur deux présupposés essentiels qui en assurent la stabilité. Le premier suppose que la capacité de destruction totale du tissu socio-économique d’un adversaire appartienne uniquement aux quelques nations les plus technologiquement avancées. Le second élément revient à reconnaître qu’une destruction complète des forces militaires d’un adversaire constitue en soi un objectif impossible à atteindre.
La mise en œuvre de nano-armements nucléaires conduirait à l’obsolescence des éléments fondamentaux des susdits équilibres. Et ceci, de deux façons : tout d’abord, en offrant au plus grand nombre d’acteurs des moyens de destruction sans commune mesure avec les arsenaux existants, et dont l’une des principales propriétés serait de pouvoir se régénérer à l’infini ; ensuite, en conférant à ces mêmes protagonistes des capacités de résistance inégalées face à des risques d’attaque de toute provenance et de toute nature. Les nanotechnologies conduiraient, par conséquent, à relancer une course aux armements dans un monde où les armes nucléaires tendraient à s’établir uniquement comme des capacités d’emploi, et non plus seulement de dissuasion. Toute entité politique convaincue de sa suprématie provisoire en matière de R&D nano-militaire serait ainsi tentée de tirer parti de la conjecture et d’employer l’ensemble de ses forces contre ses adversaires désignés.
De nouveaux régimes de contrôle
Assurément, les différents régimes de limitation et de contrôle des arsenaux conventionnels, chimiques, biologiques et nucléaires, de même que les dispositions en matière de vérification qui y sont contenues, s’avèrent menacées d’obsolescence, tant que des mesures nouvelles, anticipant le rythme de la recherche militaire, ne sont pas imaginées et débattues préalablement. Car il nous faudra, en effet, imaginer des moyens de vérification nouveaux, capables de « traquer » les transferts de nanomatériaux qui, s’ils devaient être aujourd’hui au centre de mesures de surveillance dans l’état présent des techniques qui sont à notre disposition, échapperaient certainement à toute forme de contrôle possible.
Le paradoxe en la matière est que la limitation des risques de prolifération des nanotechnologies pourrait exiger de la part des autorités qui seront, demain, en charge de cette mission, de disposer de traceurs nanométriques avancés. Hors de question, donc, pour un Etat réservé quant aux conséquences sécuritaires et sanitaires des nanotechnologies, de refuser d’inscrire prioritairement sa base scientifique nationale dans ce segment de recherches. Les actions que poseront d’autres acteurs, bien moins scrupuleux, nous condamneront à agir préemptivement, en nous entraînant, selon les termes d’André Lebeau, dans « l’engrenage de la technique ».
43 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








 D’ailleurs, concernant le J-UCAS, il est amusant de voir que le transfert, au mois de septembre dernier, du projet à l’US Air Force a généré un réflexe bureaucratique au sein de l’US Navy qui a obtenu de désigner en son sein un officier comme Directeur du programme. D’ailleurs, c’est, apparemment, les divergences de vues entre les services qui ont conduit à la disolution/scission du programme.
Certains, au sein de la DARPA (infiltrée d’ailleurs par un transhumain) imaginent pouvoir doter de tels systèmes d’un certaine IA. Toutefois, leur vision est tronquée car elle se base sur une approche mécanique(ste) de la nature et de notre biologie (vision héritée de Descartes, scission du corps et de l’esprit). Je vous rejoins donc, il faudra du temps... mais ils voleront et évoluerons de manière autonome (ceci dit, nous pouvons discourir sur l’autonomie).
D’ailleurs, concernant le J-UCAS, il est amusant de voir que le transfert, au mois de septembre dernier, du projet à l’US Air Force a généré un réflexe bureaucratique au sein de l’US Navy qui a obtenu de désigner en son sein un officier comme Directeur du programme. D’ailleurs, c’est, apparemment, les divergences de vues entre les services qui ont conduit à la disolution/scission du programme.
Certains, au sein de la DARPA (infiltrée d’ailleurs par un transhumain) imaginent pouvoir doter de tels systèmes d’un certaine IA. Toutefois, leur vision est tronquée car elle se base sur une approche mécanique(ste) de la nature et de notre biologie (vision héritée de Descartes, scission du corps et de l’esprit). Je vous rejoins donc, il faudra du temps... mais ils voleront et évoluerons de manière autonome (ceci dit, nous pouvons discourir sur l’autonomie).
