Luc Ferry ou la recherche d’un nouvel humanisme
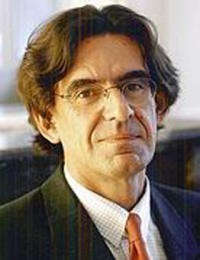
Luc Ferry, ex-ministre de l’éducation nationale, professeur, auteur d’une abondante bibliographie cherche à ré-introduire la philosophie dans les affaires de la cité et la conduite des coeurs. Rien que cela ! A ses yeux la philosophie doit redevenir ce qu’elle était à Athènes, il y a deux mille cinq cents ans : un art de vivre et de mourir. Autrement dit une école de sagesse. Pour ce faire, rien n’est plus fécond que de se plonger dans les grands mythes qui sont à la source du " miracle grec ".
Au commencement était les mythes - nous dit-il. Ce sont des histoires littéraires, bien sûr, mais qui tentent toutes de répondre à une question philosophique fondamentale, celle de savoir ce qu’est " une vie bonne" pour les mortels. La mythologie grecque va ainsi préformer l’interrogation philosophique la plus fondamentale, celle qui va de Parménide aux stoïciens, en passant par Platon et Aristote.
L’expression " vie bonne" renvoie à une interrogation qui n’est pas seulement morale, mais qui touche à la question du sens. Il ne s’agit pas tant de respect de l’autre que de chercher le sens de la vie pour des êtres qui vont mourir et qui ont peur de la mort. L’idée qui va dominer la mythologie et que la philosophie va reprendre quasi intégralement, c’est celle qui vient de la Théogonie d’Hésiode. Hésiode raconte la naissance des dieux, puis la guerre que deux générations de dieux vont se livrer. La première, composée par les Titans, dieux violents et guerriers, la seconde qui réunit les Olympiens, fils des Titans, conduite par Zeus. Les Olympiens vont faire la guerre aux Titans pour établir un partage juste et paisible du monde. A Gaïa reviendra la terre, à Ouranos le ciel, à Poséidon la mer etc. Ce qui va naître alors dans l’espace intellectuel, culturel, moral et même métaphysique grec est l’idée de cosmos, c’est-à-dire l’idée que l’univers tout entier n’est plus un chaos, mais qu’il est au contraire harmonieux, juste, beau et bon. C’est cette idée de cosmos qui permet de répondre à l’interrogation sur " la vie bonne". Le sens de la vie va se définir comme la mise en harmonie de soi. C’est le sens de la quête d’Ulysse. Que fait-il, sinon chercher à regagner sa place dans l’ordre cosmique. Il a été déplacé par la guerre de Troie, il va mettre vingt ans à retourner chez lui, dans son lieu d’origine, Ithaque, afin de se réajuster à l’ordre du monde, tout simplement. Car, au fond, que disent les stoïciens ? Qu’une vie réussie, c’est une vie en harmonie avec l’ordre cosmique. D’où les trois pans de leur philosophie. D’abord, la théorie, qui est la contemplation du monde pour déterminer où se trouve notre place. Ensuite, la morale, qui est l’ajustement à cet ordre du monde. Enfin, la question du salut : qu’est-ce qui nous sauve de la mort ? Ce message formulé rationnellement par les stoïciens, c’est celui que l’on retrouve avec des accents encore cultuels et religieux, dans les grands mythes fondateurs grecs que sont l’Odyssée et la Théogonie.
Lorsque Zeus gagne la guerre contre les Titans, il fait apparaître que le monde est un ordre cosmique harmonieux, juste et beau. Ce monde est divin, en ce sens que nous, les humains, ne l’avons pas créé nous-mêmes. Mais ce divin-là n’est pas incarné dans une personne comme dans le Christianisme ; il est la structure anonyme et aveugle du monde. La première rupture, que le Christianisme instaure par rapport au divin grec, réside dans l’incarnation. Cette rupture va tout changer, et la problématique de la morale et la problématique du salut, puisque ce divin, incarné dans la personne du Christ, ne sera plus appréhendé par la raison, d’où la mort de la philosophie, si l’on peut dire, mais par la foi, fides, la confiance.
L’autre rupture est l’idée moderne d’égalité que pose le Christianisme. Et aussi d’humanité. On va inventer en même temps l’idée moderne d’humanité et la valorisation du travail. C’est la parabole des talents qui raconte l’histoire d’un maître qui part en voyage et confie des sommes d’argent à ses trois serviteurs. Losqu’il revient il demande des comptes. Que signifie cette parabole ? Simplement une rupture radicale avec le monde aristocratique pour lequel ce qui fait la dignité d’un être, c’est ce qu’il a reçu au départ, à savoir les talents ou les dons naturels. L’aristocrate est bien né, ou bien doué. Il y a une hiérarchie naturelle des êtres. Ce que la parabole des talents introduit est l’idée que ce qui fonde la dignité est non ce que l’on a reçu mais ce que l’on a fait. La liberté plutôt que la nature. Du coup, on invente à la fois l’idée d’humanité, l’idée d’égale dignité des êtres et la valorisation du travail.
Une nouvelle étape est franchie. Mais celle qui est la plus importante selon moi - poursuit Luc Ferry - après la réconciliation des grecs et des chrétiens, c’est la révolution qui a eu lieu au XIIe siècle où se pose l’idée qu’il faut désormais explorer la nature par la raison. Pourquoi : parce que la splendeur de la nature en tant que création divine doit porter les traces de la divinité du créateur. Elle ne peut pas être l’effet du hasard. Il n’y a plus alors de raison pour que raison et foi se contredisent. On trouve déjà là le thème qui sera cher à Pasteur qu’un peu de science éloigne de Dieu, mais que beaucoup nous y ramène. Ce qui sera repris dans l’avant-dernière encyclique de Jean-Paul II - Fides et ratio - foi et raison.
D’une certaine façon, il est visible que la modernité n’est jamais parvenue à saper le christianisme. Il y a aujourd’hui dans le monde à peu près 2 milliards de chrétiens. S’il y a une déchristianisation en Europe, elle est néanmoins à relativiser. Car si la quantité a diminué, la qualité a augmenté. Il y a aujourd’hui plus de chrétiens de conviction que d’habitude. Mais ce qui se passe, tout particulièrement avec la révolution scientifique des XVIIe et XVIIIe siècles, c’est que les dogmes chrétiens, notamment les arguments d’autorité, vont être plongés dans un acide, celui des Lumières et de l’esprit critique auxquels ils ne résisteront pas : du moins pas entièrement.
Cela se fera en deux temps : d’abord de Descartes à Hegel et avec les Lumières, qui sont pour une bonne part, une sécularisation de la religion chrétienne ; puis avec la philosophie contemporaine, de Schopenhauer jusqu’à Heidegger, qui coïncide avec une sécularisation de cette première sécularisation. On peut le voir chez Nietzsche dans ce qu’il appelle la critique du nihilisme.
Mais une fois que l’on a tout déconstruit, que reste-t-il ? Eh bien ce qui va apparaître n’est rien de moins que la sacralisation de l’humain, qui n’est pas pour autant idolâtrie, mais la conviction que les seules raisons qui méritent que l’on risque sa vie ne sont plus Dieu, la Patrie ou la Révolution, mais bien les êtres humains eux-mêmes. Le sacré s’incarne dorénavant dans les proches, et aussi le prochain qui est le contraire du proche, celui qu’on ne connaît pas, comme en témoigne l’humanitaire. Nous assistons à l’émergence d’un sacré à visage humain qui requiert une spiritualité d’un autre type. Lequel ?
La philosophie, disait Hegel, c’est notre temps saisi par la pensée. Notre époque appelle un humanisme d’un genre nouveau. Non plus l’humanisme des Lumières, de Voltaire et de Kant, qui était un humanisme de la raison et des droits, mais un humanisme du coeur et de la transcendance de l’autre. Bref, de l’amour. Nous vivons un tout nouvel âge de l’humanisme. C’est une révolution comme il en arrive peu, peut-être une fois tous les mille ans.
Voici la thèse que soutient avec talent un philosophe que je respecte infiniment, mais qui me paraît être trop optimiste, hélas ! Car notre époque ne dessine pas le visage de cet humanisme du coeur et de la transcendance, à l’heure où rarement la violence n’a été aussi présente, ni l’égoïsme si habituel, ni le goût du profit si prononcé. Et l’on sait d’autre part que l’humanitaire, sous des dehors très estimables, n’est pas toujours dénué d’intérêts moins avouables et que le droit d’ingérence conduit le plus souvent à la catastrophe. Finalement, à écouter ce très sympathique philosophe, nous ne ferions rien d’autre que de revenir au vieux précepte chrétien : aimez-vous les uns, les autres. Mais cela fait vingt siècles que l’on s’y emploie sans grand résultat.
De Luc FERRY à lire :
La sagesse des mythes chez Plon
La tentation du christianisme (avec Lucien Jerphagnon) chez Grasset
Quel avenir pour le christianisme (avec Philippe Barbarin) chez Salvator
24 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON











