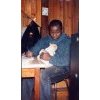Certains mots sont-ils dangereux ?
Je rapporte un échange avec mon père. Les mots sont beaux. Utilisés sciemment, ils parlent et révèlent de belles choses. Aujourd’hui, Les mots que nous entendons bien souvent font froid dans le dos. Les personnes qui écoutent, voire entendent ces mots prennent-ils le temps de les analyser ? Comprennent-ils la teneur ? J’ajoute : ATTENTION ! LES MOTS SONT DANGEREUX.
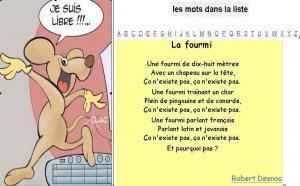
La population cible
Une expression est devenue à la mode depuis plusieurs années qui est vraiment étonnante si on prend le temps d’y réfléchir : les « populations-cibles », dont parlent couramment les économistes et les développeurs. Cherchons dans le dictionnaire la définition originelle du mot « cible » : « objet servant de but pour le tir des armes de jet ou des armes à feu ». Mon père qui me dit : Personnellement, je sursaute chaque fois que j’entends l’expression « population-cible » : l’image qui me vient immédiatement à l’esprit est celle de condamnés attachés à des poteaux face à un peloton d’exécution ; moins tragiquement, je repense aussi aux exercices de tirs du service militaire : couchés face à des silhouettes humaines situées à 200 mètres, nous recevions l’ordre suivant : « sur les cibles correspondants à vos numéros, de la droite à la gauche numérotez-vous ! » et chacun nommait sa cible. Peut-être direz-vous que j’exagère : c’est une façon de parler ; il ne faut pas prendre les mots au pied de la lettre... Je suis d’accord. Mais je pense que les mots ne sont pas neutres ni innocents ni inoffensifs ; les images ont une force ; elles véhiculent des idées dans nos têtes ; celles-ci modifient, inconsciemment, nos comportements et nos attitudes. Quand je dis « population-cible », même s’il n’y a aucune idée meurtrière dans ma tête ni dans ma conduite, il est tout de même probable que lesdites populations seront traitées, plus ou moins, comme des objets, passifs et incapables d’initiative, à défaut d’être des condamnés. En tous cas, je vois mal une « population-cible » se lever pour prendre son destin en main. Ou alors, il faut la nommer autrement.
La descente sur le terrain
Prenons un autre exemple : quand vous dites : « descente sur le terrain », ce n’est pas une image physique que vous évoquez ; le terrain peut même se situer plus haut que la ville. En parlant ainsi, sans le savoir, vous exprimez toute la supériorité plus ou moins méprisante de la ville sur la campagne, de l’administration sur les paysans, des citadins sur les ruraux. Comment voulez-vous alors lutter contre l’exode rural ? Tout le monde ne regarde-t-il pas vers le haut ? Plus grave, cette image de supériorité se traduira inévitablement dans vos comportements sur le terrain : vous regarderez forcément de haut les gens d’en bas que vous êtes descendus voir.
Mais revenons au mot « cible ». Evidemment, il est emprunté au langage militaire ; mais il n’est pas le seul. Depuis quelques décennies, - depuis la guerre de 40 peut-être qui a vu le triomphe des armées ? - nous assistons à une véritable contamination de la société civile par le vocabulaire militaire. Et cela non plus n’est pas neutre, j’allais dire inoffensif. Sans que personne ne l’ait décidé, il y a une espèce de « mise au pas » de la société civile : comme les soldats, il faut « marcher au pas ». A l’armée, les valeurs dominantes sont l’efficacité et les résultats ; assortis de la technique et des moyens pour y parvenir, souvent au détriment des hommes et de la société. Un militaire n’a pas d’état d’âme : cela paralyserait son action. A côté du courage et de la bravoure des soldats, il y a les innombrables bavures pour ne pas dire plus. Aujourd’hui, c’est toute la planète qui est mise au pas d’un ordre économique dominant dans un climat de guerre économique.
Le langage militaire investit tous les champs de la langue
En particulier, la contagion militaire a envahi tout le vocabulaire du domaine des moyens et des fins. Prenons quelques exemples. Les hommes n’ont pas attendu l’armée moderne pour donner des buts ou des fins à leurs actions ni pour expliquer l’organisation des causes et des moyens : les philosophes grecs, en particulier Aristote, ont composé des traités toujours actuels sur ces questions.
Mais maintenant, un seul mot s’impose : objectifs ; globaux, finaux, intermédiaires, opérationnels, tous les qualificatifs que vous voudrez ; en tous cas, dans le domaine du développement, si vous ne parlez pas d’objectifs, vous n’êtes pas à la page ; à la limite, vous risquez de ne pas être pris au sérieux.
Auparavant, la méthode était le choix et l’organisation des moyens en vue d’atteindre un but ou une fin ; maintenant, il n’est plus question que de stratégie.
Le résultat d’une action ne se mesure plus aujourd’hui qu’en termes d’impact.
Désormais, on ne stimule plus, on n’encourage plus les gens à réaliser ce qu’ils veulent faire ; c’est dépassé ! Non, on les mobilise (définition du dictionnaire : mettre sur pied de guerre des forces militaires).
Ce qui complique encore les choses, c’est qu’on continue à utiliser le vocabulaire ancien en même temps que toute la panoplie militaire moderne qui signifient souvent la même chose, mais simplement appliqués à des domaines différents. Du coup, des acrobaties de définitions pour distinguer : finalité, but, mission, objectif final... ; stratégie et méthode... Ce qui évidemment ne simplifie pas les explications et la communication avec les fameuses « populations-cibles ».
Sans doute, on va nous dire que nous jouons sur les mots, que nous pinaillons, que tout cela n’a pas d’importance ; l’essentiel étant le résultat... Nous ne souhaitons pas engager une bataille de vocabulaire (qui nous amènerait, malgré nous, sur un terrain militaire). Nous voulons seulement attirer l’attention du lecteur sur la force que portent les mots et les images : justement, ils peuvent, malgré nous, nous conduire à un autre résultat que celui que nous voulions atteindre.
Marolleau Jean Louis - Label Ngongo Antoine
25 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON