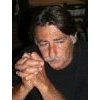Energie atomique : de la chimère à la démesure

Pierre Simon de Laplace, qui révolutionna la mathématique en son temps par la Théorie analytique des probabilités, soulignait toujours que celles-ci, même si elles arrivaient à cadrer la régularité d’un phénomène, elles n’en étaient pas moins dépendantes d’une ou de plusieurs constantes aléatoires, d’une équation imprévue ou inconnue. Certes, le calcul des probabilités peut prévoir, mais uniquement ce qu’il intègre. En ce sens, la quête du savoir reste un processus d’intégration de nouvelles variables dans un calcul jamais terminé. Or la vision prométhéenne du monde, celle qui nous régit, a tendance à considérer le connu comme définitif et à sous-estimer ce qu’il ne connaît ou n’intègre pas volontairement.
Ce qu’il ne connaît pas est connu. Des centaines de milliers de chercheurs ajoutent, chaque jour, leurs découvertes issues de l’inconnu.
Ce qu’il n’intègre pas ce sont ce que Laplace lui-même définit comme les inconvénients du changement. C’est-à-dire tout ce que le domaine de l’inconnu perturbe notre fonctionnement. Tout ce qui est considéré comme convenant à notre vie, à nos habitudes, à nos certitudes et nos intérêts.
Lorsque par exemple le président de la République et la patronne d'AREVA exhibent leur tropisme de marchands de tapis pour indiquer que, face à une catastrophe imprévue, ce qu’il y a de mieux à faire c’est de vendre un produit intégrant plus de variables que celui des concurrents, ils refusent d’intégrer les équations imprévues ou inconnues, ils déterminent les variables au sein d’une connaissance finie. Où plutôt, ils tordent la théorie analytique des probabilités en fonction du rythme des résultats de la recherche existante et non pas ceux de la recherche pure, c’est-à-dire celle qui prend en compte l’inconnu.
Cependant, le désastre japonais est dû non pas à une malversation ou un refus de modernisation technologique, ou même à un mauvais calcul des probabilités mais, justement, au refus de prendre en compte la fraction, la variante inconnues, voire l’improbable. S’agissant d’un processus, les variables improbables seront toujours là, quel que soit le calcul ou les mesures de protection, et leurs combinaisons resteront innombrables. Aussi bien du domaine du connu que de l’inconnu.
L’esprit prométhéen étant ce qu’il est, moins on sait et plus on est sûrs de son savoir et des décisions qui en découlent. Ce n’est qu’à la fin de sa vie que Socrate avait probablement (sans jeu de mots) dit : je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ainsi, toute décision stratégique, impliquant le long terme, devrait être remise en cause en tant que telle, de manière périodique, à la lumière des savoirs émergeant. Toute crise, qu’elle soit énergétique, financière, économique ou sociétale devrait participer à une mise en cause radicale de ces décisions et ne pas se limiter aux applications épiphénoménales qui en découlent.
On peut aisément admettre que la décision du « tout nucléaire », prise à peine quelques années après la fusion de l’atome était cohérente. Elle participait à la fascination d’un exploit scientifique qui non seulement avait conclu, de manière effroyable, la seconde guerre mondiale, mais laissait entrevoir la toute puissance de l’homme dans sa quête d’énergie. L’aspect métaphysique n’était pas non plus absent : la fission de l’atome entrouvrait une porte vers l’inconnu maîtrisable, vers le contrôle absolu de la mort mais aussi, à travers la théorie de la relativité, de l’histoire de la vie elle-même.
La guerre la plus dévastatrice que l’humanité ait connue paraissant comme terminée par une prouesse technologique, il était naturel que l’homme ait confiance en celle-ci pour résoudre dans le proche futur les problèmes connus (stockage des déchets radioactifs par exemple) mais aussi inconnus. En effet il semblait à l’époque que ces derniers, concordaient aux rythmes de la recherche pure, étant donné la fascination déformante générée par l’accumulation vertigineuse des découvertes et de leurs applications. Mais, ces certitudes remplaçant la réalité, réalité que Hegel définit déjà comme quelque chose qui peut paraître mais qui n’est pas en soi et pour soi réel, ont été ébranlées par le fait même du progrès technologique.
Ce n’est pas contradictoire d’affirmer que les avancées technologiques ouvrent chaque jour un peu plus le domaine de l’inconnu mais aussi et surtout la perception plus généralisée de ce dernier. Ainsi, ce qui, hier encore, était une chimère, devient aujourd’hui une hubris. Tout comme l’homme soviétique, the american way of life, l’homme unidimensionnel si critiqué par Marcuse, ou, sur un autre registre, la très belliqueuse conquête de l’espace, pourtant immensément plus vaste que les steppes russes. Car après tout, et en suivant le raisonnement de Laplace, rien n’exclut la réapparition des irruptions volcaniques aux trapps sibériens, responsables à la fin du Permien de la quasi disparition de la vie sur terre. Ce dernier exemple, est justement le résultat de l’avancée des sciences qui expliquent ce cataclysme par l’action de la Terre elle-même et non pas par des causes exogènes (en l’occurrence un météorite), si chères à l’entendement humain.
Ce n’est pas tant la gestion mercantile et ses aléas qui sont responsables du manque de mesure. L’esprit mercantile a de tous temps été un vecteur de communication et d’échanges (certes inégaux la plupart du temps). C’est plutôt le culte de l’immédiateté, la contraction du temps, l’impossibilité d’attendre les conquêtes sur l’inconnu et de vérifier celles du connu. C’est l’abandon de l’anticipation comme élément constituant de la gouvernance, la sublimation du résultat aux dépens des moyens, qui créent un espace dangereux entre le connu et l’inconnu. Lorsqu’on privilégie le parc de centrales nucléaires existant comme unique objet de l’espace de la recherche et comme argument pour son développement et son exploitation commerciale, on est même plus dans le domaine du possible. Car aujourd’hui, et suivant les progrès technologiques réels et à venir, ce qui existe ne sera plus : L’unique se devra multiple, ce qui était simple évoluera en complexe. Ces variables, scientifiques, économiques et de gestion, font partie du domaine du connu. Seules des certitudes frileuses, des intérêts visant l’immédiat et des arrière-pensées a-historiques peuvent expliquer que l’on ne les prend pas, ces possibles, en compte.
57 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON