Sauver la filière littéraire ? dit-il. Qu’on cesse d’abord de la détruire !
Sauver la filière littéraire est un des objectifs que le Président de la République assigne à sa réforme du lycée présentée à l’Élysée, mardi 13 octobre 2009. La série L ne compte, en effet, que 16,6 % des bacheliers généraux. Et pour la rendre attrayante, le chef de l’État préconise de renforcer l’apprentissage des langues, de développer un enseignement culturel artistique de haut niveau et même d’y introduire l’enseignement du droit. Soit ! Pourquoi pas ?
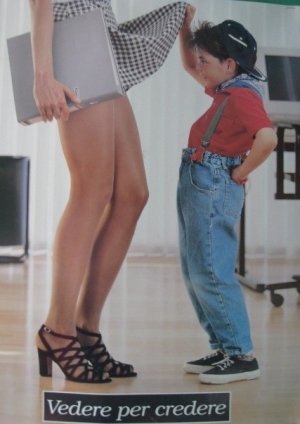
Une société dite de l’information
Il est singulier qu’on ne s’interroge pas sur le paradoxe que constitue cette désaffection dans une société appelée « la société de l’information ». Que l’on sache, par quoi transite cette information, en dehors des silences, sinon par les mots et les images ? Or quel enseignement est réservé à cette "information par le mot et l’image" depuis l’École primaire ? Comme si cet apprentissage pouvait se faire sur le tas ! C’est en ignorer la complexité ! Et le temps de l’apprendre par sa propre expérience…, il est déjà trop tard !
On voudrait ici justement livrer sa propre expérience qui vaut proposition, puisque l’on a vécu, à la fois comme élève et professeur, au cours de ces quarante dernières années, cette montée en puissance du siège médiatique que nulle société n’a connu par le passé, et pour cause : la puissance phénoménale des moyens de diffusion et de réception de l’information est une donnée caractéristique de l’époque contemporaine.
Le traitement de texte traditionaliste
Jusqu’à cette irruption médiatique qu’on situe dans les années 60 et dont le développement prend son ampleur dans les années 70, qu’enseigne l’École sous l’appellation « littéraire » ? Une copie laïque conforme du vénérable traitement de texte religieux pratiqué depuis des siècles par les religions monothéistes avec l’art de l’exégèse et celui de la glose. On peut l’appeler « le traitement de texte traditionaliste ». Le fameux manuel « Lagarde et Michard », du nom de deux inspecteurs généraux plus avisés en affaires qu’en analyse de l’information, en est le symbole.
Ce traitement de texte traditionaliste apprenait à se soumettre, dans le commentaire de texte et la dissertation, à l’argument d’autorité et à lui seul. La parole du poète avait beau avoir remplacé celle du prophète, elle ne souffrait pas davantage d’être contestée. Elle s’imposait en majesté. On la mémorisait pour pouvoir la citer et clore péremptoirement le débat factice imposé. Les Classiques, découpés à l’École comme à l’étal en « morceaux choisis », avaient remplacé la Bible et les Pères de l’Église, mais ils servaient à inculquer la même prosternation.
Ce traitement de texte traditionaliste se caractérisait, en outre, par l’usage récurrent de procédés de séduction dont l’inconscient apprentissage n’était pas moins contestable que la représentation arbitraire des textes qu’ils permettaient d’inculquer : ainsi un parti pris hagiographique et une édulcoration des conflits, des enjeux et des débats du passé étaient-ils enseignés sous l’empire de l’argument d’autorité, de la mise hors-contexte et d’un tri générateur d’omissions (1).
Le traitement de texte moderniste
À la faveur de l’envahissement du siège médiatique, a été progressivement introduit, à la fin des années 80 ce qu’on peut nommer, par opposition au précédent, « un traitement de texte moderniste », sous prétexte de tenir compte du bouleversement que les médias provoquaient dans la vie de chacun, en se jouant du temps et de l’espace.
Ce nouveau traitement de texte qui s’est implanté surtout à partir des années 90, puise ici et là aux différents courants de la linguistique qui règne pourtant depuis les années 60 à l’Université. Benvéniste voit sa « théorie de l’énonciation » inspirer l’enseignement du français dans le Secondaire. Les élèves doivent se mettre en bouche un jargon qui a fini tardivement par horrifier quelques esprits intelligents, comme Erik Orsenna. « Déictiques », « connecteurs temporels et logiques », « texte ancré ou non ancré » ne peuvent plus être ignorés des élèves de 3ème. C’est aussi l’époque où, dans la foulée des diverses fonctions du langage de Roman Jakobson, débarque l’absurde typologie des « discours » « narratif », « descriptif », « explicatif », « argumentatif », et même « informatif » qui structurent l’apprentissage par année ! Un certain Alain Boissinot s’en fait le champion dans son manuel paru en 1989 et baptise « le texte informatif » « texte d’exposition » !
Que ce fameux « texte informatif » n’existe pas, personne ne se soucie de le vérifier. C’est que conjointement, depuis 1982, après la création du CLÉMI – Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (2) – réunissant à parité des représentants des médias et des membres de l’Éducation nationale, « la théorie promotionnelle de l’information diffusée par les médias » est reprise avec toutes ses erreurs grossières et enseignée les yeux fermés par l’École. On en voit le résultat aujourd’hui aux scores d’audience des émissions les plus imbéciles de TF1 et consorts !
L’exploration d’un enseignement dans « le grand livre du monde »
Comme professeur, on prend très vite conscience des incohérences, des contradictions et des erreurs de l’enseignement qu’on est pourtant sommé de dispenser : elles éclatent moins comme une grenade que comme le vernis d’un vieux tableau qui s’écaille et s’émiette. Mais ce n’est que peu à peu au fil des ans, de ses propres intolérances ou des réticences de ses élèves, que l’on a lentement, patiemment identifié ce qui « ne tenait pas » ou « ne collait pas ».
- L’information comme plateforme centrale et ligne de partage des eaux
C’est ainsi qu’on en est venu à élaborer une théorie de l’information qu’on voulait la plus expérimentale possible autour de laquelle organiser l’enseignement du Français (3). Car
- soit on enseignait aux futurs citoyens qu’ « une information est un fait », comme s’y employait l’École, engluée dans la bulle du nouveau formalisme linguistique, tout en reprenant à son compte « la théorie promotionnelle de l’information diffusée par les médias de masse », et l’on inculquait alors la crédulité, la naïveté, la docilité et la soumission aveugle à l’autorité que l’on attend d’un sujet ;
- soit on apprenait qu’ « une information est la représentation d’un fait » et, dans ce cas, « le doute méthodique » de Descartes devait être la règle de conduite pour la formation et l’expression libres d’une opinion de citoyen.
- Les Classiques comme guides
Et les Classiques devenaient des guides de référence. Car qui a le mieux réfléchi à l’information, même si le mot n’était pas à la mode à leur époque, qu’un Montaigne, un Pascal, un Molière, un Fontenelle, un Montesquieu, un Voltaire, un Diderot, un Beaumarchais, un Flaubert, un Hugo, etc. Qu’on prenne les fables de La Fontaine ! Existe-t-il manuel plus approfondi d’une théorie expérimentale de l’information ? Tout est dit dès la première fable, « La Cigale et la Fourmi », choisie pour ouvrir le recueil : on y trouve une illustration magistrale du « principe fondamental de la relation d’information » : nul être sain ne livre volontairement une information susceptible de lui nuire. Mais est-ce bien ce qu’enseigne l’École ? Quant aux leurres, les fables en livrent un arsenal assez fouillé ! Il n’y a guère que le leurre d’appel sexuel qui soit négligé, ce qui est tout de même paradoxal de la part d’un La Fontaine, auteur de contes libertins… (4)
À ces Classiques se sont fort logiquement associés les travaux de chercheurs en psychologie sociale comme Solomon Asch sur la soumission à la pression du groupe (1953/1955), comme Stanley Milgram sur la soumission à l’autorité (1960/1963) ou ceux de Paul Waztlawick et de l’École de Palo Alto.
- L’information par l’image
Le Cinéma, de son côté, offrait la possibilité de raccourcis extraordinaires pour un travail collectif : on peut mettre pendant deux heures une classe devant un film, comme « I comme Icare » d’Henri Verneuil, « Z » de Costa-Gavras, « Coup de tête » ou « Le nom de la Rose » de Jean-Jacques Annaud, mais pas devant un livre. Il va de soi que « l’information par le mot » appelait parallèlement « l’information par l’image » : elles obéissent toutes deux aux mêmes contraintes.
* Les sites archéologiques de Campanie
Les cours de Latin ne se concevaient plus sans une découverte de la société où il se parlait : et le moyen le plus pédagogique était une initiation à l’archéologie avec apprentissage sur les sites même de Provence et pour finir sur ceux de Campanie, Pompéi, Herculanum, Paestum, Boscoreale, Cumes, etc. On y découvrait comme ces sociétés gréco-romaines étaient des sociétés où l’image était reine pour maîtriser les esprits : peintures et sculptures y sont omniprésentes.
* Venise
S’est alors imposé le maillon historique manquant entre la Grèce et Rome, d’une part et, d’autre part, la société contemporaine qui en est issue autant par ses qualités que par ses tares : le voyage à Venise est apparu comme la meilleure illustration toujours disponible aujourd’hui d’une ville-État où pendant dix siècles l’image a été le médium essentiel du gouvernement de la Sérénissime. Connaît-on le tympan de la basilique San Marco où des marchands vénitiens enlèvent au nez de douaniers musulmans égyptiens qui, dégoûtés, se le bouchent ou s’en détournent, les restes de Saint Marc cachés sous des couches de viande de porc ? Et les groupes sculptés donc aux angles du Palais des doges, l’ivresse de Noé, le péché originel, le jugement de Salomon ? Et, dans l’Église des Frari, la famille du doge Pesaro agenouillée dévotement, à l’exception d’un gamin distrait, devant la Vierge, peinte par Le Titien ? Et « Le repas chez Lévy » de Véronèse, au Musée de l’Accademia, qui lui a valu les foudres de l’Inquisition ?
La passion des élèves et l’hostilité de l’administration
Pendant toutes ces années d’ un enseignement qui tournait radicalement le dos au formalisme des instructions officielles conduisant, de leur côté le cas échéant, à inhiber toute réflexion jusqu’à proposer comme sujet d’examen un éloge de la xénophobie, de la vengeance privée, voire des exécutions pour l’exemple en 14/18, qu’a-t-on observé chez ses propres élèves ? Un intérêt, une passion et un investissement incroyables, y compris chez les moins motivés au départ. Benjamins et cadets dans les familles suivaient avec entrain les pas de leurs aînés. La dernière promotion a voulu, à l’insu de son professeur, faire partager son enthousiasme et en laisser trace sur Internet. en 2004. On peut consulter un succédané humoristique de ses travaux aux liens ci-dessous (5) (6).
On a tenu ainsi quinze ans, jusqu’à ce qu’un chef d’établissement, parfaitement inculte et malhonnête, en septembre 2003, s’emploie à tout détruire… pour faire plus de place au sport (7), dans un contexte de destruction du Service public conformément à la méthode du rapport de l’OCDE de 1996, intitulé, « La faisabilité politique de l’ajustement » en vue d’une prochaine privatisation.
On a bien tenté de résister avec les élèves et les parents. Mais c’est sans espoir face à une administration-voyou, du chef d’établissement jusqu’à l’administration centrale, en passant par l’inspectrice pédagogique, l’inspecteur d’académie et le recteur. Ils usent de tous les moyens pour détruire celui qui les gêne, y compris de l’emploi frauduleux des sanctions. On a reçu en 2004 un blâme que le tribunal administratif a annulé comme illégal deux ans et demi après en décembre 2006 : les fautes de service imputées étaient… imaginaires et la procédure avait été violée (8) ! Une administration-voyou n’a que faire de l’honnêteté et du droit ! Mais c’était trop tard ! On n’avait pas attendu ! Écoeuré, on avait préféré fuir cette jungle bien avant.
Et on se demande toujours pourquoi la filière L est si peu attractive ? De qui se moque-t-on ? L’administration de l’Éducation nationale en connaît parfaitement la raison : elle s’emploie à la détruire méthodiquement depuis des années ! Paul Villach.
(1) Paul Villach, « Les infortunes du Savoir sous la cravache du Pouvoir », Éditions Lacour, Nîmes, 2003.
(2) Comme s’il existait des médias qui ne livrent pas d’informations !
(3) Pierre-Yves Chereul, "Le Code de l’information", Éditions Chronique sociale, Lyon, 1989.
(4) Pierre-Yves Chereul, « Les médias, la manipulation des esprits, leurres et illusions », Édition Lacour, Nîmes 2006.
(5) Voyage en Campanie : http://campanie-2004.skyrock.com/1.html
(6) Voyage à Venise : http://venise-2004.skyrock.com/1.html
(7) Parmi les astuces pour empêcher l’élève de faire du Latin : l’interdiction de cumuler latin et Natation, l’impossibilité de faire Allemand et Latin, puisque les cours ont lieu aux mêmes heures, etc.
(8) Pierre-Yves Chereul, « Un blâme académique flatteur », Éditions Lacour, Nîmes, 2008.
74 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








 .
.
