Le paradoxe français du moi et du nous
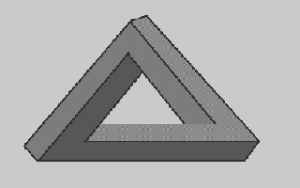
Depuis quelques années, nous sommes confrontés à une révolution conservatrice qui exprime la fin des certitudes des citoyens sur leur avenir. Les manifestations contre le CPE ne sont que l’épiphénomène du nouveau mal français. L’embrasement dans les banlieues n’est que le révélateur du désarroi d’une partie de la population. Les résultats du premier tour de la présidentielle de 2002 ne sont que le symptôme d’une incompréhension entre les citoyens et les politiques.
Le caractère français n’est pas étranger à ces difficultés. Nous sommes collectifs dans la pensée, individualistes dans les comportements. Mais le monde a changé. Arrêtons de nous illusionner sur une « certaine idée de la France », héritée des années soixante. Nous sommes engagés dans une compétition mondiale entre les entreprises, mais aussi entre les territoires. La concurrence s’exprime aujourd’hui entre les continents, les pays, les régions, les villes et même les quartiers. Un État n’a plus les moyens de garantir la solidarité et l’équité à tous les niveaux de la société, comme dans une économie fermée.
Par manque de réalisme, la France, cinquième puissance économique mondiale, pourrait faire faillite à moyen terme par la simple perte de ses entrepreneurs. « Mon fils, si tu ne fais pas bac plus cinq dans une excellente école, t’es foutu ! ». C’est cette idée qu’il faut détruire. Elle a conduit 250 000 jeunes Français, diplômés et non diplômés, à Londres, pour entreprendre. Au pays de Voltaire et de Rousseau, on continue à juger les gens sur ce qu’ils sont et non sur ce qu’ils font.
Alors, sommes-nous engagés sur le chemin du déclin ou du renouveau ? Comment transformer cette période de doute, de pessimisme, en opportunité pour adapter la société française aux enjeux de la mondialisation ? Tous les responsables politiques ou économiques réalistes font le constat d’une société bloquée, mal préparée à l’économie mondiale et cristallisée sur un modèle social hérité de l’après-guerre et complètement obsolète. Ce serait une erreur de trop s’inspirer de modèles élaborés dans d’autres environnements culturels. Par exemple, le modèle danois de la flexisécurité est intéressant, mais inapplicable tel quel, pour des raisons évidentes de financement actuel du système de protection social français.
Cependant, sans adaptation rapide du modèle français à la nouvelle donne internationale, le transfert d’activités et de richesses va s’accélérer. Une diminution du dynamisme économique entraîne mécaniquement la disparition d’emplois. À force de repousser les réformes fondamentales, celles-ci deviennent plus difficiles à réaliser et à accepter. Les citoyens préfèrent garantir leurs intérêts particuliers à très court terme plutôt que de privilégier l’intérêt général à moyen terme.
Il ne s’agit pas de retirer des droits aux salariés, jeunes et moins jeunes, mais de les déplacer sur les parcours professionnels et personnels. Une approche psychologique simple peut nous aider à mieux comprendre les situations sociales actuelles. C’est le principe des 3M : tout individu a besoin d’un minimum de sécurité, d’un minimum de reconnaissance, d’un minimum d’avenir. L’évolution de la société a, peu a peu, dilué ces minimums vitaux qui conditionnent le désir d’agir de chaque être humain dans le mille-feuilles de l’inefficacité des politiques publiques.
1) Un minimum de sécurité pour vivre ! Personne ne peut vivre dans un sentiment d’insécurité permanente. Même les caractères ambitieux, entreprenants, individualistes, ont besoin de solidarités collectives pour s’accomplir. À l’inverse, les sociétés humaines ne sont pas obligées d’abandonner les plus faibles. Alors, pourquoi en donner le sentiment, avec les banlieues ou le CPE ! L’État français ne répond plus de manière satisfaisante à son rôle protecteur pour un nombre croissant de citoyens.
2) Un minimum de reconnaissance pour survivre ! Personne ne peut vivre sans la reconnaissance de son utilité sociale et familiale. Le mot le plus souvent entendu, pendant la crise des banlieues, c’était le respect. Beaucoup de salariés ont le sentiment de ne plus être utiles à leur entreprise puisque ce n’est pas un problème de délocaliser. Les entreprises françaises ne valorisent pas assez leurs salariés et ne reconnaissent pas assez le potentiel de ceux qui souhaitent l’intégrer, notamment des jeunes.
3) Un minimum d’avenir pour entreprendre ! Si en 1995 l’ascenseur social était en panne, aujourd’hui même l’escalier est très difficile à emprunter. À court terme, les réformes sociales seront douloureuses pour les plus fragiles. Mais ne pas les faire détruirait le modèle social actuel, qui précisément les protège. La dimension psychologique de l’économie est essentielle pour comprendre les comportements des dirigeants, des consommateurs, des salariés. Chacun devrait avoir l’envie de réaliser un projet professionnel, personnel ou social.
Le raisonnement cartésien appliqué à l’action publique montre aujourd’hui ses limites. L’accumulation de lois, de décrets, de dispositifs, de structures, etc., anéantit les effets attendus des moyens publics. Plus aucun citoyen ne comprend la volonté des gouvernants. C’est le moment de refonder en France un contrat social sur la base de ces 3M pour pouvoir entreprendre enfin les réformes économiques vitales et incontournables. C’est le paradoxe français du moi et du nous : « Les autres doivent changer, je les y encourage vivement, quant à moi... ! ». Les blocages sont autant dans les structures sociales que dans les têtes.
Peut-on sortir de cette situation par le haut ? Oui, sans doute. Les démocraties modernes qui nous entourent privilégient le contrat ou la négociation. A minima, un dialogue social doit s’engager sur la flexibilisation des postes de travail et la sécurisation des parcours professionnels. Mais les réformes devront aussi porter simultanément sur la faiblesse des capitaux dans l’économie française et sur les incitations à rattraper le retard sur les technologies d’avenir pour assurer le développement économique, donc la création de richesse et d’emplois. Les indicateurs à suivre ne sont pas ceux que l’on pense. Le taux de croissance ne fait que constater une ambiance économique. Le nombre de dépôts de brevets, le nombre d’entreprises toujours en activité deux ans après leur création. Ce sont des indicateurs du dynamisme. Le nombre de personnes touchant le RMI, le temps moyen pour retrouver un emploi, le volume des aides sociales, les intérêts de la dette publique, doivent diminuer. Ce sont des indicateurs d’immobilisme.
Dans ce paysage, la réforme de l’État est indispensable pour réorienter les moyens financiers. Elle se situe à deux niveaux. Premièrement, il y a trop de niveaux de décisions en France : les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, les services de l’État. Il y a au moins une structure décisionnelle de trop. Deuxièmement, plus de fonctionnaires doivent acquérir la culture du résultat. C’est-à-dire intégrer dans leur travail au quotidien le B-A BA du management, « objectifs, moyens, résultats », pour les responsabiliser et permettre la coordination de l’action publique.
Mais, en France, chaque proposition de réforme provoque des envolées lyriques des catégories concernées par la remise en cause des « fameux droits acquis », qui bloquent toute avancée du système. Donnons donc aux territoires qui le souhaitent le droit d’expérimentation de nouvelles pratiques. C’est déjà le cas avec la concession de services publics pour l’aide à la recherche d’emploi dans certains territoires. Rien n’empêche d’aller au-delà pour l’aide aux entreprises, la formation supérieure et continue, la gestion des aides sociales...
Il faut reconnaître au moins aux Français la compétence de transformer les enjeux politiques et sociaux en grèves et en défilés protestataires. Mais leur pragmatisme fait souvent défaut au moment d’imaginer des réponses concrètes. Les Irlandais s’appuient sur leur faible coût de main d’œuvre, les Anglais font du dumping fiscal, les Scandinaves valorisent le principe d’égalité. Alors, quel est l’avantage concurrentiel à valoriser pour l’équipe France ? Sans aucun doute sa jeunesse, son niveau de culture générale, les compétences professionnelles et la propension des Français à s’insurger en permanence. Donnons les moyens de le faire à ceux qui veulent entreprendre dans l’économie, la culture, l’humanitaire. Les créations d’emplois, l’évolution des mentalités et des comportements suivront.
Le politique ne peut plus se contenter d’exprimer des intentions basées sur des valeurs souvent banales. Pour être entendu, le discours doit être franc, concret, engagé. Personne ne reprochera à un politique d’essayer de faire bouger les choses. Nous avons besoin d’acteurs politiques entreprenants plutôt que d’hommes politiques colmatant les brèches du modèle français. Depuis trop d’années, on se contente de rafistoler un système qui devient chaque jour plus inefficace.
Le vrai rendez-vous des Français avec eux-mêmes se produira en 2007, au moment de l’élection présidentielle. Celui qui l’emportera sera le candidat capable d’imposer des réformes douloureuses mais en même temps de proposer un contrat gagnant-gagnant à chaque Français.
53 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








