Bye bye Darwin : nouveau regard sur la sélection naturelle
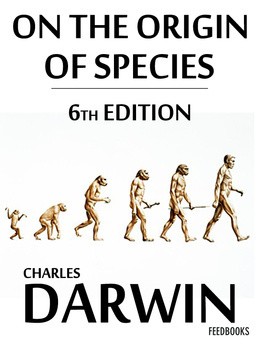
La sélection naturelle est un concept scientifique articulé à deux autres concepts, celui de spéciation et celui d’adaptation. Ces articulations (et relations) ne sont pas aussi claires qu’on ne le pense, avec des ambiguïtés non sans un peu de « flou » conceptuel. Les questionnements scientifiques et philosophiques sur cette sélection sont toujours d’actualité alors qu’aucun consensus n’est établi au sein de la communauté des évolutionnistes. La question centrale posée concerne la spéciation : la sélection naturelle est-elle une force évolutive permettant d’expliquer l’origine des espèces ? Si ce n’est pas le cas, la sélection naturelle n’est qu’un récit offrant une vue partielle de l’histoire du monde vivant qu’on appelle Evolution. Une très longue histoire, qui a duré 500 millions d’années si on prend pour départ les premiers signes d’une vie animale. Et deux milliards de plus si l’on commence à partir des premières cellules vivantes supposées présentes sur la planète terre. La sélection ne serait donc qu’une description de l’histoire de la vie, à l’instar de notre Histoire dans laquelle les peuples naissent, se développent, font la guerre et parfois dépérissent. Dans la sélection, il n’y a pas de guerre mais si l’on veut, d’efforts vitaux nécessaires permettant aux espèces pour perdurer dans ce qui est un jeu de la vie dans un écosystème donné.
Je postule que l’effort vital est la cause efficiente de la vie. Effort pour trouver les ressources vitales, pour se reproduire et pour échapper aux prédateurs. Il est facile de comprendre pourquoi une espèce réussit à se perpétuer dans un écosystème donné, alors qu’il est encore plus évident de comprendre ce qui fait disparaître les espèces. Les efforts vitaux sont alors couronnés de succès en se révélant efficaces mais ils peuvent faillir et conduire à l’extinction d’une espèce. Avec des causes diverses. Les plus aisées à concevoir étant les modifications climatiques de grande ampleur, lesquelles peuvent modifier le biotope végétal et changer les conditions de ressources pour les espèces herbivores. D’autres espèces peuvent aussi disparaître sous l’effet des prédateurs. Qui eux aussi devraient disparaître à moins qu’ils ne se « rabattent » sur d’autres espèces ou alors qu’un équilibre se dessine. Une reproduction « faiblarde » peut aussi conduire à l’extinction. Se pourrait-il que l’effort vital puisse s’affaiblir chez certaines espèces. A l’instar du dernier homme nietzschéen qui n’a plus le goût de vivre ? Cette hypothèse bien qu’incertaine ne doit pas être exclue. Mais le dernier homme est un phénomène culturel qui n’a pas forcément un équivalent naturel. Toutes les espèces pouvant se prévaloir d’un effort vital mais certaines réussissant et d’autres pas. C’est ce j’entends alors par sélection naturelle. Seul l’homme peut décider de ne plus affronter la vie pour des raisons non vitales.
La sélection naturelle repose aussi sur la distinction entre adaptation et non-adaptation. La seconde propriété étant pratiquement synonyme d’extinction si on l’applique à une espèce. Notons aussi une propriété fondamentale de la sélection naturelle, c’est d’être globale et de décrire un ensemble de processus, phénomènes et fonctions impliquant nécessairement une relation ou une interaction entre le système vivant individué membre d’une espèce et l’écosystème où il vit. La sélection naturelle s’applique ainsi à une quasi infinité de processus et actions conduisant à produire un écosystème à la fois stable et capable de se transformer modérément au fil du temps biologique ou énormément si l’échelle de temps est géologique. Les transformations s’effectuent en articulation avec deux processus « externalisés » introduisant des changements. Premièrement, les mécanismes géophysiques aux échelles courtes ou longues. Erosion, climat, précipitation, milieux aquatiques et espaces occupés par les végétaux. Deuxièmement, le changement induit par l’action des systèmes vivants dans l’écosystème, qu’il s’agisse des bactéries influant sur la composition chimique du milieu ou des prédateurs qui diminuent la population des proies ou encore, pour évoquer un phénomène assez « popularisé », l’action des insectes pollinisateurs. A ces mécanismes de changement s’ajoutent des processus de transformation très différents par essence et par la forme qu’ils prennent car ils sont inhérents à la vie (intrinsèques ou si on veut internalisés dans le vivant). Les évolutionnistes en donnent une description « approximative ». Avec principalement les mécanismes génétiques. Plus précisément, les modifications génomiques combinées avec les effets de reproduction sexuée ou sexualisée. Les éléments moléculaires et cellulaires rassemblés dans le vivant étant capables de développer des ordres émergents.
Darwin était bien conscient des difficultés liées à ce concept de sélection naturelle. On le constate en lisant le chapitre concerné à ce sujet avec la pluralité d’interprétations possibles, certaines véhiculant des contresens. La genèse des espèces ne repose pas sur la sélection naturelle qui n’est en fait que le résultat d’un tri effectué sur les êtres vivants dans des conditions changeantes de l’écosystème. La force évolutive est d’une autre essence. Mais l’hypothèse d’une force ne va pas de soi. Celle d’effort vital oui. Peut-être pourrait-on envisager l’hypothèse d’une sorte d’ordre évolutif, dépendant de ce qu’on verra apparaître comme étant l’entropie-organisation. Notion délicate que je tiens à préserver des contresens. Il n’y a pas de concepteur externe transcendant qui détermine les espèces. Le jeu est libre, avec la participation du hasard mais aussi avec des contraintes, celles de la sélection naturelle, externe, et celles de l’organisation naturelle, interne, en liaison avec un certain « ordre informationnel » dans la matière. La conclusion de ces quelques lignes suggère qu’il existe un découplage entre le jeu de la sélection naturelle avec les fonctions du vivant opérant dans l’écosystème et le fonctionnement du vivant sur des bases moléculaires et entropiques avec les processus conduisant à la spéciation ou du moins participant à la spéciation.
Ce qui conduit à proposer une hypothèse sur l’évolution du vivant. La spéciation est le résultat de deux processus fondamentaux aux ressorts différents et qu’il faut élucider en profondeur. Actuellement, la compréhension de la spéciation est superficielle. La sélection naturelle constitue un facteur déterminant pour la spéciation mais on ne sait pas exactement comment et pourquoi. D’un autre côté, la logique du vivant, de l’organisation interne de l’autre côté, avec les processus de partage et gestion de l’information (transmission génome, ADN et interactions épigénétiques) déterminant l’organisation moléculaire avec les fonctions cellulaires et l’organisation physiologiques avec les fonctions constatées du vivant, la perception étant déterminante, comme la cognition. La sélection naturelle ne crée pas les systèmes perceptifs, cognitifs et physiologiques. C’est l’inverse, les systèmes perceptifs, physiologiques, fonctionnels et cognitifs reposent sur un perfectionnement évolutif réalisé indépendamment du milieu. La sélection naturelle effectue alors un tri et retient les espèces les plus performantes selon la loi suprême de l’écosystème. Expliquer la spéciation avec la sélection naturelle relève presque de la pensée magique. C’est bien plus l’extinction des espèces que la sélection naturelle explique !
L’une des grandes difficultés, c’est de situer le rôle de cet effort vital ainsi que du lieu où il s’applique. L’effort vital pouvant être une force adaptatrice permettant une efficacité soutenue pour rester dans le jeu de la sélection. Mais aussi et peut-être une force transformatrice. L’usage de la notion d’effort n’excluant pas qu’on utilise celle d’énergie. Et bien évidemment la transposition de la notion d’entropie est tout à fait indiquée pour décrire les processus dans les systèmes vivants et l’écosystème. Pour le reste, on s’en tiendra à rappeler le principe fondamental de cette réflexion. C’est la vie qui explique la sélection naturelle et non l’inverse, comme le croient la plupart des évolutionnistes.
L’adaptation serait du domaine de l’entropie et de la convergence des informations dans un contexte de moindre action (principe de l’énergie libre et évolution spontanée) alors que la spéciation serait du domaine du déséquilibre et de l’invention. Un déséquilibre par rapport à l’ordre naturel. Une augmentation de la puissance. Un effort vital. Une persévérance mue par un « conatus » à la Spinoza ? Ces ouvertures conduisent à penser que le vivant persévère lorsqu’il a à sa disposition des fonctionnalités performantes alors que celui dont les fonctions faiblissent tend à disparaître ou à défaut à persister dans un état qu’on peut désigner comme dévolutif. Une espèce ayant en héritage des possibilités mais qui par un hasard, parce que le hasard est présent dans la nature, ont abandonné pour ainsi dire leurs potentialités. Sans en avoir conscience. Seul l’humain est capable de forger le sentiment qu’il a raté son existence. Le système cognitif humain est aussi adapté au déni de réalité. Le déni de réalité est un mécanisme de survie dans un monde où la réalité se dédouble entre vécu et interprétation, en gestion de la vie et horizon inventif. Dans le cas des espèces animales, cet horizon est évolutif mais sans conscience, sans représentation, juste instinct et invention vitale qui repose sur un effort vital dirigé vers le nouveau et non pas la survie.
Ces remarques préliminaires conduisent à examiner l’intérêt de considérer les fonctions et on plus l’espèce comme élément basique et déterminant, à la fois dans le jeu de la sélection naturelle et la spéciation animale. Ce sont les fonctions qui permettent aux espèces de s’adapter, de réussir dans le jeu de la sélection naturelle. Mais aussi l’invention de ces fonctions et leur perfectionnement qui conduisent aux espèces nouvelles et à une adaptation plus efficace. Le néologisme de « perfonctionnement » décrit bien le processus. « Fonction » renvoie en fait à deux ordres de réalité, les fonctions physiologiques internes, ajoutées aux fonctions cognitives, et ce qu’on peut appeler les fonctionnalités qui sont des catégories opératoires qu’une espèce possède pour exister dans son écosystème. L’observation des incisives chez les rongeurs et des canines chez les félins indique une fonctionnalité différente destinée à répondre à une même finalité, celle de se nourrir. Ainsi, l’équilibre ou le cas échéant les instabilités d’un écosystème sont déterminés par les différentes fonctionnalités permettant aux espèces d’agir dans ce milieu. La sélection naturelle conserve les meilleurs ajustements. Elle s’exerce sur le côté technique du vivant. Mais elle n’explique pas le développement des fonctionnalités techniques des espèces et notamment les étonnantes aptitudes perceptives et cognitives.
Ces quelques lignes ne font que présenter des manières non conventionnelles de concevoir les ressorts de la vie et de l’évolution. Il y a du travail en perspective pour élaborer la nouvelle théorie de l’évolution qui sera acceptée d’ici deux ou trois décennies. La physique théorique sera de la partie. Pour l’instant, les visionnaires savent que la théorie actuelle de l’évolution ne tient plus. Quelques sommités de la philosophie l’ont affirmé, comme Jerry Fodor ou Thomas Nagel qui va plus loin en mettant en cause le matérialisme. Le grand public se scinde entre ceux qui sont du côté de l’expérience de Milgram et s’en remettent au consensus de l’autorité scientifique dominante et les autres, plus audacieux, qui sont du côté de la vérité. Bye bye Darwin.
50 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








 ...etrange...
...etrange...






