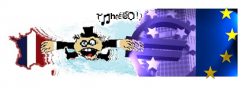
sasapame
41 ans. 3 enfants. Je refuse désormais toute étiquette, et je récuse quiconque entendrait se planquer derrière la mienne : c'est précisément en en faisant une icône qu'on détruit le message qu'un homme aura souhaiter transmettre - en somme : courage ! Quitte à m'étiquetter : scientifique ; démocrate radical ; socialiste. A part le boulot qui paie mes factures (ingénieur en mécanique), j'ai travaillé, suivant mes voies et mes rythmes, sur des matières dont le nombre suffirait déjà, je le crains... à effrayer les impatients ! Disons, par ordre à peu près décroissant : Droit constitutionnel et dérivé, critique des institutions nationales actuelles / Critique des institutions européennes et stratégie de sortie de l'Euro / Réforme des institutions nationales / Monnaie / Systèmes spécifiquement impérialistes-totalitaires et moyens d'y faire face / Offensives idéologiques diverses et variées : - Arnaque du "changement climatique" (dossier que je suis le plus assidument depuis 10 ans - travaux scientifiques de fond, avec deux projets de publications ; réflexions politiques) et, plus largement écologisme scientiste contemporain ; - faux "antiracismes" forcenés, féminisme débile et autres conneries du genre, et plus largement toutes menées contre la cellule familliale, nationale et contre l'humanité, sionisme politque et idéologique, etc.) / Psychologie / Musique (composition et surtout arrangements, tous styles - guitare et chant à la marge) / Dessin (depuis toujours mon grand dada, certes toujours plus esseulé... - ici comme sur mon blog, en général les dessins et autres supports visuels sont de ma composition) / Éducation de mes enfants.Tableau de bord
- Premier article le 21/06/2012
- Modérateur depuis le 08/12/2018
| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 4 | 181 | 201 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 27 | 23 | 4 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
Ses articles classés par : ordre chronologique
Sénéchal, nous voilà !
3198 visites 8 déc. 2018 | 31 réactions |
Venezuela : qui a éteint la lumière ? L’affaire Derwick
2884 visites 26 sep. 2016 | 47 réactions |
Premier Rappel à l’Ordre Français
4672 visites 5 jui. 2016 | 88 réactions |
Nous, on veut ! Pourquoi il faut quitter l’euro et démanteler l’Union européenne
3824 visites 21 jui. 2012 | 35 réactions |
Derniers commentaires
LES THEMES DE L'AUTEUR
Politique Europe Ecologie Démocratie Gilets jaunes International Venezuela Europe Union européenne Crise financière Euro Front de Gauche
Publicité
Publicité
Publicité









