Sur « Si c’est un juif » d’Adrien Barrot
Le regard d’un homme sur le meurtre d’un juif.
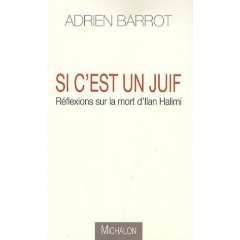
Si les événements horribles du siècle dernier et ceux que
nous connaissons encore de nos jours suscitent naturellement une profonde angoisse
et une vive douleur, la simple expression de cet émoi n’en risque pas moins de
nous laisser dans un aveuglement dommageable. A l’autre extrémité de cet émoi,
la prétendue objectivité des sciences sociales et des sciences historiques qui
se font fort de présenter les « faits » indépendamment des « valeurs »
a toutes les chances de se révéler complètement vide. Ces sciences sociales
devraient pourtant s’inquiéter de ce qu’au nom de cette même objectivité,
quelque homme politique s’autorise à parler de « détails » de la
seconde guerre mondiale ou « d’incident » du 11 Septembre 2001,
comparant ce qui est incomparable à la lumière ou à l’ombre égale et sans
relief du nombre. Au nom de cette même
objectivité, il ne serait pas difficile de trouver qu’Adrien Barrot nous
gratifie de beaucoup d’inquiétudes pour le meurtre d’un seul juif. Mais
en vérité, le dernier livre d’Adrien Barrot est l’exemple rare et précieux
d’une intelligence pleine d’âme ou d’une âme qui n’est pas oublieuse
d’elle-même lorsqu’elle porte son regard sur les « faits », précisément
parce que les faits, dans les choses humaines, ne sont jamais sans lien avec
les « âmes ». Ainsi, l’écriture de ce livre « s’efforce de
dominer un choc dont elle ne peut ni ne veut effacer l’impact. Ainsi seulement
s’explique et se justifie sa véhémence. »
Ceci ne veut évidemment pas
dire que nous devons nous accorder avec tout ce qu’avance Adrien Barrot, mais
cela fixe les exigences minimales d’une critique sérieuse.
Dans cette courte recension, nous voudrions
principalement insister sur la dimension essentielle de ce livre, dans la
mesure où cette dimension est simplement suggérée par son titre. Si c’est un
juif nous rappelle naturellement Si c’est un homme de Primo Lévi,
mais ce renvoi, cet écho déformant n’est évidemment pas une simple fantaisie de
l’auteur et doit dès l’abord nous donner à penser. Que se passe-t-il lorsque
Adrien Barrot remplace l’homme par le juif, sur quel problème veut-il nous
alerter de manière immédiate ? Y aurait-il une difficulté entre le fait
d’être homme et le fait d’être juif, ou même, y aurait-il une différence
essentielle entre l’homme et le juif ? Si c’est un juif, alors ce ne
saurait être vraiment un homme ?
Il ne faut pas s’y
tromper, Si c’est un juif est un titre qui recèle de la violence, dans
la mesure où les questions effroyables et insensées qu’il nous impose à demi-mot
nous renvoient à la plus violente barbarie. Mais pourquoi Adrien Barrot nous
renvoie-t-il à cette violente barbarie qui est toujours dans nos mémoires et
qui ne peut que réveiller nos souvenirs endoloris ? Ne sommes nous pas
continuellement nourris de cette mémoire, ne sommes nous pas même fatigués de
cette « industrie de la mémoire » ?
Mais c’est précisément la
mise question de cette mémoire qui est en réalité nécessaire lorsque se manifeste
notre incapacité à reconnaître l’horreur qui émerge sous nos yeux. Si c’est
un juif nous renvoie à la plus violente barbarie parce que notre
« mémoire » de celle-ci est tout simplement incapable de voir dans
notre situation présente un terrain particulièrement propice à sa
croissance. Si c’est un juif est l’écho déformant rendu nécessaire pour
une mémoire déformée.
Le sous-titre du livre -
« Réflexions sur la mort d’Ilan Halimi » - nous place, de fait, dans
l’actualité du problème. Mais il ne s’agit pas non plus, pour l’auteur, de
mener une réflexion sur l’antisémitisme « en général » afin d’expliquer
le meurtre perpétré par le gang des Barbares. Cette réflexion est
nécessairement présente, mais elle ne se détache jamais du contexte qui la
motive, c’est-à-dire de notre contexte. « L’écriture est ici au
service de l’élucidation », et l’élucidation dont il est question est
celle des conditions socio-politiques où apparaît non seulement ce meurtre,
mais aussi un ensemble de comportements, d’événements, de discours politiques
ou intellectuels ouvertement hostiles aux juifs. C’est donc l’état inquiétant de
notre société qui est avant tout analysé.
Le livre d’Adrien Barrot est l’expression politique de l’effroi suscité par le meurtre d’Ilan Halimi. Dans l’introduction de son livre, il laisse entendre que cette expression littéraire était d’autant plus nécessaire que l’expression citoyenne avait fait défaut à la suite des événements de Février 2006. Il y eut bien une manifestation après le meurtre d’Ilan Halimi, mais cette manifestation n’a pas été, comme elle aurait du l’être, citoyenne : elle fut juive. Il y eut bien un geste du président de la République, mais ce fut un geste pour les juifs. Il ne faut donc pas se tromper sur l’intention d’Adrien Barrot. Aussi concerné se montre-t-il par le problème juif, la dimension essentielle de son livre est politique et humaine. Nous savons tous que la différence entre l’homme et le juif est purement et simplement inepte et fatalement dangereuse. Dangereuse, parce que la haine des juifs joue facilement un rôle central lorsque le tissu social d’un nation se dégrade de façon dramatique. La mémoire archétypale des représentations anti-juives qui sourdent dans les bas-fonds de la société a malheureusement plus d’efficace que notre mémoire humaniste et cultivée. Mais si nous savons cela, nous comprenons peut-être moins toute la responsabilité politique impliquée dans cet état de fait. En « manifestant » sa compassion aux juifs, le président n’a-t-il pas, d’ailleurs, précisément déresponsabilisé la République ? Et en se déresponsabilisant, celle-ci n’a-t-elle pas fait la plus discrète, mais également la plus lourde des concessions aux barbares ? Cette république est suffisamment intéressée par la montée de la violence pour en faire le cœur d’un programme présidentiel, mais elle ne voit pas que le meurtre d’un juif en tant que juif relève d’autre chose que de la violence « ordinaire ». Elle ne comprend plus que son rôle n’est pas simplement policier ou administratif, et qu’un rôle au moins tout aussi important lui revient de toute urgence : celui d’être la conscience humaine de la Nation, ce qui n’est évidemment pas sans lien avec le problème de l’éducation. Le livre d’Adrien Barrot n’est donc pas à mettre au rang des complaintes juives. Rien ne serait plus préjudiciable à son livre que de le comprendre ainsi, et lui-même en avertit clairement son lecteur. Il s’agit de déceler les causes profondes et les significations politiques du meurtre d’un homme parce que celui-ci était juif. Il est un appel éclairé à l’homme et au citoyen : « L’inquiétude qui s’exprime ici ne peut ni ne veut découler que du malheur juif. Il ne faut pas, en effet, dissocier le malheur juif du malheur général. Ne serait-ce que parce que cette dissociation des Juifs et du monde n’est d’abord pas autre chose que l’opération même de l’antisémitisme et qu’elle n’est, à ce titre, que l’expression démente d’un malheur généralisé. »
Tel est l’éveil de notre conscience politique que peut et veut provoquer le livre d’Adrien Barrot. Ce simple fait justifie l’intérêt que nous devons prendre à ce livre, qui pour le reste étaye et justifie ces intuitions par une réflexion remarquablement sensible, claire et informée sur notre situation politique, l’histoire et la philosophie. Peut-être son verdict nous paraîtra-t-il excessif, mais son appel restera quoi qu’il en soit légitime. Il y a un très beau poème de Yehuda Halévi qui commence par ces vers :
« Mes pensées ont pesé mon trouble
Il est lourd comme le sable de la mer ou comme ma faute. »
Si c’est un juif nous force à peser notre trouble avant qu’il ne devienne notre faute.
47 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










