Réintroduire la finalité dans la nature : une controverse majeure pour le 21ème siècle
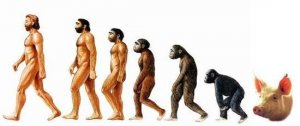
L’histoire des sciences est parsemée de disputes théoriques dont le sort a été tranché par l’expérience. Il y a eu de rares controverses dont on peut dire qu’elle ont été déterminantes, inclinant les gens instruits à modifier leur vision du monde pendant cette courte modernité qui a duré un demi millénaire. Il y eut l’héliocentrisme de Copernic puis Galilée, savant pris dans une violente controverse avec les savants de l’Eglise. La seconde controverse de puissance sismique est arrivée avec Darwin, le savant qui a théorisé l’évolution avec des arguments suffisamment décisifs pour l’emporter face une nouvelle fois aux prétendus savants de l’Eglise qui se réclamaient du créationnisme. La physique moderne n’a pas eu à subir de longues controverses puisque les expériences ont rapidement tranché en faveur de la cosmologie relativiste et de la mécanique quantique. C’est à nouveau en biologie qu’une grande controverse se prépare. La vie est-elle le fruit du hasard ou bien faut-il introduire de la finalité ? Autrement dit, néo-darwinisme contre néo-finalisme. Plus précisément, l’alternative entre une nature qui se transforme aveuglément en étant sélectionnée ou bien une nature guidée par quelques instances pouvant l’orienter. Qu’on ne se méprenne pas, il ne s’agit pas de débattre du créationnisme, qui est maintenant hors jeu. Il est question de deux options paradigmatiques dans le domaine l’évolution. Je dirais même plus que si le néo-finalisme l’emporte comme j’en suis convaincu, le créationnisme sera définitivement discrédité, ne pouvant plus jouer sur les déficiences ontologiques de l’évolutionnisme aveugle.
L’homme est arrivé par hasard sur cette terre. Telle est la conclusion d’un fameux livre de Jacques Monod dont l’impact sur la formation des esprits a été considérable. Je m’en rappelle d’ailleurs, lorsque jeune homme encore étudiant, je m’intéressais aux réflexions sur la nature. J’ai le vague souvenir de discussions vites achevées avec je ne sais plus quels croyants de passage. Arguer du caractère hasardeux de l’origine de la vie relevait plus d’une posture offensive contre la religion que d’une authentique compréhension du phénomène vivant. Une réflexion poussée montre bien le caractère arbitraire de cette position ; à un moment donné, par une sorte d’heureuse coïncidence, les molécules auraient réussi à produire de la vie. L’évolution a ensuite fait le reste. Pourtant, rien ne s’oppose à ce qu’on invoque une option disons plus finaliste, ou du moins, une sorte d’instance (alors là, que dire, transcendantale, métaphysique, métabiologique ?) ayant pu orienter le ballet prébiotique vers la solution de la vie. Ensuite, rien ne dit que la vie ne soit apparue à un moment pour ensuite évoluer. Il se peut que la vie ait subi des avatars imprévisibles, avec des apparitions successives puis des disparitions. Qui peut délégitimer cette hypothèse ? Personne. Pourtant, prévaut l’idée d’une apparition unique des premières cellules qui ensuite se sont transformées pour engendrer la longue série des métazoaires. On trouve même l’idée que tout ce qui vit sur terre descendrait d’une unique cellule. Si l’on adhère au principe énoncé par Monod, la nature évolue de manière aveugle, mue par le hasard qui par une astucieuse sélection naturelle, engendre les espèces puis l’homme doué d’une conscience. Cette adhésion au principe du hasard, doublée d’un refus d’introduire la finalité dans la nature, interrogera sans doute les sociologues de la science dans quelques décennies. On pourra aussi réfléchir aux idées développées par Gould sur un progrès qu’il ne veut pas accorder à la nature, son idée étant de lancer une controverse contre ceux qui naïvement, glorifient le progrès humain en usant notamment d’analogies avec la nature. Le progrès n’est pas une notion scientifique, c’est un jugement moral.
Introduire la finalité dans la nature, c’est prendre position sur le sens des choses dans l’univers et c’est tout aussi légitime que de croire au hasard. La seule condition pour introduire la finalité étant de ne pas proposer des théories ni des explications qui seraient en contradiction avec les faits scientifiquement établis. Cette finalité peut-être immanente et s’expliquer par les propriétés cognitives inhérentes au vivant (et même au monde physique). Je ne réduis pas la cognition aux seules facultés humaines et la généralise comme une sorte d’aptitude du vivant à effectuer des calculs moléculaires à son niveau propre. Cette finalité permet de concevoir que la vie puisse être orientée, ce qui n’empêche pas qu’elle joue souvent du hasard, effectuant des bricolages et autres modifications de l’agencement moléculaire amenées à être testées, avec aux débuts plus d’erreurs que de réussites.
J’exclus donc toute intervention d’une instance extérieure, qu’on l’appelle Dieu ou créateur, qui interviendrait pour modifier le cours des choses évolutives en infléchissant dans un sens ou l’autre les orientations prises par le monde vivant avec ses adaptations et ses spéciations. La nature fait des choix, elle est libre mais n’a pas conscience de ses choix qu’elle ne peut se représenter rationnellement, en raisonnant sur les conséquences de ces choix, d’où les nombreux échecs sanctionnés par la sélection naturelle. Seul l’homme a une claire conscience des choix et peut disposer de la liberté qui fonctionne avec la volonté. Voici donc les postulats fondamentaux du néo-finalisme que je propose. Chaque espèce a aussi sa finalité propre, de même que chaque animal intervient sur son destin qui se joue dans le jeu naturel et souvent lui échappe. Passons maintenant aux finalités enchevêtrées. Dans un système vivant, chaque niveau du vivant élabore sa finalité propre et restreinte qui s’insère dans une finalité collective. La partie se finalise pour participer au tout. C’est le cas des différents niveaux de l’organisme, gènes, protéines, organistes, cellules, organes. Ces finalités sont spontanées. Sauf dans le cas des systèmes sociaux où l’insertion d’un individu dans une fin collective est le résultat d’un choix libre, voire consenti et hélas parfois contraint.
Le postulat fondamental du néo-finalisme s’énonce en considérant la finalisation dans le Vivant comme le résultat de processus conçus comme cognitifs au sens le plus général, celui d’un calcul (formel ?) effectué par les éléments moléculaires et cellulaires ainsi que les dispositifs cognitifs avérés comme le cerveau animal. Ce néo-finalisme est une véritable révolution qui accorde à nouveau une intériorité à la nature, intériorité qui fut refusée par la science moderne occidentale. La nature suit une voie sans le savoir, une voie qu’elle se construit peu à peu. La science moderne ne veut pas savoir quelle est cette voie, ou ne peut pas, ou s’en désintéresse, finissant par convenir que la nature est aveugle. Pour être complet, je propose que la vie soit conçue comme un processus ordonné, conservateur mais aussi chaotique et inventeur, qui se finalise de manière immanente tout en obéissant à une nécessité naturelle, celle de s’adapter et de déjouer les pièges de la sélection naturelle.
Pour prévenir toute polémique sur cette controverse, deux ou trois points essentiels doivent être explicités. D’abord, il faut convenir que la finalité est un concept philosophique, voire métaphysique. Il faudrait donc songer à le transposer depuis le domaine de la philosophie de la nature vers celui des concepts scientifiques. Il faudra passer du général au particulier et donner, dans un espace d’objets défini, une définition formelle de la finalité assortie d’une possibilité de tester et de trancher. Avec des énoncés du type, si il y a de la finalité, alors on se situe dans la tranche d’observation (x----y) et dans le cas contraire, il n’y a pas de finalité. C’est simple dans le principe mais pour l’appliquer, il faut des recherches sérieuses. On connaît d’autres domaines où des tests pour trancher on été formalisés rigoureusement. C’est le cas du test de Turing élaboré pour décider si une machine peut être suffisamment puissante dans son usage linguistique au point de duper un interlocuteur en se faisant passer pour un humain. Autre test pour décider d’une ou de l’autre hypothèse que ces inégalités de Bell ayant permis à Alain Aspect de valider la théorique quantique en observant la non séparabilité. On peut donc construire des tests du moment que l’on dispose d’un ensemble formel suffisamment riche et cela devrait être possible pour la finalité en biologie.
Autre point important que le souci de ne pas confondre une finalité immanente, liée aux propriétés du système vivant et une finalité apparente, celle qui s’explique par la sélection naturelle. D’où l’importance du point précédent et de l’utilité de trouver des notions formelles applicables à l’authentique finalité.
Dernier point. En l’absence d’un dispositif scientifique permettant de tester la finalité, cette notion n’a pas à être rejetée. Elle relève de la philosophie de la nature et chacun pourra choisi sa manière de voir le vivant, du moment que cette vision ne soit pas en contradiction avec les faits de l’évolution. Sur ce point, il n’y a aucun risque. On peut comprendre aisément que la finalité est tout à fait compatible avec les données formelles et théoriques de l’évolution, qu’il s’agisse de l’adaptation, la spéciation, les modifications du génome, des gènes, du protéome et de l’épigénome. La controverse risque alors de durer un bon moment. Et si ce n’est pas de la science au sens de Popper, ce sera un autre domaine de savoir, comme par exemple la psychanalyse. Finalité ou pas ? Ah que l’on aimerait psychanalyser son chien ou alors une abeille ! Plus sérieusement, je prophétise un bel avenir à cette controverse sur la finalité dans le vivant et qui sait, dans l’univers. Je crois bien que les données sont suffisantes et qu’il est temps pour les savants d’abattre les cartes, comme dans une partie de poker qui se joue avec des données scientifiques. A chacun alors d’apprécier ces cartes dont il faut préciser que le joueur se doit de les mettre dans le bon ordre en trouvant les règles de combinaison pertinentes. Ma conviction étant qu’il y a une finalité dans la nature qui ne se réduit pas à celle de la « nécessité naturelle » et donc, je pense que la partie de poker scientifique est gagnée mais qu’il faut la jouer, car on peut découvrir d’autres choses et peut-être même des options thérapeutiques.
29 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON











