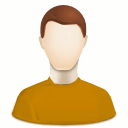
Pierre
Longtemps universitaire (spécialisé en logique et philosophie du langage) et résident de la ville de New York, je suis allé, il y a quelques années, m’installer dans un petit bled de l’état de New York. Là, je pratique la menuiserie et le dessin. Le onze septembre, que j’ai vécu de très près, a éveillé en moi un regain d’intérêt pour bien des choses que j’avais négligées pendant mes années à l’université. En bref, le onze septembre a été décisif pour moi.
Pierre Adler









