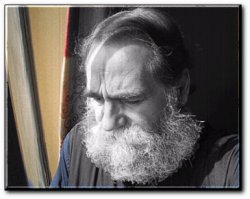
Pierre R. Chantelois
Après avoir oeuvré une dizaine d’années dans le secteur privé des communications (radio-télévision), je me suis orienté vers le secteur de la Fonction publique du Canada et du Québec du 1970 à 2005. J’ai occupé des fonctions de conseil, de gestion et d’analyste. Je me suis particulièrement intéressé à la télédiffusion des débats parlementaires, aux services en ligne gouvernementaux et aux communications stratégiques gouvernementales. J’ai touché au domaine des relations internationales et du développement international au sein du gouvernement du Canada et auprès d’une importante université francophone du Québec. J’ai oeuvré enfin auprès d’une société internationale d’informatique à titre d’analyste-conseil avant de prendre ma retraite en 2006.Tableau de bord
- Premier article le 18/01/2007
- Modérateur depuis le 07/02/2007
| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 111 | 1341 | 6953 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 8 | 3 | 5 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
Ses articles classés par : ordre chronologique
Omar Khadr, l’enfant-soldat, est-il coupable ?
1326 visites 1er nov. 2010 | 10 réactions |
Le Canada complice de Guantanamo
1053 visites 27 oct. 2010 | 10 réactions |
Obésité et vieillissement, les véritables ennemis de la Chine
2051 visites 18 oct. 2010 | 15 réactions |
Rien n’est réglé à Guantanamo, cet antre de l’enfer
1022 visites 30 sep. 2010 | 12 réactions |
La Chine progresse-t-elle au plan des droits humains ?
1537 visites 27 sep. 2010 | 32 réactions |
La Palestine siégera-t-elle aux Nations Unies, un jour ?
1269 visites 24 sep. 2010 | 53 réactions |

Barack Obama gagnera-t-il ses élections de mi-mandat grâce à Sarah Palin ?
4028 visites 20 sep. 2010 | 37 réactions |
Aux États-Unis, une personne sur sept vit dans la pauvreté
2173 visites 16 sep. 2010 | 56 réactions |

Cellules souches : les conservateurs religieux américains bloquent la science
1710 visites 8 sep. 2010 | 5 réactions |








