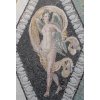Histoire moderne et contemporaine : la confusion idéologique à la française
Modernité sociale et technique, histoire et révolution :
Comme tout bon petit élève de l’école républicaine – ce qui était le cas pendant au moins une heure ou deux quand je n’avais ni trop faim, ni trop chaud, – j’ai eu la chance d’assister aux cours d’histoire et d’apprendre que la période moderne (ou temps modernes) succède au moyen-âge vers 1492 et s’arrête au début de la révolution française en 1789, ouvrant l’histoire contemporaine. De 1492 à 1789, trois siècles de modernité, entre la conquête du nouveau monde par les européens à partir de la fin du 15ème siècle et le déclin progressif des institutions féodales européennes commençant à la fin 18ème siècle. Extension, transformation puis révolution sont les maîtres mots qui désignent le mieux les mouvements de fond de cette période.
À l’inverse des historiens français, un certain nombre d’intellectuels, philosophes et sociologues en particulier, parlent de postmodernité pour désigner une période qui continue aujourd’hui et dont le début varie selon les auteurs entre les années 1950 et les années 1980. D’autres considèrent que la période actuelle fait toujours parti de la modernité. Cette dernière reste une notion active dans les champs intellectuel et idéologique, encore lourde d’enjeux et de conflits d’interprétation, (ce qui est encore plus visible dans les pays encore organisés autour de la religion, comme les pays musulmans), et un historien pourrait se demander si la modernité relève soit d’un « débat contemporain » dans le sens de quelque chose qui n’est pas encore là mais dont les prémisses sont visibles, ou soit d’un « débat moderne », dans le sens de quelque chose qui est déjà là, imposé de fait et à prendre dans son ensemble, sans le découper artificiellement.
Dans son acception générale, la modernité ne s’arrête pas en 1789 (ou en 1815), le sens commun désigne par modernité ce qui est nouveau, donc l’innovation, l’invention, en d’autres termes l’avancée de la technique et du design, et aussi la libéralisation des mœurs, l’avant-gardisme artistique, l’opposition institutionnalisée du pouvoir, la démocratie parlementaire, les droits de l’homme, et encore mieux, de la femme. Le sens commun retrouve et prolonge le sens académique de l’histoire moderne en ce qui concerne les faits relevant des sciences dites « dures », surtout la physique, l’astronomie et les mathématiques. La modernité historique commence avec Galilée et Christophe Colomb et pour le sens commun elle continue actuellement avec les astronautes et les généticiens. En ce qui concerne les mœurs, les institutions, c’est-à-dire les domaines qui relèvent aujourd’hui des sciences sociales, le sens commun de modernité ne se réfère pas beaucoup à la modernité historique, au plus loin au siècle des Lumières. Sur le plan des mœurs et de la politique, il y a une dichotomie entre sens commun et sens historique au sujet de la modernité, alors qu’au niveau de la perception globale de l’univers, amenée par les découvertes de l’exploration astrophysique, progressivement le sens commun et le sens académique tendent à se rejoindre : même si un sujet religieux peut refuser l’évolutionnisme biologique, il est plus rare d’entendre de sa part qu’aucun homme n’est jamais allé sur la Lune ou que la terre est plate.
Le découpage moderne/contemporain en 1789 fait par l’histoire française laisse à penser que la modernité technique est coupée de la modernité sociale, que les deux types de modernité ont chacune leurs problématiques et ne peuvent pas être mises sur le même plan. Même si dans l’expérience il est vrai que ce ne sont pas deux processus identiques, d’une part ce découpage a le défaut de mettre de côté les relations existant entre les deux et d’autre part le sens académique postule implicitement que la modernité sociale (symbolisée par la Révolution française) succède et se trouve déterminée par la modernisation technique issue de la Renaissance. L’histoire suit un plan rationnel continu qui distingue dans le temps les deux types de modernité en les raccordant en un seul point : la date sacrée de la Révolution, 1789 (ou 1792 pour les plus enthousiastes), signe touchant du romantisme à la française, mais qui a le défaut de cadenasser tout le débat historique contemporain autour d’un point d’orgue et de mettre de côté les relations entre l’ancien et le nouveau régime.
La différence entre le sens commun et le sens académique dans la définition de la modernité montre que la modernité technique et la modernité sociale ne sont pas contenues l’une dans l’autre et qu’elles ne se situent pas sur le même plan historique. En effet, il arrive que l’organisation sociale s’oppose aux changements provoqués par l’usage de nouvelles techniques – par exemple le fait de fermer une imprimerie qui reproduit un journal critique, – et dans d’autres contextes, la société cherche à transformer les techniques pour les adapter à leur nouveau mode de vie – par exemple les unités de mesure pendant la Révolution. Le premier cas relève plus de la modernité sociale, et le deuxième plus de la modernité technique, mais leur importance historique en terme de durée n’est pas la même, puisque le changement d’unité de mesure, s’il est préservé, a plus de conséquences que l’interdiction prolongée d’un outil pour des raisons sociopolitiques. Et pourtant, il est certain que le fait politique de la censure sera le plus débattu et le plus commenté. Ce qui veut dire que le sujet de la technique est relégué dans la longue durée et donne des faits indiscutables qui n’ont plus à être débattus, alors que le sujet social est toujours en proie aux contingences du moment, bien qu’il soit à l’origine de la technique. La modernité classique (1492-1789) est dans une large mesure dépolitisée, sûre d’elle-même et a acquis sa stabilité grâce aux grandes découvertes, tandis que la modernité « avancée » après 1789, le contemporain dans l’historiographie française, n’a pas encore acquis de légitimité historique suffisante pour être qualifié de moderne. L’histoire contemporaine est essentiellement polémique.
Il est remarquable que le sens commun donne plus de distinction entre les deux types de modernisation (sociale et technique), alors que le sens académique a tendance à confondre les deux types, dans une modernité classique et générale où tout se transforme d’un coup, la société et la technique avançant ensemble d’un même pas sans discontinuer. Le modèle des communautés de scientifiques (surtout physiciens, mathématiciens et ingénieurs) pendant l’époque moderne a été déterminant dans la représentation de nouvelles valeurs sûres d’elles-mêmes, et l’interprétation historique académicienne a repris pour elle-même cette vision quelque peu irénique d’un progrès technique harmonieux qui règle par avance les enjeux sociaux. Ce qui est paradoxal dans cette vision du progrès est qu’il a produit une inversion de causalité : ce qui est tenu pour une avancée technique est plutôt une avancée sociale, et inversement. Mais globalement, suivant en cela le sens commun de la modernité, c’est la technique qui s’est approprié le domaine du social, étant entendu que la modernisation sociale n’est qu’une annexe de l’ingénierie scientifique parce qu’autrement elle est politiquement trop complexe à organiser. La modernisation sociale n’est qu’un débat « contemporain » qui peut être réfuté à tout moment. Même si la sociologie a été créée entre temps (milieu 19ème siècle) pour remédier à cette lacune, la modernité reste un domaine réservé à l’innovation technique, y compris dans ses implications sociales.
En faisant un peu de provocation, la périodisation historique fait comme s’il n’y avait jamais eu de modernité sociale, ou si peu, alors que dans leurs contenus, les périodes modernes et contemporaines en sont remplies. L’histoire moderne s’arrête en 1789, au moment où des tentatives de modernisation politique commencent, présupposant que ce qui va suivre ne fait plus partie de la modernité, sous-entendant que les révolutions l’auraient achevé politiquement et seraient passé ensuite à autre chose, ayant coupé un lien avec le monde médiéval définitivement. Et sous-entendant d’autre part que la contre-révolution n’aurait pas de liens avec la modernité, qu’elle est seulement un culte nostalgique de l’Ancien régime (cette opposition entre modernité et contre-révolution symbolise bien la dichotomie entre sens commun et sens académique de la modernité, entre modernité technique et modernité sociale). Arrêter la modernité en 1789 revient à dire que la révolution politique est un aboutissement social malencontreux des révolutions scientifiques du 16ème au 18ème siècle, où le sujet humain prend la mesure de l’univers exploré par les moyens techniques. Après 1789 c’est juste « contemporain », actuel ou immédiat, et selon ce découpage périodique les faits historiques sont mis en équivalence dans un « âge contemporain », étendu sur plus de deux siècles où le cours historique est déterminé par le présent et l’avenir. Comme cela a été maintes fois étudié, l’histoire caresse l’idée de se mettre elle-même en scène et de véhiculer des grands récits sur la nation, l’homme et l’évolution. Avec un arrière-plan cosmologique moderne où des corps célestes éternels sont explorés par les scientifiques,
Pour ce qui dépasse les contingences humaines, les choses naturelles qui n’ont pas été transformées par l’activité humaine (anthropisées comme il se dit en géographie), en deux mots les choses éternelles, le sens commun de la modernité technique irait sans discontinuer de 1492 à aujourd’hui. Et pour ce qui relève de la reproduction et de l’organisation sociale, la vie individuelle et la politique, ainsi que les évènements pouvant subir l’influence du sujet humain, les choses éphémères, la modernité se brise en deux et avance « à reculons », puisque c’est par rapport aux évènements actuels, « contemporains », donc depuis la Révolution française, que le critère de modernité sociale est jaugé et apprécié en tant que tel.
Dans le monde scientifique, ce retard systématique de la prise en compte de la modernisation sociale par rapport à la modernisation technique tient à la relation que le sujet entretient avec son objet dans le monde scientifique et au-delà : moins le sujet humain est concerné par les phénomènes qu’il observe, plus il est indépendant du contexte, plus il est libre d’individualiser la chose et de créer un nouveau modèle, disposant ainsi de possibilités infinies d’instrumentaliser les choses dans son champ d’action. Dans le domaine social, l’action du scientifique est bien limitée, et d’une certaine manière beaucoup plus complexe que pour les sciences de la nature, puisqu’il doit sans cesse actualiser ses connaissances selon la position où il se trouve et les relations qu’il a avec les autres, et doit transindividualiser les choses pour créer un nouveau modèle (certains scientifiques peuvent faire les deux mais la plupart se partagent entre sciences de la nature et sciences sociales). Pour les sciences physiques et les mathématiques principalement, étant donné leurs infinités, les évènements restent apodictiques. Quelques soient le point de vue et le moment, le cadre reste identique, la planète Saturne a toujours ses anneaux, il neige à telle température et à telle altitude, etc. Pour le social, alors que les méthodes statistiques quantitatives ont montré que certains faits sociaux sont vrais en tout temps dans des contextes comparables, la vérité de l’observation scientifique lui est très souvent déniée, ou alors renvoyée dans les cordes de l’idéologie politicienne. Et étant donné que le pouvoir cherche à contrôler le social pour en tirer sa légitimité, il ne peut pas accepter de vérité scientifique critique le concernant, puisqu’il a pour fonction de l’organiser lui-même. Tandis que vis-à-vis de l’univers physique, le pouvoir peut se décharger sans limites et autoriser plus librement l’expérimentation scientifique, parce que sa propre force ne dépend pas du contrôle de la nature, mais de son exploitation faite par la société.
La dichotomie entre le sens historique et le sens commun de la modernité sociale correspond au moment où les sciences physiques et instrumentales se détachent progressivement des autres sciences, liées à l’organisation de la vie humaine. Et la science économique se trouve au centre de cette aporie dichotomique – et finalement écologique. Des vérités fixes et quasiment atemporelles – le mouvement et la place des corps célestes – donnent un cadre de représentation stable et assez hiérarchique de la révolution ou de la modernité. Et la relative rigidité de l’univers n’est pas remise en cause par le relativisme, qui prouve qu’il n’existe pas de centre organisateur : tout devient mouvement lorsque qu’un cadre immobile permettant de le détecter devient opérationnel. Dans Condition de l’homme moderne, Hannah Arendt considérait que le télescope, crée au 16ème siècle, est la première invention majeure et fondamentale des révolutions scientifiques modernes, et, pour prolonger sa réflexion, le télescope détermine à la fois les découvertes ultérieures, la transformation des relations entre l’homme et son environnement, c’est-à-dire la décontextualisation de ses conditions de vie par rapport à son lieu de résidence, en un mot : l’urbanisation, et donc la création d’un nouveau sujet humain qui cherche à être à la mesure d’un nouvel univers.
Depuis l’époque moderne, la permanence relative de cet univers physique s’est peu à peu détachée de la vie sociale avec l’exploration et l’instrumentation scientifique, et le ciel n’est plus la référence pour expliquer ce qu’il se passe sur Terre. Les choses éphémères autour des êtres humains n’ont plus à être reliées avec des choses éternelles, elles perdent définitivement leurs propriétés magiques. Mais ce serait oublier un autre processus que de s’arrêter au désenchantement du monde : si le ciel se détache de la vie humaine, il offre encore une matière exploitable qui n’a pas de limites observables, que ce soit dans le temps ou l’espace. À cet arrière-plan de ressources infinies cartographié depuis les grandes découvertes de l’ère moderne, a succédé pendant les révolutions contemporaines la réduction de l’être humain à sa propre finitude, au lieu même où il est, simplement armé de son droit individuel à l’existence. En détachant le ciel de la vie terrestre, il se détache lui-même de son propre environnement, uniquement préoccupé à la conservation et la reproduction de sa propre vie. L’être urbain et le sujet autonome étaient nés.
Ce retour sur les liens entre révolution scientifique et révolution socio-politique permet de comprendre que la modernité est affaire de perception et a priori la modernité technique n’entretient pas de relation mécanique avec la modernité sociale, dans sa globalité et en dehors des cercles scientifiques. En effet, la distinction entre les deux formes de modernisation est faite par l’histoire académique au moment de la Révolution française, non pas seulement pour des raisons méthodologiques qui lui sont propres, mais aussi en raison de constats empiriques qui poussent l’historien à distinguer les deux. Il ne pourrait pas l’expliciter parce qu’il serait obligé d’adopter une vision à rebours qui interprète le passé selon le futur. En d’autres termes, il est obligé de séparer les deux sans avoir la possibilité de faire un lien historique, très ténu et difficile à mettre en évidence sur une aussi longue période. Pourtant, le sens de la modernité qui se retrouve dans les manuels scolaires d’histoire induit en creux l’hypothèse que les faits politiques majeurs qui servent encore de repères socio-politiques aujourd’hui – les révolutions du 18ème et du 19ème siècles – ont été des solutions radicales pour répondre à des défis techniques posés dès la Renaissance, considérée comme la première mondialisation. La modernité académique fait une boucle périodique dont les deux bouts se répondent l’un l’autre, en donnant l’illusion qu’ils se rejoignent à la fin. En contredisant à demi-mot cette interprétation, le sens commun ne ferme pas la boucle, ne considérant pas qu’un enjeu social soit entièrement contenu dans l’enjeu technique.
Au 18ème siècle, la question de la réforme globale de la société s’est posée quand les institutions humaines anciennes (les seigneuries, l’Eglise, les communautés villageoises, les structures familiales) étaient inadaptées à l’ouverture d’échelle amenée par les nouvelles découvertes scientifiques – et cette époque est toujours la nôtre. C’est un défi institutionnel posé aux cadres de la société, à laquelle l’évolution technique n’avait pas formulé de traduction concrète et opérationnelle, adaptée au langage et au savoir-vivre humain. Les deux modernités (technique et sociale) sont séparées dans le temps par les sciences académiques, qui préfèrent confier aux professeurs d’histoire et de français la tâche d’illustrer aux enfants la réconciliation révolutionnaire, où la société contemporaine trouve son harmonie en s’appropriant les nouveautés issues de la modernité classique, grâce à la pensée des Lumières (de Descartes à Rousseau).
La dichotomie entre modernité sociale et modernité technique, et à travers elle la dichotomie entre sciences de la nature et sciences humaines et sociales, entre exploitation instrumentale et vie sociale, entre nature et humanité, est au cœur de la réflexion économique et écologique actuelle, et sous-jacent aux débats sur la mondialisation et le capitalisme favorisés par les dernières révolutions scientifiques – le moteur à explosion, l’électricité, le nucléaire et l’informatique. Le socialisme et même une très grande partie de la pensée intellectuelle ultérieure (surtout dans ses versants extrêmes, réactionnaires, futuristes ou totalitaires) ont essayé de répondre à cette aporie dichotomique en personnalisant le sujet scientifique, en essayant de créer une relation réciproque entre le nouvel univers et la société humaine, en dotant la vision télescopique d’une vue à double sens, où celui qui regarde dans l’univers soit capable de s’autocritiquer et de corriger sa propre vue, avec une méthode intersubjective qui re-contextualise les relations de la vie humaine avec son environnement proche et lointain. Cela n’est plus suffisant aujourd’hui (nous pouvons le dire avec certitude maintenant, sans tomber dans un fatalisme décadent) non pour des raisons morales, mais parce que cette méthode nécessite de nier pour mieux affirmer que la solution sociale est contenue dans la solution technique, même quand la finalité est de se débarrasser de la partie néfaste de l’exploitation technique. L’écologie politique n’est pas encore sortie de ce dilemme de briser la hiérarchie scientifique sans tomber hors de la modernité sociale, en évitant de mettre sur le même plan modernité technique et modernité sociale.
Par le passé, la non-prise en compte de cette dichotomie a reconduit l’aporie sous une autre forme, telle que la dictature du prolétariat, ou la création d’un nouvel homme ou d’une nouvelle race, qui ne sont pas des théories politiques ayant programmé les totalitarismes nazi et soviétique comme certains ont pu le dire ou le faire croire, mais plutôt l’imagination utopique de processus techniques positivistes afin de résoudre les contradictions de la modernité sociale, et parmi des populations encore sujettes à des superstitions dignes du monde ancien ou plus exactement, de la pré-modernité. Il est regrettable que les écologistes politiques dans son ensemble (y compris ceux qui critiquent le socialisme) mettent en avant une idéologie techniciste sans arriver à l’articuler à des processus sociaux globaux, certainement aussi en raison d’une imperméabilité d’une large partie de la population aux enjeux écologiques. C’est l’éducation qui est l’enjeu majeur de l’écologie, beaucoup moins la modernité technique, qui, de plus, est elle-même issue d’une phase de modernisation sociale.
Proposition d’une nouvelle chronologie qui simplifie l’analyse historique :
Selon les débats actuels sur la modernité, il est possible de distinguer trois phases de la modernité et sans tomber dans une révision contemporaine permanente. Ces phases reprennent les stades de développement des pays occidentaux mais elles peuvent s’adapter universellement selon le degré de modernisation de chaque pays. La liaison entre modernisation, colonisation, révolution ou réforme et indépendance politique sert de repère pour l’histoire de chaque pays. L’inconvénient avec le concept de contemporanéité est qu’il met sur le même plan des trajectoires historiques assez différentes alors que le concept de modernité nécessite de faire la différence entre ce qui est ancien et nouveau (dans son acception générale). Le lissage superficiel qui mettrait en équivalence la Chine, les États-Unis et la Russie ne permet pas de suivre les décalages spatio-temporels qui déterminent aussi l’histoire propre à chaque pays, autrement qu’en définissant ces décalages en termes de dépassement ou de retard. Bref, il s’agit d’appliquer une logique géographique à la périodisation historique, en considérant que l’histoire contemporaine est directement issue des grandes découvertes faites pendant la Renaissance.
Ainsi, ce sont les différentiations spatiales qui déterminent les trajectoires temporelles différentes, et moins l’inverse, où le passé de chaque pays déterminerait le moment de son entrée dans l’histoire moderne. En postulant que la modernité est un concept avant tout géographique, il est évident que cette interprétation s’oppose frontalement à celle que l’histoire française a construite depuis la Révolution, sacralisant le temps historique en lui-même et ne laissant pas de place à la réflexion générale de ce que peut signifier la modernité à des échelles et à des époques différentes.
Cette conception du temps révolutionnaire sacralisé, liée au fonctionnement de l’État-nation n’est pas moralement répréhensible ni inutile, mais d’une part elle a fini par détruire tout le débat historique qu’une nation peut avoir d’elle-même, en verrouillant tout ce qui est actuel dans un objet contemporain soumis à l’aléatoire ou à l’insignifiance, et d’autre part elle empêche des analyses empiriques fondées qui permettraient de changer de paradigme, de créer une nouvelle histoire, en tout cas en ce qui concerne la modernité.
Ce que dit la date de 1789 est que la révolution se situe à la jonction du moderne et du contemporain, qu’il existe des sociétés prérévolutionnaires, révolutionnaires et postrévolutionnaires, mais en fait, toutes modernes. Le paradoxe est que l’histoire française utilise la Révolution française comme repère chronologique universel du contemporain mais n’est pas capable (dans sa version académique) de dire en quoi la modernité classique est dépassée, si la rupture socio-politique est un critère suffisant pour passer du moderne au contemporain. Ces doutes induisent que l’histoire moderne est prérévolutionnaire, qu’elle que soit la position dans le monde, qu’une fois la révolution a établi un nouveau système politique, l’histoire est révolutionnaire, et quand la révolution est achevée et a réalisé la plupart de ses missions au niveau mondial, l’histoire devient postrévolutionnaire, ou postmoderne.
1) 1492-1783 : Modernité classique, ou modernité prérévolutionnaire :
Des Grandes découvertes à la révolution américaine
De 1492 à 1783, c’est la création d’un nouveau monde, en partie celui d’aujourd’hui, à travers les grandes découvertes, la réforme religieuse, les grandes exploitations coloniales, et la montée en puissance des États, confirmée par les traités de Westphalie. En suivant la piste « révolutionnaire », l’époque moderne a connu des mouvements prérévolutionnaires d’importance en Angleterre et aux Pays-Bas, qui culminent avec la guerre d’indépendance américaine, modèle des luttes pour la libération et de l’émancipation sociale et individuelle dans la civilisation occidentale.
Sous-périodes : 1492-1648 ; 1648-1783
Évènements majeurs : exploration des océans dans le monde, première mondialisation économique, réforme et guerres religieuses, révolutions artistiques et scientifiques, colonisation européenne, mouvement des enclosures, Guerre de Trente ans, rationalisation des États, révolutions politiques en Angleterre, aux Pays-Bas et en Amérique du nord.
Figures majeures : les conquistadors, les missionnaires jésuites, les juges inquisiteurs, les prédicateurs protestants, les exilés politiques, les explorateurs, les commerçants et négociants, les sociétés coloniales, les despotes, les mercenaires, les révoltés, les amérindiens, les esclaves africains, les américains, les bourgeois, les paysans, les peintres, les architectes, les philosophes, les écrivains, les physiciens, les économistes et les juristes.
Objets majeurs : l’État, la république, le gouvernement civil, les institutions juridiques, le Bill of rights (Déclaration des droits), traités de Westphalie, les communautés scientifiques, les compagnies commerciales, le grand port maritime, la caravelle, le comptoir colonial, la poudre à canon, l’or, l’argent, le tabac, le coton, le livre imprimé, la bible en langue vernaculaire, le théâtre, l’orchestre symphonique, le tableau, le télescope et le globe terrestre,.
2) 1783-1989 : Modernité révolutionnaire, ou modernité avancée
De la naissance des États-Unis à la chute du régime soviétique
Sous-périodes : 1783-1929 ; 1929-1989
De 1783 à 1989, c’est le temps des transformations radicales des sociétés dans le monde. Les vieilles institutions sont pour la plupart écartées du pouvoir et les régimes révolutionnaires se multiplient lors des décolonisations et de l’intégration progressive de l’Asie continentale au marché mondial, régimes dont la principale raison d’être est le développement économique. La crise économique de 1929 dérègle l’économie internationale et amplifie les conflits entre nations, qui réorganisent leurs systèmes sociaux et productifs. Une communauté internationale se constitue suite aux guerres mondiales, prenant en charge la régulation des conflits. Après une extension maximale, les régimes révolutionnaires, symbolisés par les États-Unis et la France au 19ème siècle puis par l’U.R.S.S. et les pays du tiers-monde au 20ème siècle, laissent place à une homogénéisation et une normalisation par l’économie de marché, le droit international et une libéralisation relative des mœurs.
Évènements majeurs : révolutions politiques, déclin progressif des structures sociales anciennes, démocratie libérale représentative, droits de l’homme, exode rural et urbanisation, transition démographique, industrialisation de la production, mondialisation financière et commerciale, bureaucratisation des États, crise de 1929, guerres mondiales et régimes totalitaires, génocides et démocides, création d’une communauté internationale, guerre froide, décolonisations, tiers-mondisme et libéralisation massive des mœurs.
Figures majeures : les idéologues et les orateurs politiques, l’individu, le citoyen, la femme comme sujet politique, les sociétés coloniales, les agents secrets, les bureaucrates, les ingénieurs, les entrepreneurs industriels, les grévistes, les émeutiers, les militaires, les ouvriers, les bourgeois, les travailleurs sociaux, les artistes, les intellectuels, les journalistes, les explorateurs, les touristes et les sportifs de haut niveau.
Objets majeurs : l’État-nation, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le code civil, les administrations publiques, le casier judiciaire, la métropole urbaine, le bidonville, les pays non-alignés, les USA, l’URSS, la S.D.N., l’O.N.U., l’école gratuite, les services socio-médicaux, le communisme, les syndicats, les sciences humaines et sociales, la biologie, le darwinisme, l’usine, le camp de concentration, le circuit électrique, le chemin de fer, le charbon, l’acier, l’artillerie lourde, le bateau à vapeur et à réaction, les hydrocarbures, la voiture, le supermarché, l’avion, la fusée, l’atome, l’ADN, le télégraphe, le téléphone, la photographie, le cinéma, la radio, la télévision et l’ordinateur,.
3) 1989-aujourd’hui : Modernité postrévolutionnaire, ou postmodernité, ou modernité tardive
Émergence d’une société civile mondiale homogène, nouveaux enjeux sociopolitiques et retour des États-nations :
Depuis 1989, l’histoire moderne se fait face à elle-même : de nouveaux défis sociaux et écologiques liées à l’urbanisation, à la consommation industrielle et à l’extension du marché mondial remettent en cause l’organisation socio-politique établie par les régimes révolutionnaires, c’est-à-dire la quasi-totalité des États-nations établis ou réformés depuis 1783. Le développement reste encore la principale raison d’être des régimes politiques, notamment en République populaire de Chine, même si un ralentissement durable touche l’ensemble des pays les plus développés, qui sont au cœur de la mondialisation. Certains postulent que, depuis la grande crise financière de 2008, des nouvelles guerres mondiales peuvent éclater, comme au début du 20ème siècle. Mais la source du conflit n’est peut-être entre États-nations ou entre groupes de nations, mais peut-être plus profonde, dans la relation que l’humanité a construite avec l’univers, depuis la modernité classique.
Évènements majeurs : tertiarisation et financiarisation de l’économie mondiale, technocratisation du politique, automatisation industrielle et commerciale, extension mondiale du libre-échange économique, grands défis écologiques, crise de la modernité politique, guérilla terroriste islamiste, régionalismes identitaires, régionalisation géopolitique.
Figures majeures : les idéologues et les orateurs politiques, la société civile mondiale, les prédicateurs musulmans, les conseillers, les actionnaires, les communicants, les agriculteurs bios, les paysans sans terre, les manifestants, les stars médiatiques, les tueurs de masse et les terroristes.
Objets majeurs : l’État-nation, la ville mondiale, les régions indépendantistes, les organisations intergouvernementales, les entreprises multinationales, les agences publicitaires, les associations, les lobbys, les ONG, l’écologie, le Parti Communiste Chinois, le Coran, le smartphone, la tablette tactile, le web, le drone, le robot, la cellule souche et les nanotechnologies.
31 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON