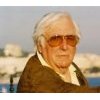1634-2008 : descendants des fondateurs du Québec, ils plaident pour leur retour en France
De Saint-Aubain de Tourouvre aux rives du Saint-Laurent
Il y a aujourd’hui 375 années en créant la « Compagnie des Cent Associés » sous la direction de Samuel de Champlain afin de favoriser le commerce avec la Belle Province et son peuplement, à partir d’un minuscule hameau de traite, nommé Québec, le cardinal de Richelieu décidait par ordonnance royale que tout Français établis au Québec, conserverait le droit de retour, la plaine possession de sa citoyenneté et de ses facultés juridiques en Amérique du Nord et dans le royaume.
par Bertrand C. Bellaigue
Cet anniversaire coïncide avec la démarche d’une citoyenne canadienne du Québec qui a introduit par la voie légale auprès de la chancellerie française une action en reconnaissance de sa nationalité française originelle.
Dans le mémoire qu’elle a présenté le 17 avril 2006, il y a exactement deux ans, Marie-Françoise Vallée, en demandant un passeport français, soulignait que, selon elle, en droit français les Québécois et autres Canadiens « originaire François » descendant des pionniers des débuts du XVIIe siècle sont toujours Français. Sa démarche a incité un nombre encore inconnu de Québécois à former une association sous le nom de « Collectif nationalité française » animé par Marie-Françoise Vallée et Gary Gagnon, descendant direct de la famille du même nom qui a quitté Tourouvre pour le Québec en 1634 et dont la maison de famille, une longère, toujours debout, se trouve sur la nationale n° 12 au carrefour de Sainte-Anne.
Me Christian Néron, son avocat, est allé puiser aux sources du droit français et a démontré dans un mémoire présenté au consulat général de France comment, en droit, le roi de France n’avait aucune capacité légale à céder le Canada - territoires et habitants - à la couronne d’Angleterre. Ainsi, comme cela fut relevé à l’époque, le Traité de 1763 n’a pas de fondement juridique en droit français, et tous les Québécois « originaires François » peuvent légitimement revendiquer la reconnaissance de leur inaliénable nationalité française ! Ce mémoire dont on mesure les conséquences considérables a été remis en son temps auprès de la Chancellerie du Consulat général de France à Québec qui a informé l’avocat de la demande de la requérante au ministère français de la justice pour examen et étude dans le courant du mois d’avril 2006.
Selon M.-F. Vallée, le Greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France l’a informée, en janvier 2007, que sa demande de passeport avait été refusée en vertu de l’article 30-3 (la règle des cinquante ans à l’extérieur de la France) du Code civil français. Cependant, il a signalé qu’en vertu des dispositions de l’article 30, « la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause » et lui a transmis la liste de tous les documents requis à titre de preuves, entre autres, celles de remonter jusqu’à deux générations en France.
La procédure suivant son cours, le conseil de M.-F. Vallée a déposé en septembre de la même année, au Consulat de France à Québec, tous les documents exigés afin de démontrer la nationalité française de la requérante, de même qu’un argumentaire sur la « possession d’état de Français ».
Les demandeurs étaient en février dernier en attente d’une décision du ministère de la Justice.
Ce cas a son importance. Il survient 380 années après la promulgation de l’ordonnance royale 1628, confirmée par celle du roi Louis XIV en 1664 pour garantir la pérennité de la nationalité française et de tous les droits qu’elle confère à tous les Français qui avaient émigré au Québec.
Loin d’être des aventuriers, des repris de justice ou des filles de joie, c’étaient de loyaux sujets de Sa Majesté, qui avaient été recrutés - pour raison d’État, celle du peuplement de la « Belle Province » - par une compagnie commerciale créée par le cardinal de Richelieu, sous le règne de Louis XIII pour le développement du commerce avec l’Amérique du Nord française et dont les activités se poursuivaient sous le règne de Louis XVI. Ce cas met en cause les traditions et les acquis juridiques français de la Royauté de droit divin à la Ve République. La question se pose : va-t-on reconnaître ces droits acquis qu’aucun texte - apparemment - ou provision d’obsolescence n’a abrogés. Tout jugement en cette matière ne manquera pas de créer une jurisprudence embarrassante pour le pouvoir.
Une autre interrogation se présente d’une manière encore plus précise, croit-on que beaucoup de Québécois aient envie de revenir à la mère patrie, compte tenu de l’importance que revêt aujourd’hui le Québec canadien en Amérique du Nord.
Ainsi commença Le Grand Voyage
Le 4 juin 1634 : un premier groupe de quarante-cinq Français vient de débarquer devant une station de traite appelée Québec dont la première occupation remonte à 1 608 par Samuel de Champlain qui explore le Canada. Propriété de la compagnie de la « Nouvelle France » qui y exploite le monopole royal français de la pelleterie, c’est un gros village, composé de maisons en rondins construites sur la rive Sud du Saint-Laurent. Ce grand fleuve a été baptisé ainsi en mai 1534 par Jacques Cartier, subventionné par François Ier, quand il a commencé à en remonter le cours, le jour commémoratif de ce saint martyr.
Une factorerie de 250 habitants
Québec, factorerie disputée entre les aborigènes Iroquois, qui en sont les occupants primaires, les Français et les Anglais qui ne vont pas cesser de se livrer à une lutte incessante dont l’enjeu sera ce territoire.
Mais, en 1632, les Anglais qui avaient occupé Québec pendant trois années en vertu de la loi du plus fort en avaient été évincés au terme d’un traité de paix signé à Saint-Germain-en-Laye le 29 mars 1632. Le gouvernement royal de Paris avait mis trois mois à en obtenir l’application, mais une accalmie est constatée. La centaine de Français employés de la « Compagnie de la Nouvelle France » qui en avait repris possession avait dû se remettre au travail pour relever les ruines laissées par l’adversaire.
Samuel de Champlain avait pu y revenir deux mois plus tard en mai de la même année. C’est lui qui en personne, investi de la confiance du roi Louis XIII, accueillerait le 4 juin 1634 les premiers pionniers que son « agent général », on dirait aujourd’hui fondé de pouvoir, avait pu recruter dans sa province d’origine, le Perche. Ces gens constitueraient le noyau originel de la « colonie » qu’il voulait fonder depuis si longtemps. Pour lui ce jour-là, à 65 ans, était plus que symbolique : il marquait l’aboutissement d’un rêve qu’il avait commencé à faire vingt et un ans auparavant, en 1603 lorsque, fils de marin explorateur, après un voyage d’études aux Indes occidentales, il avait réussi à suivre dans une expédition au Canada, le titulaire du monopole commercial pour l’Amérique du Nord qui avait été concédé par le roi à Aymar de la Chaste. C’est à ce moment qu’il avait commencé à explorer des rives d’une grande rivière de là-bas, nommée Saint-Laurent. Il débuta en qualité d’adjoint d’Aymar de la Chaste qui avait obtenu le renouvellement du monopole commercial. Il y passa sa vie et vécut en famille, se bornant à retourner en France tous les hivers pour faire du « lobbying » en faveur de la création d’une colonie en Nouvelle France. C’est avec un livre publié par privilège royal en 1632 qu’il avait obtenu les appuis nécessaires au véritable lancement de la campagne d’émigration vers la « Nouvelle France » dont l’organisation avait été confiée à la « Compagnie des Cent associés » Ce livre portait un très long titre. Dont la teneur est reproduite ci-dessous en français de l’époque :
« À Monseigneur le duc de Richelieu »
« Les voyages de la Nouvelle France occidentale dicte Canada »
« Par le Sieur de Champlain, Xainctongeois, capitaine pour le roy en la Marine du Ponant & de toutes les découvertes qu’il a faites en ce pays depuis l’an 1603 jusque l’an 1629. »
« Où se voit comme ce pays a été premièrement découvert par les Français sous l’autorité de ses roys très chrétiens, jusque au règne de Sa Majesté à présent régnante Louis XIII, roy de France et de Navarre »
Avec les cartes de ce pays et le catéchisme résultat du travail des Français en langage des peuples sauvages, avec qui il a passé en ladite Nouvelle France l’année 1631.
La Nouvelle France
À la lecture des rapports d’explorateurs tels que Samuel de Champlain parti pour les Amériques, Son Éminence avait décidé de « baptiser » officiellement « Nouvelle France » les territoires sauvages baignés par le grand fleuve Saint-Laurent. Il veut en faire une France d’Outre-Mer. Ce sera, espère-t-il, une des grandes œuvres de son mandat royal. À une époque où la reine de France est une infante espagnole, Son Éminence sait fort bien combien les Amériques ont pu rapporter d’or à la couronne de Castille. Il est impressionné par les rapports qu’il a reçus d’Angleterre et qui lui montrent combien les coffres de la couronne, déjà bien remplis par Élisabeth I continuent à recevoir l’or que procurent à ce royaume ses grands comptoirs coloniaux et sa marine. Pendant ce temps, la France demeure un pays dont 80 % de l’économie procèdent de l’agriculture, peu douée pour le commerce que la puissance sociale en place, l’aristocratie, considère comme une cause de déchéance. Le royaume de France serait-il à la traîne ?
En ce début du XVIIe siècle, les royaumes les plus puissants d’Europe s’étaient lancés dans de grandes explorations en Asie et en Amérique qui marquèrent les débuts de l’histoire de la colonisation. Il n’y avait eu vraiment que des esprits entreprenants et aventureux pour songer à se lancer dans l’aventure de la colonisation de peuplement, qui tout bien comparé, était, à l’époque, considérée comme beaucoup plus dangereuse que ne peut l’estimer n’importe quel élève de collège accoutumé au départ régulier des navettes pour l’espace. Aujourd’hui, la Lune leur paraît beaucoup plus près de la Terre que n’était l’Amérique vue depuis la France, pour les sujets des rois Louis XIII et Louis XIV.
Le Malouin Jacques Cartier, au XVIe siècle, « avait pris possession du Canada ». Il avait été suivi par Samuel de Champlain, véritable chef d’entreprise coloniale. Il avait été porté par un rêve qui lui avait fait concevoir un Québec français riche, fort et bien structuré. Il avait déjà à son actif la fondation d’une première colonie en Acadie. Il avait créé la « station » de Québec. Et le grand pays virtuel qui l’entourait avait été nommé « la Nouvelle France ».
Au même moment, un philosophe, René Descartes écrivait Le Discours de la méthode. Un siècle d’or commençait en Europe, celui de la musique baroque et du classicisme.
Le gouvernement du cardinal de Richelieu, à l’instar de celui de la reine Élisabeth d’Angleterre puis de Charles Ier, avait doté le royaume d’une nouvelle flotte. Le cardinal avait compris que pour enrichir le royaume il ne fallait pas seulement compter sur le terroir, - ce que Sully désignait en affirmant que « Labourage et pâturage étaient les deux mamelles de la France » - mais que l’on devait aussi étendre son commerce au monde entier.
Les nouveaux colons du Québec seront
pour toujours des Français à part entière, décrète richelieu.
Le monde entier à l’époque comprenait aussi les Indes, le royaume de Cipango et les Amériques.
Les royaumes d’Espagne, du Portugal et d’Angleterre, pays de marins audacieux, avaient déjà pris une très large avance et la puissance de leur flotte narguait celle des Français. Il fallait également, après avoir chassé les protestants - l’ennemi intérieur - récupérer - on dirait aujourd’hui la matière grise - ou ce qui en restait chez les aristocrates et les bourgeois catholiques. S’adonner au commerce et à la banque était pour la noblesse une façon de déroger. Richelieu avait fait publier en 1629 un décret instituant que la collaboration, la participation financière à de grandes compagnies coloniales n’impliqueraient pas cette déchéance. À vrai dire, il eut moins de succès qu’il n’espérait. Toutefois, il put trouver suffisamment de gens entreprenants, dotés d’un esprit suffisamment aventurier pour le suivre dans son grand dessein commercial. Il allait créer, comme l’Angleterre l’avait fait avant lui, de grandes compagnies maritimes à comptoirs (celle des Indes orientales et celle des Indes occidentales), la compagnie des îles d’Amérique à la Guadeloupe et à la Martinique. Une des premières à être constituées avait été celle des « Cent associés ». Le décret de 1629 permit de composer un « conseil d’administration composé à égalité de cinquante membres du tiers état et de la noblesse ».
C’est à cette compagnie privée créée dès 1627 qu’on doit la mise en valeur de la Nouvelle France puis son peuplement, devenu indispensable pour disposer des bras nécessaires au développement de son agriculture et de son artisanat. Le premier peuplement de la « Nouvelle France » ancêtre du Québec moderne est dû à cette compagnie. Louis XIII avait accepté de lui octroyer une « charte royale ». Richelieu avait écrit au souverain à ce sujet en lui précisant que le but de la Compagnie serait « d’exciter d’autant plus les sujets de votre majesté à se transporter dans ces dits lieux et y faire toutes sortes de manufactures. »
La Compagnie s’engageait en contrepartie à ce que « tous les artisans au nombre de ceux que les Associés s’obligent de faire passer au pays » et qui « auront exercé leur art et leurs métiers en Nouvelle France durant six ans, en cas qu’ils se veuillent retourner en notre Royaume seront réputés pour maîtres d’œuvre et pourront (par conséquent) tenir boutique dans Paris et autre ville. » Que de promesses alléchantes dans une société figée !
Les pionniers français de la Compagnie, en application d’une mesure d’avant-garde pour l’époque, avaient le droit de revenir dans a Métropole tous les trois ans en congé payés voyage compris. Mais cela ne fut pas suffisant car, déjà en ce temps-là déjà, les sujets de sa majesté très française étaient casaniers, peu entreprenants et rechignaient à s’expatrier. De telle sorte que l’appel du grand large de la Compagnie n’eut pas d’emblée le succès sur lequel comptait le gouvernement royal pour mener à bien sa politique de peuplement de la Belle Province.
Dans le but de rassurer les candidats français tentés par l’aventure américaine, le cardinal de Richelieu, désireux, en son article XII de l’acte établissant la Compagnie des Cent associés pour le commerce avec le Canada, proclamait que « Sa Majesté ordonnera que les descendants des François qui s’habitueront audit pays, ensemble les sauvages qui seront amenés à la connaissance de la foi et en feront profession, seront censés, et réputés naturels François, et comme tels pourront vernir habiter en France quand bon leur semblera, et y acquérir, tester, succéder et accepter des donations et légats, tout aussi que les vrais régnicoles et originaires François, sans être tenus de prendre aucunes lettres de déclaration ni de naturalité. »[i]
L’esprit et la lettre de la Charte qui plaçait les « particuliers » sous le commandement des « Cent associés », constituent le cadre légal de la Nouvelle France, sans aucune intervention de l’État. Les « Cent associés » sont chez eux et les maîtres dans la « Belle Province ». Il était également prévu dans la Charte que serait également à la charge de la « Compagnie » le « recrutement de jeunes filles destinées à pourvoir la Colonie en épouses et mères ». Ainsi désignés les « particuliers » pouvaient être aussi bien « des seigneurs, que des marchands et ou des représentants d’institutions religieuses comme la Société de Montréal. »
L’engouement des candidats ne fut pas aussi intense que l’espérait le cardinal dans les premières décennies. Ce qui tend à prouver que, tout compte fait, on ne vivait pas assez mal dans le royaume de France au XVIIe siècle pour qu’une partie de la population soit contrainte à l’exil vers des terres inconnues. En effet, depuis l’année 1634, considérée comme celle de la création du Québec, jusqu’au XVIIIe siècle, les sergents royaux commis dans les ports d’Amérique n’ont pas compté plus de 15 000 immigrés en Nouvelle France.
Devant le succès relatif de son initiative, le gouvernement royal, qui subissait déjà la pression du gouvernement royal britannique, n’avait pas tergiversé sur les avantages à donner aux nouveaux pionniers d’Outre-Mer.
Louis XIV lui-même avait fait adopter, en 1664, une ordonnance dont les effets recherchés devaient améliorer et renforcer les dispositions du décret de Richelieu en 1628.
L’article XXIV de l’ordonnance du Roi Soleil établissait que, pour favoriser d’autant plus lesdits concédés, et porter à nos sujets à s’y habituer, nous voulons que ceux qui passeront dans ces dits pays jouissent des mêmes libertés, et franchises que s’ils étaient demeurant en ce royaume, et que ceux qui naîtront d’eux et des sauvages convertis à la foi catholique, apostolique et romaine soient censés et réputés être régnicoles et naturels français, et comme tels, capables de toutes successions, dons, legs et autres dispositions, sans être obligés d’obtenir aucune lettre de naturalité. »
La « Compagnie de Cent associés » créée à l’initiative de Samuel de Champlain et de ses amis du « lobby » américain de Saint-Germain avait été organisée par cent aristocrates et marchands en vue de mettre en valeur les richesses de la vallée du Saint-Laurent, où existait déjà un comptoir d’import-export dans un village nommé naguère Québec par les aborigènes. Une centaine d’habitants y avait édifié des remparts en prévision des incursions lancées par les guerriers de la tribu Iroquois.
Le village fortifié servait de base au commerce des peaux et fourrures. Richelieu avait entendu les suppliques de Samuel de Champlain, son gouverneur, dont le rêve, avec quelques hommes d’affaires et aventuriers, revenus du Canada, était de créer un véritable pays dans le Nord de l’Amérique. C’est eux qui formèrent le « lobby américain » du règne de Louis XIII.
Les créateurs de cette entreprise coloniale d’économie mixte avaient quinze ans pour réaliser l’objectif que leur avait assigné le gouvernement royal.
Constatant l’enthousiasme modéré qu’avait provoqué cette idée royale de lancer ses sujets vers l’aventure, il fallait bien trouver un moyen, un endroit où l’on trouverait, malgré tout, des volontaires.
Un drôle d’apothicaire
Il se trouva qu’au sein du « groupe des Américains » de Paris, contemporains ou compagnons de Champlain se trouvait un apothicaire de Mortagne au Perche, nommé Robert Giffard. Fils d’un trompettiste crieur public d’Autheuil, village voisin de Tourouvre-au-Perche. Ses parents n’étaient cependant pas pauvres. Il alla à l’école, devint apothicaire à Mortagne, où il vendait ses herbes et ses remèdes, avant de s’embarquer pour l’Amérique du Nord et le Canada où il passa cinq ou six ans à courir les forêts du Grand Nord. Il y gagna beaucoup d’argent. Son retour en France allait coïncider avec la création de la « Compagnie des « Cent associés ». Le groupe des « Anciens d’Amérique » le fit coopter en qualité « d’agent général » de la compagnie dans sa province d’origine, c’est-à-dire le Perche. Il s’était vanté d’avoir les moyens d’y trouver toute la main-d’œuvre dont avait besoin sa compagnie au Québec. Il se vit concéder la Seigneurie de Beaufort par la nouvelle compagnie. Était-il devenu franc-maçon ? Comme la mode venue d’Angleterre s’étendait sur le continent après avoir exercé une influence considérable dans les colonies d’outre-Atlantique où le « siècle des Lumières » allait faire de nombreux adeptes ? On ne sait trop. On sait seulement qu’il a été, du jour au lendemain, considéré comme le « chef de file » des Français de Tourouvre immigrés au Québec et qu’il a su profiter de leurs services, garantis par acte notarial pour une durée d’au moins trois ans, en mettant à profit tous les avantages et privilèges qu’accordait la royauté aux gens de son état, 150 ans avant la Déclaration américaine des droits et la Révolution française.
Le dessein de Giffard, on le voit, n’était pas d’organiser une œuvre de bienfaisance. Il savait qu’il ne fallait pas perdre de temps. De plus, en cette époque encore féodale, il était fermement conseillé aux bourgeois du Tiers État de prendre toujours très au sérieux ce que « désirait » la noblesse. Or, la « charte royale » avait octroyé quinze ans - pas plus, pas moins - à la compagnie pour réunir une force « colonisatrice » de quatre mille hommes et femmes.
Robert Giffard était donc retourné dans son pays natal. Il savait parfaitement que c’était un pays pauvre où survivait dans la misère une paysannerie sans autre espoir que le Paradis, à condition d’être de bons chrétiens. Il avait l’intention d’y recruter autant de gens qu’il pourrait pour mettre en route les affaires de sa compagnie. Il avait quelques raisons d’être optimiste.
Il connaissait bien le Perche. Vieille province limitée par la Normandie, le Maine et la Beauce. Il savait ce que valaient ses habitants et ce qu’ils faisaient. C’étaient des artisans, des ferronniers, des bûcherons et des charbonniers, des laboureurs et de tout petits fermiers. Tous très durs à la tâche.
Il n’y avait pas d’animaux de trait. Il faudrait attendre le XIXe siècle pour que le chemin de fer fût inventé, et qu’on y introduisît l’élevage des chevaux « percherons » qui emporteraient les usagers du chemin de fer de leur domicile à la gare.
Robert Giffard sait d’avance que sa chasse au pionnier va être bonne. Les faits lui donnent raison. Quatre-vingts familles vont quitter le Perche au XVIIe siècle. Près de trois cents personnes. Les noms patronymes de ces « esclaves contractuels » sont bien connus de nos jours au Canada, au Québec où ces pionniers à la fois bons chrétiens et durs à la tâche, conduits par des entrepreneurs sans scrupule, mais intelligents, se sont multipliés : qui n’a pas entendu parler (par ordre alphabétique) des Aubins, des Brunet, des Couvrette, des Giguère, des Gagnon, Lambert, Lessard, Mercier, Paradis, Pelletier, Poulain, Prévost, Rouleaux, Rousseau, Tremblay et l’on en passe...
Les paysans du Perche, qui vivaient autour de Tourouvre accepteraient, il en était sûr, de troquer l’existence médiocre qu’ils menaient les pieds dans la glèbe, contre un avenir incertain, mais nouveau qui leur ouvrirait les portes d’une liberté inconnue en Europe et, pourquoi pas, d’une certaine aisance.
Ces paysans tourouvrais étaient les héritiers d’un lourd passé. Ils conservaient la mémoire des invasions normandes et de leurs luttes ancestrales contre les Vikings qui s’emparaient de leurs terres. L’inconscient collectif avait conservé la mémoire des combats qu’ils avaient menés pour les mêmes causes contre Guillaume le Conquérant. Ils gardaient le souvenir des destructions sauvages auxquelles avait donné lieu la « guerre de Cent Ans entre Français et Anglais », entre Capétiens et Plantagenets, avec ses tragédies, ses villages et ses fermes incendiées, ces femmes violées et ces paysans que les cavaliers anglais traquaient comme des « dix corps » dans les forêts percheronnes, avec une mort certaine annoncée, pour les plus jeunes et les plus âgés qui ne supportaient pas les rigueurs de l’hiver sans un toit.
Il y avait eu tellement d’années de souffrance, de pénibles travaux et de faim à cause du mauvais temps et des mauvaises récoltes que ces « laboureurs », ces propriétaires de fermes, ces manœuvres n’allaient pouvoir que répondre « oui » à Giffard.
UN HABILE TRIO
Robert Giffard s’était adjoint deux autres compatriotes tourouvrais et naturellement pas des moins importants. Les frères Juchereau, Noël et Jean. Ces deux nobliaux et tabellions royaux devinrent ses « acolytes », ses « sergents recruteurs ».
Leur père était un notable. Il est greffier, mais également homme d’affaires ; marchand de vin et marchand de bois, métier tout à fait profitable dans un pays de forêts primaires profondes à une époque où les gouvernements royaux et leurs Premiers ministres avaient compris qu’il fallait à la France une forte marine.
Ces braves gens sont aussi des paroissiens assidus de l’église de Saint-Aubin où ils ont été baptisés. Tous leurs noms sont encore là. Ils sont consignés depuis plus de trois siècles dans les archives paroissiales et départementales. Rien n’a bougé, en dépit des guerres.
Les frères Juchereau présentent l’avantage d’avoir un « bon profil » professionnel. Ce sont des « gens de robe ». Ils jouissent également d’un avantage social : on les qualifierait aujourd’hui de « fils-à-papa » ou de « papa-m’a-dit ». C’est à leur géniteur qu’ils doivent richesse, puissance et considération dans leur fief. À eux trois, ces hommes vont former un joli trio de « durs », sans trop de scrupules, réalisant leurs plans sans état d’âme. Ils poursuivent leur étoile filante et celle-ci vient de se poser au-dessus du fleuve Saint-Laurent au Canada. Ils ont obtenu un monopole grâce auquel ils comptent bien mettre un pays lointain en coupe réglée. Il va leur falloir de la main-d’œuvre peu coûteuse. Ils vont en avoir. Elle sera plus chère que le bois d’ébène qu’il faut aller chercher sur la Côte de l’Or, mais elle sera dure à la tâche et capable de surcroît de procréer la colonie de peuplement qu’exige la Couronne.
Le personnage le plus important du trio, le plus puissant, sinon le plus noble, demeure Roger Giffard. Mais les frères Juchereau viennent d’entrer dans la noblesse par la porte de service. Cela était fréquent. Un second mariage de leur père avec une jeune femme, à la fois belle et riche, la marquise de Blavou, leur avait ouvert les portes de l’aristocratie provinciale. Ce qui était toujours mieux que d’aller fréquenter comme naguère, par les soirs de beuverie, les filles d’arrière-salles des petits boutiquiers et les putes de tavernes d’où ils étaient sortis.
Parmi leurs compatriotes et leurs amis d’enfance, il y a aussi Jean Guidon. C’était un entrepreneur important du village ; un maître maçon qui s’était rendu célèbre en construisant l’escalier en colimaçon de l’église de Saint-Aubin encore solide en l’an 2001.
C’était exactement le type d’homme dont avait besoin Roger Giffard pour faire du recrutement « professionnel » en vue d’entreprendre la construction d’un nouveau pays au-delà de l’océan Atlantique.
Le maçon tourouvrais fut le premier à accepter son invitation à le suivre en « Nouvelle France ». Enfin décidé, il signa en mars 1633 un contrat d’engagement draconien devant Me Choiseau, notaire à Tourouvre.
Les Juchereau étaient aussi de proches amis des Gagnon. Amis plus riches, plus importants et probablement assez amicaux à l’égard d’une famille typique de paysans de la paroisse de Saint-Aubin.
La famille Gagnon - parfois dite Gaignon - est de vielle souche tourouvraise. Elle a vécu pendant des temps immémoriaux dans le hameau de la Gagnonnière. Elle a traversé les siècles, comme le vieux chêne foudroyé de la forêt de Tourouvre, comme beaucoup d’autres familles de la « Vieille France ». L’aspect émouvant de cette histoire tient au fait qu’il est encore possible de voir près de la route N12 ce hameau d’une dizaine de maisons parmi lesquelles, il y a des habitations du XVIe siècle qui abritent une ferme laitière d’une soixantaine de vaches, décrite comme l’ancienne demeure de cette famille. Du moins c’est ce qu’on vous affirme à Tourouvre. J’ai visité avec émotion cette « longère » - ainsi qu’on désigne encore une maison de ferme dans le centre de la France. Autour de cette maison dominée par un immense marronnier d’Inde, il y a quelques résidences secondaires de Parisiens, restaurées comme le veut la « tendance », dans le « style campagnard élégant ».
Quand les Gagnons se rendaient dans leur paroisse, à l’église de Saint-Aubin, pour assister aux offices, ils faisaient toujours une petite halte au carrefour de leur chemin vicinal où se trouve encore, à proximité de la route Nationale 12, le petit oratoire de Sainte-Anne, encore fleuri de nos jours, où ils venaient prier.
C’était une famille nombreuse. Le père, Pierre Gagnon, fils de Barnabé et Françoise Crête, avait épousé Renée Roger en 1598. Ils avaient eu sept enfants dont Marguerite, née en 1598, Mathurin en 1606, Jean en 1610 et Pierre baptisé en 1612, tous les quatre, pionniers de la Nouvelle France.
Roger, né en 1628, quittera, en 1628, la Ventrouze où demeure sa tante Renée Roger, pour rejoindre ses cousins en « Nouvelle France ».
Pierre, le père était laboureur - terme qui a l’époque était l’équivalent du moderne « exploitant agricole ». Il travaillait sur ses terres, mais se louait aussi par monts et par vaux, comme le font encore les petits propriétaires qui, pour limiter les frais d’exploitation de leurs terres, forment ainsi de petites coopératives.
Il fallait bien nourrir une famille nombreuse ! Il mourut à la tâche entre 1630 et 1633. En 1610, sa femme et ses enfants allèrent vivre dans une maison de la Ventrouze, à 6 km de Tourouvre. Dans ce village, ils étaient devenus voisins de la famille Juchereau. On ne sait pas très bien si ces derniers furent amis proches ou des voisins plus opulents et protecteurs. Quoi qu’il en fût, on voit le nom de Noël Juchereau figurer dans les actes d’état civil de la famille. Il est témoin au mariage de Louis Gagnon. Il est également témoin lors de la signature du contrat d’achat de la nouvelle maison des Gagnon à la Ventrouze en 1610.
Amis ou notaires de la famille Gagnon, les frères Noël et Jean Juchereau n’auront pas de mal, au moment de la mort du père, Pierre, à convaincre ses fils de les suivre dans leur aventure américaine.
DES CONTRATS DRACONIENS
La vertu de l’exemple fonctionna. Ce qui avait commencé dans le cadre d’un haut dessein macroéconomique destiné à faire du royaume de France une des grandes puissances de l’Europe, se réalisa, selon les coutumes locales habituelles faites de petites magouilles familiales et paroissiales. Dans les démarches entreprises par les agents de la « Compagnie », il n’y avait apparemment plus rien d’administratif. La seule procédure légale qui subsistât était la visite obligatoire chez le notaire local pour la signature d’un contrat en bonne et due forme qui interdirait aux volontaires de revenir sur leur décision avant leur départ pour l’Amérique. Clap ! Le piège se refermait !
Cette procédure présentait l’avantage de maintenir les hésitants dans le cadre de la loi, et de les soustraire aux conciliabules, aux cooptations entre voisins, collègues et amis. Le Perche était devenu pour les associés « un terrain de chasse exceptionnel ». C’était un pays de petites propriétés. Que possédaient les paysans ? Quelques vaches laitières, des moutons, un peu de prairies, un ou deux hectares de terre à céréales. Chaque homme dans le pays savait labourer, mais connaissait presque tous les autres métiers manuels que l’on doit pratiquer à la campagne. À cette époque, faute de bêtes de trait, plusieurs hommes tiraient ensemble la charrue conduite par un autre. Chacun savait semer. On pouvait être maçon, charpentier, scieur de long, charron et chaudronnier, manœuvre ainsi qu’une liste d’expatriés en donne une idée dans les archives de Me Choiseau à Tourouvre, où sont conservés les contrats d’une quarantaine de pionniers qui s’étaient engagés à servir le « seigneur » (sic) Giffard « pendant 36 mois ». La voie avait été ouverte par le premier départ en 1634, d’une quarantaine de Tourouvrais accompagnés de leurs femmes et enfants. Le mouvement migratoire déclenché par le trio tourouvrais se confirma. D’autres embarquements eurent lieu entre 1646 et 1652. Dix-huit ans s’étaient écoulés depuis le premier.
Les traces notariales de leur départ se trouvent notamment dans une des listes de candidats au voyage. Les détails qui y sont inscrits constituent une source sûre d’informations précieuses sur la façon dont étaient négociés les embarquements et la condition sociale des émigrants. Un de ces bordereaux mentionne vingt-sept célibataires, trois ménages et sept « non-mariés » qui devaient avoir abandonné dans la région quelques maîtresses au long cours.
On peut y lire que la plupart des célibataires avaient reçu une paire de chaussures, des vêtements de laine, un autre un chapeau et un manteau. Les ménages se voyaient assurer un salaire annuel de 120 livres (le mari 90 £ et l’épouse 30 £). Les célibataires manœuvres ou artisans percevraient selon les cas (inexpliqués) de 50 £ à 100 £ par an de salaire. Les frais de logement ainsi qu’une partie de leurs dépenses en nourriture seraient payés par l’employeur. À l’époque 3 kg de pain valaient une livre. La totalité du pécule, on dirait aujourd’hui dans l’armée « prime de départ », représentait au prix courant du marché hebdomadaire de 150 à 300 kg de pain. Mais à combien se montait la commission de la compagnie des « Cent associés » perçue pour le recrutement de chaque émigrant ? La réponse n’existe apparemment nulle part.
Il faut rappeler qu’au XVIIe siècle, la société française était soumise au roi tout-puissant et surtout, localement, à des seigneurs auxquels elle devait rendre hommage, tribut, et s’acquitter d’impôts tels que la taille et la gabelle. Il était aussi utile de se montrer généreux à l’égard des innombrables intermédiaires « payants » qui s’interposaient entre les détenteurs d’une parcelle de pouvoir et ceux qui en étaient démunis.
Les premiers expatriés avaient donc quitté leur maison en 1634. Ils avaient emporté quelques économies. Ils n’avaient pas eu à abandonner de terre pour la simple raison qu’ils n’en possédaient aucune. La plupart d’entre eux n’étaient que de simples métayers. Ils n’avaient pu compter sur aucun héritage d’un « fonds » paternel. Pour ces derniers, l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie quotidienne avait pesé d’un poids considérable dans leurs décisions.
L’illusion lyrique
Il y eut probablement un autre facteur pour les influencer. Ces expatriés, dont la majorité était constituée de « manants », hommes et femmes, n’étaient pas des « hommes libres » - loin de là. On était encore loin du temps où les colons américains adopteraient la « Déclaration des droits du contribuable américain » en 1774 à Philadelphie, encore plus loin de la Révolution de 1789.
On connaît l’adage : « Il n’y a que des gens sans espoir pour faire de bons immigrants. »
Leur motivation principale avait été la promesse, exprimée par Robert Giffard, de se voir octroyer un terrain agricole de quelque cent hectares auxquels, avait-il juré, ils pourraient avoir droit au terme de leur séjour contractuel de trois ou six ans, selon les cas. Il s’agissait pour ces paysans de l’exceptionnelle perspective de recevoir une terre dite fertile sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Les archives du cadastre québécois montrent que ces bandes de terre, tracées verticalement par rapport la rive du fleuve, mesuraient chacune quelque 250 mètres de large sur 4 250 mètres de long, et couvraient 106 hectares alors que dans la région de Tourouvre, où les immigrés ne possédaient généralement rien, la superficie moyenne d’une exploitation agricole en pleine propriété n’était jamais plus de 2 à 3 hectares en 1634. Même de nos jours, la superficie moyenne des exploitations agricoles dans l’Orne ou dans le Gâtinais est de l’ordre de 80 hectares en l’an 2001 !
Après leur arrivée devant la « station » de Québec les immigrants furent placés au service des aristocrates locaux qui tenaient le haut du pavé en « Nouvelle France ». Dans ce noble environnement colonial, Robert Giffard avait oublié que son roturier de père était trompettiste et annonceur public à Tourouvre - il n’y a pas de sot métier - et menait un train de vie seigneuriale.
Mais les Gagnon ou autres « amis » des frères Juchereau, où avaient-ils été installés ?
Quoi qu’il en soit, le 4 juin 1634 est un jour qui mérite d’être marqué d’une pierre blanche pour les Québécois comme étant le début officiel de leur histoire.
Cette pierre blanche, devenue un peu grise avec le temps, existe encore dans l’église de Tourouvre ; on y a gravé ces mots :
« Aux Canadiens baptisés à Tourouvre »
« Je me souviens ».
Quarante Percherons convaincus d’aller refaire leur vie en « Nouvelle France » s’étaient donc embarqués dans le port de Dieppe, en Normandie. À l’appareillage, leur flottille comprenait trois vaisseaux. En cours de traversée de l’Atlantique, un quatrième leur avait été adjoint, une frégate anglaise, fortune de mer, capturée par le capitaine Bontemps et ses corsaires.
Le jour où tout a commencé
En arrivant à Québec, les vaisseaux mouillèrent devant la basse ville où les immigrants furent reçus sur une place délimitée par quelques bâtiments assez délabrés construits par les premiers occupants de ce territoire indien en 1608. C’est ce qu’on nommait la « place Royale » flanquée d’une église construite par des moines Récollet en 1615.
Samuel de Champlain leur avait réservé un accueil solennel au nom du roi. Il était venu avec une suite de pères jésuites, d’officiers d’administration, ancêtres des personnages de Courteline sur le sol américain. Ainsi les nouveaux arrivants furent-ils rassurés de voir que le pays où ils allaient travailler pour le compte de la « Compagnie » était fermement tenu en mains par des serviteurs de Dieu et du roi !
Au Nord-Est, sur les hauteurs dominant le fleuve et la basse ville, il y avait le fort Saint-Louis dont le rôle était de protéger cet « habitat », cet établissement colonial contre les tribus d’Iroquois qui ne cessaient de menacer les colons avec leurs raids sauvages. Non loin de là, le logis des jésuites et l’église Notre-Dame-de-Recouvrance qu’on venait de construire. Au-delà, s’étendaient les terres de trois domaines que mettaient en valeur les premiers colons de la Nouvelle France. Sur la hauteur également, avait été construite la « maison des Cent associés ». Les hauts responsables de la factorerie expliquèrent aux nouveaux venus que les fonctionnaires qui y étaient affectés par la Métropole payaient le salaire du gouverneur et entretenaient à leurs frais les religieux. La petite population de l’établissement considérait cette « Maison » avec respect et solennité. C’était, elle le savait, le lieu où seraient prises des décisions politiques et économiques dont son avenir allait dépendre.
Ces immigrants, encore étourdis par leurs jours de mer, après être sortis de leur trou forestier primitif, n’en croyaient pas leurs yeux, car en France, dans leur village, ils ne voyaient jamais venir à eux que de pompeux sous-fifres de l’autorité royale de province.
À cette époque la population de la « Nouvelle France » comptait à peine plus de 250 personnes, une colonie percheronne comptant les 43 nouveaux immigrants, 21 autres qui étaient arrivés en 1628 auxquels s’étaient ajoutés le personnel de « la Compagnie » des soldats, des fonctionnaires d’administration, des interprètes, des engagés, avec leur suite de jésuites et leurs serviteurs, en tout quelque deux cents personnes. [ii]
On répartit les nouveaux venus dans ces vieux bâtiments avant de les expédier dans les mois ou années qui suivraient leur arrivée, dans les différents fiefs qui étaient exploités sous le contrôle de « la Compagnie ».
Au nombre de ces fiefs, il y avait la seigneurie de Beaufort qui avait été ajoutée aux trois autres fiefs concédés antérieurement : celle du Sault-au-Mathelot à Louis Hébert (1626), celle de Notre-Dame-des-Anges en 1626, et des Trois Rivières aux jésuites en 1634.
Très peu de Français savent à l’époque que des navigateurs sortis des ports atlantiques du Royaume, une petite poignée, s’étaient lancés depuis le début du siècle, à l’aide de subventions d’armateurs éclairés et de seigneurs proches de la Cour, dans l’exploration du continent nord-américain et notamment de cette province lointaine baignée par un grand fleuve, le Saint-Laurent. Il y eut des débuts audacieux en 1608, lorsque M. de Champlain avait décidé de s’emparer par les armes d’un camp de la tribu aborigène des Iroquois nommé Québec.
Théophraste Renaudot, considéré comme le créateur de la presse française, n’avait pas encore reçu du père Joseph ni du cardinal de Richelieu le pressant conseil de créer sa « Gazette » pour y louer la sagesse d’un règne. Peu de gens avaient entendu parler de la « Nouvelle France » sinon au moment où la France entre en guerre contre l’Angleterre.
Le camp indien que Samuel de Champlain avait trouvé, sur la rive gauche fleuve Saint-Laurent est un lieu propice à l’installation d’une colonie de peuplement française dans les solitudes glacées du nord de l’Amérique.
Depuis vingt-six ans, ce hameau des trappeurs est devenu un village où moins de deux cents habitués viennent vendre les fourrures d’animaux sauvages qu’ils ont chassés. C’est pour eux un lieu de repos après avoir couru les forêts pendant la plus grande partie de l’année. Ils forment une petite population qui est un ramassis de coureurs de bois et de trafiquants qui ont trouvé quelques avantages à vivre sous l’autorité du lieutenant royal. Ce sont en général des célibataires, des aventuriers, souvent acoquinés, à leurs risques et périls, avec des esclaves « indiennes », filles du pays, car ni les Hurons ni les Iroquois n’aimaient beaucoup que leurs « squaws » aillent folâtrer avec des étrangers blancs. La principale activité commerciale de la factorerie, son « monopole », est fondée sur le commerce et l’exportation des fourrures et des peausseries vers la Métropole.
Sans probablement s’en rendre compte, ces hommes de sac et de corde ont été les premiers témoins des prémices d’un fantastique bouleversement annoncé par le départ, momentané des Anglais, fait historique sans précédent, qui sera considéré dans les siècles à venir comme l’acte créateur d’une « colonie de peuplement » par une entreprise capitaliste royale d’État et la transformation progressive en une grande nation de ces vastes territoires de chasse lointains et désertiques d’Amérique du Nord.
Samuel de Champlain ne savait pas lui non plus que ce jour de gloire pour lui, aboutissement du projet de toute une vie, serait le dernier acte éclatant de son existence. Il mourut six mois plus tard, à 65 ans en décembre 1635. Du coup, sa vie de pionnier fut transformée en « destin de créateur d’empire » dont on parle encore de nos jours.
LE PREMIER DE TOUS LES COLONS FUT UN APOTHICAIRE.
Louis Hébert, apothicaire de son métier, comme l’avait été Robert Giffard, devenu fondé de pouvoir des « Cent associés » au Québec, était arrivé en famille dix-sept ans auparavant, en 1617, avec sa femme, Marie Rollet, ainsi que leurs trois enfants. Il avait été le premier agriculteur de la colonie, « le véritable père du peuple québécois », affirment certains historiens canadiens. L’agriculture étant le meilleur des métiers à condition d’en sortir, il devint procureur du roi, charge anoblissante qui en fit un des notables de la « Nouvelle France » tandis que les nouveaux venus, portés par l’espoir de devenir un jour propriétaires, allaient être rigoureusement soumis « comme des esclaves temporaires et rémunérés » au terme des contrats qu’ils avaient signés par devant notaire avant leur départ de Tourouvre. Ces actes les liaient pour des durées déterminées - trois à six ans - aux « seigneurs » de la « Compagnie » dans la nouvelle province.
Ad majorem gloriam...
Les jésuites, plus que jamais focalisés sur la nécessité de conquérir de nouvelles âmes « ad majorem dei gloriam » pour la plus grande gloire de Dieu, avaient suivi Champlain dans la vallée de la rivière Saint-Charles, où ils installèrent en 1625 les fondations de leur maison mère en terre indienne dans la seigneurie des Anges.
Leur présence et leurs projets allaient susciter quelques problèmes au vice-roi quand ces hommes de Dieu et d’ambition manifestèrent le désir de créer des territoires autonomes, des « Missions jésuites » semblables à celles qu’ils avaient installées chez les Indiens Guarani au Paraguay. Ces « Missions » ou « Reducciones » fonctionnaient comme des petites « républiques » indépendantes et vivaient en autarcie au cœur de la colonie. Fondées au début du XVIIe siècle, elles allaient exister jusqu’en 1768, date à laquelle les jésuites furent expulsés des colonies espagnoles.
Privés de leur projet de républiques indiennes au Québec, ils se vouèrent à l’enseignement. Ils transportèrent en Amérique le type de collège qui fonctionnait déjà si bien dans le royaume. Ils étendirent leur champ d’action aux enfants ordinaires dont ils firent durant les siècles suivants des catholiques modèles « à leur image » sinon à celle de Dieu.
Après l’installation de la famille Hébert, les premiers émigrants provenant de France avaient été quarante, hommes et femmes. C’étaient des artisans, des paysans, pas complètement miséreux, mais suffisamment pauvres pour avoir décidé de tout laisser derrière eux afin de commencer une nouvelle vie sur une terre inconnue. Les célibataires qui se trouvaient dans leur groupe allaient fonder en se mariant, dès leur débarquement, les premières véritables familles chrétiennes du Québec.
D’où venaient-ils donc ?
D’où venaient ces voyageurs de l’aventure américaine avec leurs regards égarés, leurs baluchons et leurs hétéroclites équipages de pauvres ? Quelles avaient été leurs conditions ? C’étaient presque des Normands. Ils venaient du Perche, issu du comté de Mortagne et des seigneuries de Nogent et de Bellême, situées au sud de l’actuel département de l’Orne. Un Québécois a dit de sa province d’origine, que le Perche est un « tout petit pays » qui « tiendrait chez nous entre Trois Rivières et Joliette. »
Grâce aux registres paroissiaux de Saint-Aubin demeurés intacts en dépit des guerres et des révolutions survenues en France pendant plus de trois siècles, on connaît avec précision l’origine et même l’histoire de leurs ancêtres. Aucune ordonnance ultérieure d’aucun gouvernement français républicain n’est venue démentir les engagements ancestraux définitifs pris par le Royaume de France
Les Canadiens qui ont étudié l’histoire des origines de cette migration se sont demandés comment un terroir situé loin de la mer, enfermé dans des forêts primaires, a pu devenir au début du XVIIe siècle un réservoir inattendu de pionniers pour la « Nouvelle France ». Pourtant il ne faut rien exagérer. Ce n’est pas parce que les ancêtres de plus d’un cinquième des Québécois viennent de la région de Tourouvre qu’il faudrait assimiler cette migration localisée à une invasion. Le nombre des familles originaires de cette province ne dépassa pas de beaucoup la cinquantaine. Le fait, constaté à la fin du XVIIe siècle, que leur nombre n’avait pas dépassé celui de 14 393 hommes et femmes doit inciter à quelque modération. Certes, il est vrai que pendant treize ans, de 1634 à 1647, le Perche s’est trouvé au premier rang des provinces françaises pourvoyeuses d’émigrants. Il est vrai qu’en 1663 les Percherons ont été considérés comme les plus « prolifiques » des colons et à ce titre placés au premier rang des Québécois venus d’autres provinces françaises en terre canadienne. On a constaté en cette année-là que le cinquième des Québécois de naissance était d’origine percheronne. Mais il ne faut pas non plus perdre de vue que cette migration, étonnante par sa soudaineté et son volume initial, aussi « improbables » que l’importance de ce mouvement paraisse de nos jours, a été probablement due à quatre facteurs simultanés :
1 La création de la Compagnie des Cent associés dont le principal promoteur et ses sergents recruteurs furent trois « notables » de Tourouvre et de Mortagne-au-Perche, explorateurs dont les exploits américains et la fortune avaient séduit les familles les plus entreprenantes du Perche.
2 La faiblesse de potentiel économique de cette province isolée et oubliée dans ses forêts.
3 L’opportunité inouïe que présentait, pour une partie de ses émigrants, l’offre inattendue des trois « promoteurs » venus dans leur commune d’origine, vanter les mérites la « Nouvelle France » et de son avenir, et les ordonnances royales garantissant la pérennité de leur « naturalité » Français et de tous leurs droits.
4 L’énorme avantage que ces immigrants apportaient à la Compagnie en lui permettant de remplir, au coût le plus bas possible, les obligations de la charte qui la liait au gouvernement royal. Au terme de cet engagement, elle devait fournir 300 immigrants par an pendant une décennie à Québec. Mais sans ces émigrants les affaires de la compagnie des Cent associés auraient été vouées à la faillite.
Parmi les premiers émigrés, une trentaine avait été baptisée, en véritables créatures de Dieu, dans l’église de Saint-Aubin à Tourouvre-au-Perche, qui trône, encore intacte en l’an 2001, à côté d’une mairie vieillotte de la IIIe république édifiée 1932, au centre d’un bourg dont la population actuelle est de 1643 habitants, mille fois inférieure au nombre des descendants de ces 250 Tourouvrais qui ont quitté le pays pour l’Amérique entre 1634 et 1698. Un musée franco-québécois récemment construit conserve la plus grande partie des archives de ces familles, authentifiant ainsi, à toutes fins utiles, l’authenticité de leurs origines.
Tourouvre est un gros bourg, blotti dans le Nord-Ouest de la France, à la limite de la Normandie et des plaines de Beauce. Ses origines et celles de son « Vieux Moulin » se perdent dans la nuit des temps. Son nom vient du latin affirment les exégètes « Tortum robur » point de repère géodésique des Romains qui avaient été frappés par l’aspect majestueux d’un « chêne immense à la ramure tordue par un terrible orage » tellement violent que seul Zeus avait pu en être rendu responsable.
Situé en bordure de la commune, à 200 mètres du lieu-dit « les Mézières » a été mis au jour l’emplacement d’une cité gallo-romaine, attesté par les vestiges d’un talus gaulois retrouvés sous un antique moulin lors de précédents travaux de restauration.
C’est quelques années après le départ des émigrés qu’on en a trouvé des traces écrites, sous Louis XIV. À cette époque, le Moulin de la Fonte était une ferme adossée sans doute à l’étang existant. Celui-ci aurait été creusé et exploité par des moines, comme la majorité des étangs de cette époque, le poisson constituant la nourriture principale des paysans.
Plus tard, transformé d’abord en moulin à eau, celui-ci devint une fonderie au début du siècle. Entre autres, on y fondit les arches du Pont des Arts à Paris. On a probablement oublié que les arches de cette passerelle romantique, chantée par Georges Brassens, provenaient d’un obscur bourg de l’Orne.
Cependant, la renommée de Tourouvre est née au Canada. Elle est due, naturellement, au fait que des centaines de milliers de Québécois sont les descendants de ces paysans français, dont certains ne savaient pas écrire, convaincus par des agents riches et puissants de la « compagnie maritime à charte royale » que les territoires sauvages et lointains d’une nouvelle Belle Province » leur procureraient un meilleur avenir que leur maigre terroir et permettraient « aux enfants de leurs enfants » de s’épanouir, soit en revenant en France fortune faite, après quelques années, soit en demeurant sur les nouveaux domaines qu’ils avaient créés outre-Atlantique.
LE MIRACLE QUÉBÉCOIS
L’étonnant pour un observateur non averti est que ces quarante paysans, et ceux qui suivirent leur exemple, aient pu donner naissance à un grand pays comme le Québec, dans lequel leurs descendants sont plus d’un million six cent mille, 380 ans après leur embarquement pour la « Nouvelle France », dans le port de Dieppe. Des milliers de Québécois portent encore des noms aussi répandus que Gagnon, Giguère, Mercier, Rivard, Roussin ou bien Cochereau. Ces patronymes sont très communs dans le Perche moderne. On les trouve par centaines, également, dans toute la France contemporaine. Ils ne sont pas portés par des homonymes, mais par de véritables membres d’une même famille dont les liens se sont distendus à travers les siècles en raison de l’éloignement et de la multiplication des branches différentes auxquelles ont donné lieu d’innombrables alliances, mais que les deux dernières guerres ont rapprochées dramatiquement en raison du sang versé pour une même cause. Ces lignées ont été composées de gens durs au travail, courageux qui ont souffert toutes sortes d’humiliation du frivole Royaume de France de la Régence et de Louis XV, qui veillèrent à rapatrier tous les leurs, les aristocrates, après que Choiseul a eu l’indécence de dire à l’émissaire de Montcalm venu réclamer des renforts. « Quand le feu est à la maison, on ne s’occupe point des écuries. »
Remarque qui lui a valu cette réplique « Au moins ne dira-t-on pas, Monseigneur, que vous parlez comme un cheval ».
L’IMMOLATION DU 19 AOÛT 1942
Dieppe, nom du port où a eu lieu le premier « grand départ » en 1634, évoque également pour les Québécois un jour tragique de la Seconde Guerre mondiale : le 19 août 1942.
Ce jour-là, les effectifs d’environ une demi-division composée notamment de régiments de blindés (parmi eux le « 14 th Canadian Army Tank Regiment ») et d’infanterie mécanisée (notamment le « Fusiliers Mont-Royal ») s’embarquent en Angleterre pour le port de Dieppe en Normandie occupée par les armées allemandes depuis l’armistice franco-allemand de juin 1940. Il s’agit d’un puissant commando composé de 5 000 Canadiens, 1 100 Anglais, une cinquantaine de Rangers américains et une poignée d’hommes de la France libre, avec le support de huit destroyers et de plusieurs dizaines d’escadrilles aériennes.
Le nom de code de l’opération qui va commencer est « Mission Jubilee » tel qu’il a été exprimé ce matin-là par l’état-major général allié, son objectif principal est de tester et évaluer la défense et les dispositifs des troupes allemandes le long du Mur de l’Atlantique et montrer à l’URSS que ses Alliés occidentaux préparaient le second front réclamé Staline pour soulager le front oriental.
La vérité a été découverte par la suite par les historiens. En fait, l’état-major interallié, c’est-à-dire le général Eisenhower et ses officiers généraux avaient besoin - également - de mettre à l’épreuve le matériel militaire avec lequel il projetait de débarquer ultérieurement en Europe. Certains historiens estiment même que les enseignements de cette opération ont permis la réussite du débarquement de juin 1944.
Mais ce fut un véritable massacre. La réaction de l’armée allemande fut terrible et plus puissante qu’apparemment on ne l’avait prévu dans les hautes sphères stratégiques.
Il y eut plus de cinquante pour cent de pertes. Sans parler de tout le matériel qui a été détruit ou abandonné intact sur place et qui a fait dire à l’époque au commandement allemand qu’il devait être reconnaissant aux Alliés de leur avoir fourni un échantillonnage aussi complet de l’équipement et de l’armement de leurs armées.
Quant à la liste des pertes alliées, elle fut longue et gardée secrète : 3 600 hommes, dont 2 753 morts 847 prisonniers, 106 avions, 1 destroyer, 30 chars d’assaut et 33 chalands de débarquement avaient été perdus.
Sur les 4 963 Canadiens de ce grand commando, 2 753 furent tués au combat par la puissance de feu de l’artillerie allemande. Sur les 2 210 soldats qui purent rentrer en Angleterre, il y eut 617 blessés.
Deux ans plus tard, les soldats canadiens ont eu leur revanche. Ils « eurent l’honneur » de débarquer à Juno et libérèrent Dieppe le 1er septembre 1944. Mais cela ne rendit pas la vie à tous ceux qui l’avaient perdue sur les plages de ce port normand d’où étaient partis leurs ancêtres.
Les archives d’état civil de la paroisse, les actes de naissances et de baptême, tels qu’ils ont été inscrits dans les registres de Saint-Aubin depuis l’an de grâce 1580, et ceux de la commune et des archives départementales constituent un véritable trésor pour les Québécois et les Français. Grimoires écrits mi en latin, mi en français de l’époque.
Tourouvre ! : ils sont tous là ces pionniers. Sur une plaque de marbre sont gravés trente noms patronymes que portaient les familles, les jeunes gens et les jeunes filles qui ont quitté leur village en 1634. Une autre plaque rend hommage à la famille Gagnon et porte deux dates 1640-1964, scellée par quelque pieuse main paraissant ignorer que les premiers émigrés de cette famille, dont seule la mère demeurera et mourra à Tourouvre, partirent en réalité en 1634.
En ce temps-là, ce bourg était isolé du reste du monde par une épaisse forêt. Une seule piste, très étroite allant vers le Nord et vers Paris, avait été taillée à travers les chênes et les hêtres millénaires qui couvraient toutes les collines. Elle passait par le hameau de la Gagnonière, berceau de tous les Gagnons du Canada, où une vielle laiterie fonctionne encore à l’ancienne.
La forêt était profonde, parcourue par des bandits de grands chemins, de coupe-jarrets et aussi, affirmait-on, par des elfes et des âmes errantes dont certains disaient avoir entendu fréquemment les hurlements dans la nuit. Ils avaient traversé tout cela, à pied, parcouru plus de cent kilomètres jusqu’à la côte en emportant quelques pauvres objets utiles. Les historiens estiment qu’il leur avait fallu plus d’une semaine de marche pour atteindre les quais du port, où ils avaient attendu, transis, blottis les uns contre les autres, pour se protéger du vent d’hiver, l’appareillage de leurs quatre voiliers.
Et leur voyage était loin d’être terminé. Ils avaient été entassés à bord des navires, comme du « bois d’ébène », esclaves consentants sans autre nourriture que leurs provisions de pain et de fromage déjà amenuisées et les biscuits de seigle moisis que leur distribuait l’équipage.
Ensuite, le vaste océan qu’ils n’avaient jamais vu. Ils avaient entendu dire que « les mers sillonnées de corsaires » venus d’Espagne, d’Angleterre et de Barbarie, étaient encore plus dangereuses que les chemins creux de leurs profondes et sombres forêts hantées par les brigands. Ils allaient apprendre, à leurs dépens, qu’à l’inconvénient de tous ces périls s’ajouterait la rigueur des conditions bestiales de leur vie à bord. Les marins de l’époque n’étaient pas des petites sœurs de la Charité. D’ailleurs, les moniales et leurs frères de congrégations voyageaient séparément, aux frais de leur ordre dans des navires spécialement affrétés pour eux.
Les paysans qui quittaient leur pays pour toujours étaient le plus souvent « parqués à fond de cale, au milieu de toute la cargaison composée en grande partie d’instruments aratoires et de sacs de semences. Ils n’emportaient comme bagage qu’un baluchon ou un coffre contenant leurs hardes, une boîte à outils s’ils étaient artisans, des ustensiles de cuisine, des graines de semence pour le potager, une paillasse parfois. Ils ne possédaient pas d’autres biens. »
Il fallait être aussi riche que des « personnes de qualité » pour emporter avec soi quelques meubles, peu encombrants, ou même disposer de moyens suffisants pour affréter un voilier à bord duquel on pourrait emporter tout son mobilier, sa famille, voire ses domestiques. Les jésuites, par exemple, les hauts fonctionnaires du roi ou les religieuses fondatrices des diverses communautés hospitalières ou enseignantes du Québec, dont le rôle dans le développement du pays a été prépondérant, ne voyageaient pas autrement.
Mais la foi des pionniers était si fervente que lorsqu’ils furent arrivés à bon port, le premier geste qu’ils firent fut de rendre au Seigneur et à Sainte-Anne en leur exprimant leur reconnaissance d’être sains et saufs en mettant les pieds sur cette terre non bénite, qu’on leur avait décrite « dure et glacée », sans merci à l’égard de ceux qui n’étaient pas assez vigoureux pour résister à son étreinte mortelle.
La mémoire de tous ces voyageurs est encore présente en l’église de Saint-Aubin. Leurs âmes flottent dans l’air comme des fantômes qui hantent à jamais ses murs épais. Y compris celle de « Johannes » fils de Jacobi Guidon et de « Maria eus uxoris », Jean Guidon, fils de Jacob Guidon et de sa femme, Maria, dont le jour du baptême fut le 18 septembre 1592 - il y a 408 années. Cet homme était compagnon maçon. La mémoire populaire sait encore qu’il est l’auteur de l’escalier de pierre en colimaçon, chef-d’œuvre qui est demeuré, comme le fait d’être l’ancêtre de la chanteuse Céline Dion, la cause de sa renommée dans le pays.
EN UN SIÈCLE : INTÉGRATION ET ABANDON
Dès 1662, Colbert avait pris en main les « affaires coloniales ». L’objectif principal que visait le gouvernement royal était le succès et les bénéfices que rapportait l’import-export, à ceci prêt qu’on prenait beaucoup plus de risques à importer de l’or, de la soie et des épices qu’à se livrer au trafic régulier du « bois d’ébène » entre l’Afrique et les Amériques. Ce négoce a fait, notamment, la fortune de la ville de Nantes dont les agents maritimes troquaient des esclaves ou « prisonniers de guerre » des rois africains contre des colliers de perles en cloisonné de verre.
En 1663, Louis XIV fait le point. Il s’aperçoit que la Compagnie des Cent associés n’est pas parvenue à créer une forte colonie de peuplement. En trois décennies, le nombre des colons français est évalué officiellement à peine une dizaine de mille. C’était dérisoire et loin d’être suffisant pour équilibrer le nombre de colons anglais qui étaient plus d’un million et demi en Amérique du Nord.
De plus, le gouvernement royal estime que les actionnaires de ces entreprises et ses représentants au Québec avaient fait « danser l’anse du panier » en profitant de l’étendue des pouvoirs qui leur avaient été conférés par la charte en 1629. Ce qui dans un régime aussi autoritaire que celui de Louis XIV était considéré comme de nature à saper la toute-puissance du roi. Nicolas Fouquet, vicomte de Vaux, surintendant des finances allait en faire la dure expérience l’année suivante quand poursuivi par Colbert, jugé et condamné, enfermé à perpétuité au Piémont, dans la forteresse de Pignerol, pour avoir défié le « Roi Soleil » avec son immense fortune et la munificence du château de Vaux qu’il venait de faire construire non loin de Versailles en Île-de-France.
En conclusion, Louis XIV décide que les privilèges de la « Compagnie » sont abolis. Il déclare que la « Nouvelle France » est devenue une province française dont il confie l’administration directe à un gouvernement royal, constitué d’un gouverneur, d’un intendant et du Conseil souverain. Le nouvel organisme souverain dépendra du ministère de la Marine. Jean-Baptiste Colbert, aussi puisant et redoutable que l’a été Richelieu son temps, est chargé de veiller au bon fonctionnement de cette province qui est élevée au statut de « province française ».
En 1665, Jean Talon fut nommé intendant général de la Nouvelle France. Les historiens lui attribuent les succès économiques et la croissance qui se manifestent en « Nouvelle France ». Au même moment pour calmer les impatiences iroquoises, le ministère de la Guerre, sur l’ordre du roi, va leur opposer un régiment de 1 300 hommes, le « Régiment Carignan-Salières ». Au XVIIIe siècle, les rotations d’unités de l’armée n’étaient pas aussi rapides que de nos jours dans le cadre de l’Otan dans les Balkans. Le « Carigan-Salères » une fois déployé dans la « Nouvelle province » allait y demeurer suffisamment longtemps pour que certains de ses hommes, ayant finalement atteint l’âge de la retraite, décident de demeurer au Québec où ils avaient déjà fondé une famille.
C’est à cette époque que les fonctionnaires du royaume eurent l’idée d’envoyer des jeunes femmes célibataires, surnommées « les filles du roy » pour « donner » des épouses aux colons qui en manquaient. Il y en eut un contingent connu de 750 dont le succès fut assuré dès leur arrivée dans la province. C’était dit-on de « braves filles ! » qui leur firent de beaux enfants.
« Pourquoi se battre pour quelques arpents de neige... ? »
Dans le royaume et surtout à Versailles, une majorité de Français et de courtisans considéraient le mercantilisme comme le seul moyen de développer l’économie du pays. C’était la théorie avancée par l’aristocratie financière, la haute bourgeoisie des marchands et des banquiers qui estimaient le négoce international infiniment plus rentable que l’installation d’improbables colonies de peuplement, semblables à celles que préconisaient « quelques illuminés » venus du Grand Nord américain.
Pour la haute bourgeoisie financière, ceux-là même qui, en 1789 provoqueraient la Révolution française contre la monarchie et son aristocratie affairiste, les colonies de peuplement n’auraient jamais dû être autre chose que des comptoirs commerciaux. Elles ne pourraient être utiles au négoce que dans la mesure où - en se défendant des autres nations - elles permettraient d’imposer dans ces pays un monopole des échanges, comme celui de la fourrure ou des épices. C’était le seul aspect réconfortant, vraiment le seul, aux yeux des « hommes d’affaires » de Paris et des grands ports, financiers à courte vue, et plus âpres au gain que philosophes où écrivains visionnaires.
La rivalité qui s’était établie entre tenants des colonies de peuplement et partisans du commerce spéculatif ne cessa pas.
Colbert lui-même n’avait-il pas écrit qu’il « ne serait pas de la prudence du roy de dépeupler son Royaume comme il faudrait le faire pour peupler le Canada ». Il avait ajouté que « le pays se peuplera de lui-même, insensiblement. Avec la succession d’un temps raisonnable, il pourra devenir fort considérable, d’autant plus qu’à proportion que Sa Majesté aura plus ou moins d’affaires au-dedans de son Royaume. Elle lui donnera les assistances qui seront en son pouvoir. »
Le ministre apportait ainsi une preuve de plus selon laquelle la politique royale française, en matière d’affaires étrangères et de colonisation, était alors déjà fort prudente, frileuse pourrait-on dire. On aurait pu en résumer les principes de la façon suivante, en deux propositions :
« Grand commerce outre-mer ? » Réponse : Oui
« Colonisation de peuplement ? » Réponse : Oui, mais...
La « Compagnie » avait importé au total, en trente années, 3 855 hommes et femmes dont le taux élevé de natalité porta la population française à une dizaine de milliers. On peut argumenter, sans se tromper, que Tourouvre a été la seule commune à fournir, à elle seule, la proportion la plus importante de pionniers à la compagnie des « Cent associés ». Mais les émigrés vinrent de beaucoup d’autres provinces aussi différentes les unes des autres que la Normandie et le Poitou, la Charente et les pays de Loire et même le Bourbonnais en Auvergne.
Il est vrai également que les Percherons ont été particulièrement prolifiques, puisque leurs descendants - et seulement leur progéniture - sont au nombre aujourd’hui de plus d’un million six cent mille. Pourtant, jamais l’émigration française au Canada ne fut un raz de marée humain. Au début du XVIIIe siècle, les immigrés français de toutes provenances avaient atteint péniblement atteint le chiffre de 14 393 immigrants. Et encore comptait-on parmi 5 400 soldats déployés pour combattre les Iroquois et les troupes anglaises, 359 prêtres missionnaires et 56 moniales, venus enseigner ou soigner la nouvelle population.
La vérité était éclatante : les Français ne voulaient pas quitter leur pays. Les Corses ne faisant pas encore partie du Royaume n’étaient pas encore disponibles, comme ils l’ont été pendant le second empire et la IIIe République auxquels ils ont fourni - en raison de la pauvreté de leur île-, une majorité de militaires de tous grades, policiers, douaniers et fonctionnaires dans l’administration générale des colonies d’Afrique et d’Asie.
Colbert qui avait projeté et tenté de promouvoir l’établissement d’une « importante » colonie de peuplement au Québec, tenta d’inciter des départs de plus en plus importants, de « spécialistes » en donnant des avantages professionnels aux artisans qui acceptaient de signer pour six ans. Un décret royal prévoyait qu’ils obtiendraient, à leur retour, un brevet de « compagnon » et qu’ils « pourraient exercer leur métier en ouvrant boutique à Paris ou dans n’importe quelle ville de province ». Ce fut un échec. Colbert fit proposer aux soldats de demeurer au Canada après leurs années de service, pour cultiver la terre et créer de vastes domaines agricoles, comme Rome l’avait institué dans l’Antiquité au profit de ses légions en créant dans son Empire des colonies romaines de peuplement. Ce fut à nouveau un échec.
Les fonctionnaires du royaume avaient noté qu’à l’occasion de « vacances en France » après le terme de leurs contrats, les « volontaires » ne revenaient pas au Québec et provoquaient, ainsi, une véritable hémorragie démographique qui finirait par nuire à la colonie. Il fut alors décidé par Colbert qu’aucun « Québécois » ne pourrait partir pour la France sans fournir la preuve qu’il était en possession d’un billet de retour payé. Ce fut un nouvel échec. En 1756, après le « grand déménagement » imposé par les Anglais, la France avait tenté de trouver une solution de compromis en envoyant Montcalm jouer les modérateurs, mais, à l’époque, les colons anglais étaient déjà 1 200 000 en Amérique du Nord et les francophones 62 000 à peine. Tout était perdu, irrémédiablement.
De telle sorte qu’on peut comprendre que la véritable cause de l’abandon du Canada par la France n’a pas été, comme il est expliqué par l’Histoire, le traité de Paris signé en 1763 qui mettait fin à la « guerre de sept ans » perdue par la France devant les Anglais. L’esprit de vaincre, la volonté de conserver ses possessions d’outre-mer ne s’étaient pas manifestés à Versailles. Ces territoires étaient déjà perdus à l’avance. Il y avait déjà des esprits assez pernicieux pour jouer à la roulette de leurs « nouvelles illuminations » l’ensemble des intérêts du Royaume. Il n’y avait pas que des « philosophes » pour défendre les idées nouvelles.
« Pourquoi aller se battre pour quelques arpents de neige », avait écrit le financier/philosophe/écrivain Voltaire, sept ans après cette cuisante défaite, exprimant ainsi un type de d’ânerie qui ne demeurerait pas son monopole exclusif.
Au même moment, une partie de la noblesse « progressiste » en avait assez d’être à la merci d’un pouvoir absolu. Les « hauts bourgeois » qui par ailleurs, demeurant terre à terre, se servirent du « petit peuple des faubourgs », pour mettre fin au système qui consistait à devoir « graisser des pattes » aristocratiques pour mener leurs affaires.
Un peuple opiniâtre
En dépit du désarroi dans lequel les avaient laissés le gouvernement royal et les « grandes compagnies maritimes de développement outre-mer » qui avaient abandonné « la Nouvelle France » à la cloche de bois, les Québécois avaient eu la force de caractère de faire croître pour et par eux-mêmes de nouvelles racines, en demeurant fidèles à leur religion, fidèles à leurs traditions, à leur langue, à leur culture, fidèle à leur « francité » à la manière du président Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal de 1960 à 1980.
De telle sorte que les origines du miracle que constitue la permanence en Amérique du Nord de l’entité franco-québécoise doivent être recherchées dans l’extraordinaire volonté de ces Français immigrés, Percherons ou d’autres origines régionales, qui « durs à la tâche » ont su, les armes à la main, en dépit de l’indifférence de Versailles, résister avec courage et ténacité, avec la patience des paysans de leurs régions d’origine, à un environnement hostile composé d’animaux sauvages, d’hommes de toutes origines amérindiennes ou anglaises qui furent leurs adversaires permanents et souvent leurs bourreaux, pendant près de deux siècles. Leur mérite fut de préserver intacts leurs moyens d’expression et leurs traditions ancestrales. En 1634, ils y étaient 300. En 1663, un peu plus de 3 300, en 1763 de 62 000 à 100 000, selon les diverses estimations des historiens.
En l’an 2001, il y en a 6 500 000 au Québec, sur une population de 7 700 000 habitants.
On parle le français dans l’ensemble des dix provinces fédérées et au sein des trois territoires de la Fédération canadienne, sauf dans le territoire de Nunavut où l’on ne parle que le Nanuk et un peu de « basic english ».
Les descendants des immigrés de France sont donc 7 457 600, sur une population totale de 30 millions 600 mille habitants, à manier comme langue maternelle le français - une des deux langues officielles de cet Etat.
Car ainsi que le faisait chanter Jerry Bock Fiddler on the Roof - Un violon sur le toit -, comédie musicale de 1969, sur le roman adapté de Tevye and his Daughters - Tervye et ses filles -, une « nouvelle » de l’écrivain Sholom Aleichem à propos de l’émigration aux Etats-Unis des paysans juifs de Russie, victimes des pogroms des Russo-Cosaques :
« Sans traditions, nous ne serions plus des violoneux en déséquilibre sur un toit. »
En trois siècles et demi de labeur acharné les pionniers venus du Royaume de France et leur progéniture nombreuse allaient transformer le Québec en un grand pays industriel de langue française sur ce continent nord-américain où l’Anglais, l’ultime conquérant de leur pays, les voyant isolés du reste du monde et sans défense, avait tenté de leur imposer, en plus de leurs lois, la langue anglaise comme « moyen vernaculaire d’expression ».
Le souvenir de cette population courageuse est conservé dans leur pays d’origine. Tourouvre est devenu un lieu de pèlerinage pour les Canadiens d’origine française, pour les Français et les touristes venus visiter les plages du débarquement de juin 1944 en Normandie. Des milliers de touristes ont déjà visité le petit musée de ce bourg du Perche, isolé jadis par ses forêts marécageuses, aujourd’hui à une heure et demie de Paris par la route nationale 12.
Des associations entre le département de l’Orne et le Québec se sont formées. Plus récemment, le maire de la petite ville, également, a imaginé un projet qui est en train de prendre forme :
La construction d’une « Maison de l’Émigration française en Canada » qui devrait ouvrir ses portes en l’an 2004.
©Bertrand C. Bellaigue - Révisé le 29 avril 2008
Bibliographie
· Archives of Tourouvre - Mairie et archives paroissiales
· F. F Hubert-Rouleau : « Petit récit historique de l’émigration percheronne au Canada ». (Cahiers d’Histoire du Musée, n° 3)
· Madame Pierre Montagne : « De Tourouvre au Perche à la Nouvelle France. » (1 984)
· « L’émigration tourouvraine au Canada », J. Nortier, maire de Tourouvre.
· « Naissance d’une population - Les Français établis au Canada au XVIIe siècle »
· Champlain doit céder Québec, Hare, p. 16
· Débarquement à Québec d’un premier contingent de 40 personnes qui viennent réclamer le poste à l’Angleterre. Hare, p. 16.
· Les jésuites remplacent les Récollet, Brown, Craig. p. 135
Raymond Bélanger
·Arrivée des jésuites, Lacoursière, p. 56
· Pierre Trudel, in « Histoire de la Nouvelle France ». pp. 5,6
· Encyclopédie Universalis.
· Dictionnaires le Robert et Litre.
[i] Acte pour l’établissement de la Compagnie des Cent associés pour le commerce du Canada, contenant les articles accordés à la Compagnie par Monsieur le cardinal de Richelieu, le 29 avril 1627, dans Edits, ordonnances royaux , déclarations et arrêts du Conseil d’Etat du roi concernant le Canada, Québec, E .R. Fréchette, 1854, à la page 10.
35 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








 )
)