La droite et la gauche, l’individu et la société
Au centre de toute idéologie politique se trouve la question du rapport de l’individu à la société : est-ce l’individu qui fait la société, ou bien est-ce l’inverse ?
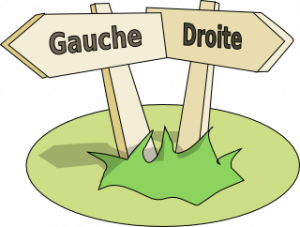
La droite et la gauche
Une définition
"C’est, d’abord, une affaire de perception. Ne pas être de gauche, c’est quoi ? Ne pas être de gauche, c’est un peu comme une adresse postale : partir de soi… la rue où on est, la ville, le pays, les autres pays, de plus en plus loin… On commence par soi et, dans la mesure où l’on est privilégié et qu’on vit dans un pays riche, on se demande : « comment faire pour que la situation dure ? “. On sent bien qu’il y a des dangers, que ça va pas durer, tout ça, que c’est trop dément… mais comment faire pour que ça dure. On se dit : les chinois, ils sont loin mais comment faire pour que l’Europe dure encore, etc. Être de gauche, c’est l’inverse. C’est percevoir… On dit que les japonais ne perçoivent pas comme nous. Il perçoivent d’abord le pourtour. Alors, ils diraient : le monde, l’Europe, la France, la rue de Bizerte, moi. C’est un phénomène de perception. On perçoit d’abord l’horizon. On perçoit à l’horizon."
A la lumière de cette explication, résumons grossièrement ce qui différencie la droite de la gauche dans l’imaginaire collectif :
- A droite tout ce qui part de moi : l’individualisme, le mérite, la compétition, le pragmatisme, la sécurité sont de droite,
- A gauche tout ce qui vient de l’horizon : le collectivisme, la solidarité, la collaboration, l’idéalisme, la tolérance sont de gauche...
Pourquoi sommes nous dirigés par la droite ?
Il est possible que nous soyons plus enclin à avoir une pensée "de gauche", accès sur la solidarité, au niveau local qu’au niveau global. Nous sommes d’autant plus volontiers solidaires de nos voisins qu’ils sont proches, géographiquement et culturellement (voire socialement). Nous voyons d’autant mieux "l’horizon" qu’il n’est pas trop loin. C’est pour cette même raison que l’idée de compétitivité entre différentes villes au sein d’un pays semble moins faire d’émules que l’idée de compétitivité entre différents pays sur le plan international.
Voilà pourquoi nous serions plus enclin à voter à droite au niveau national et à gauche au niveau régional ou en deça. Un peu comme si l’électeur, quelque peu schizophrène, se disait, quand il s’agit de choisir le maire des habitants sa grande ville, "soyons solidaire", et quand il s’agit de choisir le président de tous les français : "mettons au boulot tous ces fainéants", au niveau local "coopérons avec nos voisins" et au niveau national "soyons compétitifs"... Il est possible que si l’Europe existait réellement sur le plan politique et formait une unité plus importante que les nations, nous soyons plus enclin à voter à droite au niveau européen mais à gauche au niveau national, simplement parce que la compétition entre pays européens, ou encore des thèmes comme l’immigration, feraient moins sens.
Il existe un autre type d’explication qui tient plus au milieu de la politique. Nous pouvons penser que la volonté de pouvoir que l’on suppose importante chez l’homme politique, et ce d’autant plus que l’échelle est importante, est plutôt compatible avec la mentalité "de droite", individualiste, méritante. Finalement pour réussir à devenir président, il faudrait une volonté de réussir qu’on trouverait plus difficilement chez quelqu’un privilégiant le collectif sur l’individuel... Bien sûr l’homme politique peut être aussi mû par la volonté idéaliste de changer les chose, mais ce n’est qu’en période trouble qu’une telle volonté peut remporter l’adhésion du peuple, tandis que la volonté personnelle de réussir s’accommode de tout type de période puisqu’elle est avant tout pragmatique. Pour être honnête, avouons que l’homme politique qui réussit doit sans doute posséder en plus de cette volonté individualiste de réussir un minimum de volonté collectiviste, inhérente à son métier : être politique, c’est gérer le collectif... Tout au moins espérons-le.
Explications sociologiques
En effet il est notoire que les personnes âgées sont souvent plus à droite que les jeunes. Est-ce une question de génération ? Ou l’expérience rendrait-elle individualiste ? L’idéalisme s’éroderait-il avec le temps ?
On comprends par contre plus aisément que les classes supérieures soient généralement plus portées à droite. Celui qui possède plus que l’autre cherchera naturellement à justifier ceci par son propre mérite plutôt que par la chance ou le simple fait d’être bien né. Il occultera les mécanismes sociaux et mettra en avant les actions individuelles (voire la génétique) comme étant à l’origine d’une situation sociale, qu’il serait vain et injuste de chercher à modifier. A l’inverse celui qui possède moins aura plus facilement tendance à mettre en cause "le système" pour justifier sa pauvreté, et non son incompétence.
Dans les deux cas il s’agit d’un réflexe de protection presque inconscient : chacun à tendance à adopter la position intellectuelle qui lui est la plus confortable, la plus valorisante pour lui. Mais le confort intellectuel est souvent l’ennemi de la vérité...
L’individu et la société
A droite, vers la négation du collectif
Les approches libéral (au sens économique) ou utilitaristes ne voient en la société qu’un cumul d’individu, et nie la nécessité ou l’importance du collectif, si ce n’est comme étant à l’initiative des individus. L’action collective n’est que la somme des actions individuelles, et le bien être collectif la somme des bien-être individuels. Le politique n’a pour rôle que de favoriser l’avènement de l’individu, il ne sert qu’à faire respecter les règles constituant le cadre de ce dernier sans n’apporter aucune entrave, et se trouve donc nécessairement en retrait.
Les conceptions plus à droite sont la déclinaison de cette approche sur un mode communautaire ou patriotique. C’est encore le mérite qui importe, mais il pourra s’agir d’un mérite naturel attaché à une communauté de sang. La liberté n’a donc pas tant d’importance face à la préservation ou à la promotion d’un ordre fondé sur la communauté. Le politique, dans une conception d’extrême droite, pourra jouer un rôle de protection de ces "droits naturels". (On voit que l’obsession génétique du gouvernement actuel, dans l’affaire "Jean Sarkozy" ou en rapport à l’immigration, est une marque très prononcée à droite).
Mais le point commun de ces approches est dans la négation des déterminismes sociaux et des mécanismes collectifs, réduits à des conséquences d’actions individuelles, à la prépondérance du mérite, que celui-ci soit inné ou acquis, et par conséquent dans le dénigrement de toute lutte sociale allant à l’encontre d’un ordre supposé naturel ou juste.
A gauche, vers la négation de l’individu
Plus on se déplacera vers la gauche des idées politiques, et plus le collectif prendra le pas sur l’individuel. A l’extrême, nous en venons à une conception qui réduit l’individu aux multiples mécanismes sociaux qui le déterminent. Dans cette conception chacun n’est qu’un pion jouant son rôle. Le travailleur n’a aucun pouvoir de décision sur le marché et se fait exploiter. Le patron ne fait que jouer son rôle en optimisant les profits. Il délocalise parce que c’est ce qu’il faut faire dans sa position, et s’il n’était pas là, lui on son concurrent le ferait à sa place. Les pouvoirs politiques, industriel, financiers et médiatiques, par des mécanismes similaires, tendent à conserver leur position dominante de diverses façons (éducation privée, ...). A l’image des expériences de Milgram, dans laquelle le premier quidam venu placé sous une autorité factice accepte de torturer son prochain, la responsabilité dans la société est diluée au profit de mécanismes que personne ne contrôle. Dans une telle vision seul le politique (ou seule l’action collective si le milieu politique est corrompu) a le pouvoir de s’opposer à cet ordre des choses, soit en régulant le système, soit en instituant un nouvel ordre plus juste fondé sur la collectivité.
La doctrine libérale
L’idéologie libérale a voulu jouer ce rôle en affirmant que la société est la somme des actions individuels. Elle s’est habillée d’un semblant de rationalisme scientifique pour s’affirmer comme la seule voie possible et forcer le consensus. Seulement cette approche, si elle semble naïvement tenir du bon sens (en effet, ce sont évidemment les actions individuels qui déterminent l’évolution de la société), n’est pas empirique et n’a pas de base sociologique. Elle est réductionniste et simpliste dans son modèle. D’abord parce qu’elle ne prend pas en compte d’éventuels phénomènes complexes (pourtant l’homme est sans doute ce qu’il y a de plus complexe dans la nature), des effets de groupes. Les actions individuelles y sont supposées "pures", émanant uniquement de la volonté et affranchis de toute influence. Ensuite parce que pour être libre il faut être éclairé, éduqué. Or c’est la société qui nous éduque, qui nous arrache à notre condition animale en nous apprenant à parler, à réfléchir, en nous offrant une organisation qui nous précède et qui constitue le cadre essentiel de nos existence : sans la société nous ne sommes rien. Paradoxalement, seul le collectif est capable de faire émerger l’individu libre. Enfin elle ne s’intéresse qu’au marché. Or le marché n’est pas la démocratie des hommes mais celle de l’argent.
Mais le modèle opposé qui voudrait nier toute possibilité d’action de l’individu est également trompeur, en particulier quand il voit en la société un ordre statique et immuable, alors qu’elle est en évolution permanente. La réalité se situe donc entre les deux. Il s’agit d’une subtile combinaison des deux visions, et, comme nous allons le voir, la physique du chaos est l’outil théorique qui peut nous permettre d’appréhender cette combinaison.
Une approche scientifique
Le chaos
La sensibilité aux conditions initiales
Cette image possède certaines limites. Ces papillons sont 6 milliards, et parmi eux se cachent aussi quelques albatros... Certains se trouvent noyés dans une masse de papillons dont les mouvements s’annulent les uns les autres. Ils n’ont aucune vision sur les conséquences de leurs actes. D’autres se retrouvent au centre de caisses de résonance et influent sur les courants mondiaux. Il est donc très naïf de croire que le chaos justifierait le libéralisme économique, parce qu’il entérinerait la toute puissance de la volonté individuel. Au contraire, parce que le chaos est générateur de structure, cette structure devient un élément essentiel à prendre en compte dans la description de la société.
Cependant la sensibilité au conditions initiales nous apprend certaines choses. D’abord elle nous apprend que la société est imprévisible, qu’il est illusoire de l’imaginer contrôlée par une poignée d’individus. Elle nous apprend qu’un simple événement peut profondément changer les choses. Une lecture de l’histoire mettant au premier plan les "grands hommes" est peut-être parfois exagérée, mais contient sa part de vérité, dans il se peut que certains hommes - quand ils se retrouvent au bon endroit et au bon moment - peuvent considérablement changer le cours des choses. A travers la sensibilité aux conditions initiales, l’événement, amenant la société à bifurquer dans un sens ou un autre, est donc le premier aspect déterminant d’un système chaotique.
L’émergence de la structure
On parle d’émergence quand un système ne peut pas être réduit à un simple cumul de sous-éléments. Il n’est descriptible que dans son ensemble. Ceci s’explique généralement par l’existence d’effets non linéaires : les boucles de rétroactions entre les éléments du système les rendent inséparables et font apparaitre une dynamique d’ensemble qui n’était pas présente dans les éléments isolés. Ceci induit ce qu’on pourrait appeler une "rétroaction d’échelle" : les éléments agissent sur l’état global du système, induisant la formation d’une structure, et cette dernière influence en retour chaque sous-élément. L’émergence est l’opposé du réductionnisme. C’est donc dans l’émergence que la démarche du libéralisme, qui voudrait modéliser la société comme une somme d’individus, tombe en échec.
La société humaine dans son ensemble peut être considérée comme un phénomène émergent. Personne n’a jamais inventé la société, elle s’est développée au cours de l’histoire, par le fait des individus, mais c’est elle qui en retour forge les individus. Elle acquiert donc au final une certaine autonomie dans son évolution. Seule la civilisation nous différencie des animaux, et sans elle nous ne sommes rien.
Ce même phénomène d’émergence de la structure peut se retrouver à toutes les échelles. Dans cette perspective l’action des individus, par leurs liens sociaux, serait la fabrication continuelle de structures émergentes formées de groupes sociaux imbriqués les uns dans les autres de manière fractale et finissant par acquérir une certaine autonomie. Cette autonomie des formes émergentes se traduit par l’existence de déterminismes, de mécanismes, d’une structure sociale, par la dilution de la responsabilité et un certain aspect incontrôlable de la société. Bien entendu les groupes sociaux, tout comme les nations et les communautés, sont plutôt des abstractions, elles ne sont pas aussi clairement définissables qu’ils n’y paraient, elles sont mouvantes et leurs limites sont floues. Mais le rêve de l’individu libre au centre de la société est lui aussi une illusion.
Pour autant il ne faut pas oublier le rôle que joue l’individu. Si la structure de la société leur pré-existe, ce sont bien les individus qui déterminent et infléchissent son évolution. Ce sont eux qui sont responsables de l’émergence de structures nouvelles. Ainsi on en revient, avec l’émergence, à l’idée que c’est la collectivité qui forme l’individu, et que la principale force d’action de l’individu passe par le collectif. De même la régulation de la société ne peut être que collective.
Conclusion
En fin de compte la réalité est un subtile mélange de déterminisme et de liberté, de régularités et de singularités, de structures stables et d’évènements inopinés, d’ordre et de chaos. Cette combinaison si particulière est la marque de la non linéarité inhérente aux phénomènes naturels.
A la lumière de cette conception, on voit que les choses sont plus complexes qu’il n’y parait. Nous sommes déterminés par des mécanismes sociaux, mais ceux-ci n’ont rien de stables, ils bougent sans cesse, et ce sont les individus qui les font bouger, ou se renforcer. Personne n’est réellement cantonné à un rôle social, chacun, bien que contraint, est maitre de son destin, mais celui-ci passe par la collectivité et les relations sociales.
71 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON












