Parler de la crise avec le sérieux de l’ironie : un livre de Frédéric Lordon, « la crise de trop »
Réussir à faire jubiler son lecteur quand on traite de la crise financière et économique qui ravage aujourd’hui le monde, n’est pas une mince affaire, surtout en visitant méthodiquement les austères arcanes de la finance internationale avec son jargon anglo-américain hermétique qui raffole de sigles abscons comme les « Alt-A-RMBS » , les « options ARM », les « SPV » ou les « CDO synthétiques ou ordinaires ». Mais c’est la performance de Frédéric Lordon, directeur de recherche au CNRS, dans son livre « La crise de trop – Reconstruction d’un monde failli », que de réussir à dérider son lecteur même pour rire jaune (1).
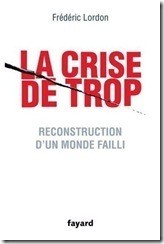
Il faut dire que, si tragique que soit l’événement, vu sous un certain angle, on touche à la farce la plus désopilante puisque les chantres illuminés du marché déréglementé se retrouvent cul par-dessus tête et qu’on les voit brûler avec la même ardeur l’idole qu’ils adoraient hier. L’aveu en tout premier lieu du grand-prêtre, Alan Greenspan, maître pendant si longtemps de la Réserve fédérale étasunienne et « père de la golden finance » est proprement ahurissant : « Ceux d’entre nous, a-t-il confessé, qui avaient vu en l’intérêt propre des institutions de crédit le moyen de protéger leurs actionnaires (tout spécialement moi-même) sont dans un état d’incrédulité choquée ». Ils peuvent l’être, en effet, ces rusés personnages !
F. Lordon s’amuse à mettre en parallèle ce que fulminaient hier hommes politiques, banquiers, patrons et journalistes et ce qu’ils osent affirmer aujourd’hui. Les retournements de veste sont sidérants. Les pratiques financières affranchies de toutes règles, la libre concurrence prétendument « non faussée », les mérites de l’actionnariat tout-puissant tant chantés sont désormais condamnés avec la même virulence à l’exception de quelques égarés comme Nicolas Baverez qui n’en démord pas : « La mondialisation, dit-il à la façon de Georges Marchais soldant le stalinisme, conserve des aspects positifs ». Il soutient même ce curieux raisonnement : « l’autorégulation des marchés est un mythe », mais « le libéralisme est le remède à la crise ». Autrement dit, l’autorégulation des marchés qui est au cœur du libéralisme déréglementé est responsable de la crise, mais le libéralisme qui est la maladie, est son propre remède. Comprenne qui pourra !
F. Lordon réunit ainsi un florilège des numéros peu glorieux auxquels se livrent ceux qui se sont tant trompés, avec une insistance particulière sur les socialistes français comme M. Rocard ou J. Attali, et les journalistes de gauche comme Julliard ou Joffrin. On laisse au lecteur le plaisir de les découvrir, assaisonnés par l’auteur des remarques assassines et souvent clownesques qu’ils méritent. Juste un exemple pour donner le ton. Jacques Julliard du Nouvel Observateur demandait par exemple, en août 2007, si « les socialistes (croyaient) encore à leurs mythes tels que la lutte de classes, le prolétariat, la nationalisation des moyens de productions. » Or voici qu’en octobre 2008, observe F. Lordon, « un certain Julliard, probablement un usurpateur d’identité, écrit ceci « Comme à chaque nouvelle crise, le capitalisme financier appliquera la même recette : prendre l’argent là où il est, c’est-à-dire chez les pauvres. Quant aux banquiers, j’en vois beaucoup de ruinés, mais aucun de pauvres. Et pas un seul en prison alors qu’ils viennent de faire perdre au monde entier 20 à 30 % de sa valeur (…) » Ah c’est sûr, il est méconnaissable notre Julliard !(…) (A-t-il été) mordu par un renard ? culbuté par une bête à cornes ? Un fâcheux lui aurait allongé la tisane à l’alcool à brûler ? »
Le crédit fou pour pallier l’écrasement des salaires
Ceci dit, on sent bien que ce rire est terriblement jaune. C’est une façon de ne pas désespérer devant le désastre. Car Frédéric Lordon en analyse minutieusement les causes. Il va de soi que cette crise des « subprimes » n’est pas tombée du ciel. Il a fallu pour en arriver là tourner le dos à la période fordienne qui faisait des salaires le moteur essentiel de la production pour le marché intérieur : je paie bien mes ouvriers , disait l’industriel américain, pour qu’ils achètent mes voitures. Dans une jungle mondialisée, les salaires sont devenus de simples variables d’ajustement face à la pression actionnariale insensée et à la libre concurrence échevelée. Et les ménages américains, faute de ressources, en sont venus à s’endetter dans des proportions invraisemblables, jusqu’au jour où les défauts de remboursement se sont multipliés en cascades, entraînant la chute du château de cartes constitué des titres qui avaient été diffusés à travers le monde pour en disséminer les risques.
Des propositions
Le rôle des banques est évidemment passé à la loupe. Outre les rémunérations obscènes de leurs dirigeants et de leurs traders y compris aujourd’hui en pleine crise, se sont-elles comportées à la hauteur du service public qu’elles assurent en devant garantir la sécurité des encaisses monétaires ? Non, à l’évidence, quand on songe aux 4.000 milliards de pertes bancaires, selon le FMI. L’auteur avance donc des propositions pour organiser « un système socialisé du crédit » qui ne soit plus aux mains des banques privées puisqu’elles ont fait la preuve de leur impéritie, mais qui ne soit pas non plus entre celles de l’État dont les tentations politiques et démagogiques peuvent être aussi dangereuses.
D’autres solutions coulent de source. L’étau qui a étranglé les salaires, doit être desserré mais en en prenant les moyens : les profits démesurés de l’actionnariat doivent être plafonnés et la concurrence sauvage mondialisée jugulée. À cet égard, l’auteur réserve un sort particulier au débat sur « le protectionnisme », « ce concept vide de sens », qui serait synonyme de guerre. Que signifie, en effet, cette concurrence sauvage entre des systèmes sociaux si inégaux à travers le monde, dont le résultat est à terme l’alignement des plus développés comme ceux d’Europe occidentale sur les plus archaïques ?
Et l’auteur de fustiger cette « concurrence des marchés » qui « (n’) est (que) le protectionnisme (dénié) des structures » si inégales. « Concurrence non distordue vraiment, demande-t-il, avec l’Estonie ou la Macédoine qui fixent à zéro leur impôt sur les sociétés ? Ou la Roumanie où les employés de Renault-Daccia payés 300 Euros par mois sont une sorte d’élite salariale ? » Ce fameux concept de « concurrence non faussée », conclut-il, est « une parfaite ineptie ». À la mondialisation, préconise-t-il, devrait se substituer l’interrégionalisation qui permettrait à l’Europe de s’édifier en préservant son modèle social.
F. Lordon n’a pas de sarcasme assez loufoque pour stigmatiser la malfaisance de la Commission européenne qui n’a rien trouvé de mieux en pleine crise du siècle que de rappeler les États à leur obligation de limiter à 3 % leur déficit budgétaire ! « On cherche des images », écrit-il, pour donner une idée du « délire » de cette Commission : « une ambulance arrêtée par une police bizarre parce qu’elle vient de passer à l’orange en se rendant sur une scène de carambolage ? Un avion à court de carburant interdit d’atterrir par la tour de contrôle parce qu’il y a à bord un yaourt périmé ? »
Le problème de la responsabilité
Si on avait à émettre une réserve, ce serait au sujet de la notion de responsabilité. Imprégné d’une culture marxiste, à l’évidence, F. Lordon ne croit qu’à la pression des structures pour faire marcher droit les hommes. Il en vient à minimiser la part de responsabilité individuelle et la toujours possible inflexion malveillante des structures par les dirigeants. Selon lui, les financiers, traders et banquiers n’ont jamais agi qu’en vue d’une recherche maximale du profit pour laquelle ils étaient payés. N’importe qui d’autre aurait agi de la même manière à leur place, sous peine de perdre son emploi.
Sans doute. Mais on ne peut s’empêcher d’entendre dans ce raisonnement celui que tenaient les exécutants nazis des génocides juif et tzigane devant le Tribunal de Nuremberg, de l’officier SS au kapo : « Je ne suis pas responsable ! » ont-ils répété tous en chœur. Mais qui alors est responsable ? Sans aucun doute, les concepteurs, les organisateurs, « les architectes « , « les ingénieurs » de la déréglementation ont-ils une part écrasante de responsabilité. Seulement, sans les exécutants, aux tâches bien cloisonnées et circonscrites, le désastre aurait-il pu survenir ? On croyait que le cataclysme de la Seconde Guerre Mondiale avait enclenché un commencement de prise de conscience : n’a-t-on pas condamné M. Papon en 1998 pour complicité de crime contre l’humanité parce que, comme simple secrétaire général de la Préfecture de Gironde, il n’avait pas désobéi aux ordres qui lui prescrivaient de rafler des innocents ?
On est tenté de répondre à F. Lordon que la structure est certes un instrument capital dans le gouvernement des hommes. Il n’en reste pas moins que quand la structure déraille et devient malveillante sous l’action des dirigeants, il faut que les exécutants soient capables de le dénoncer, d’en sortir coûte que coûte et dire non ! Sinon, on n’en finira pas de répéter toujours les mêmes erreurs et, dans la même soumission aveugle à l’autorité, les pires crimes continueront à être commis par des individus loyaux, consciencieux et toujours irresponsables.
Il reste que, même si on peut émettre une réserve majeure comme celle-ci, le livre de F. Lordon est passionnant. La finance est replacée au cœur du débat politique et cesse d’être une activité périphérique réservée à des initiés aux mœurs incompréhensibles. La crise qui vient de survenir, montre bien qu’à laisser la finance entre les mains des financiers, comme en d’autres temps, la guerre aux mains des militaires, on court à la catastrophe. Paul Villach
(1) Frédéric Lordon, « La crise de trop – Reconstruction d’un monde failli », éditions Fayard, 2009.
52 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









